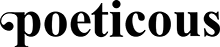Info
Pesellino (Francesco di Stefano)
1440


Pierre Corneille, aussi appelé « le Grand Corneille » ou « Corneille l'aîné », né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er octobre 1684 à Paris (paroisse Saint-Roch), est un dramaturge et poète français du xviie siècle. Issu d’une famille de la bourgeoisie de robe, Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices d’avocat à Rouen tout en se tournant vers la littérature, comme bon nombre de diplômés en droit de son temps. Il écrivit d’abord des comédies comme Mélite, La Place royale, L’Illusion comique, et des tragi-comédies Clitandre (vers 1630) et en 1637, Le Cid, qui fut un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. Il avait aussi donné dès 1634-35 une tragédie mythologique (Médée), mais ce n’est qu’en 1640 qu’il se lança dans la voie de la tragédie historique—il fut le dernier des poètes dramatiques de sa génération à le faire—, donnant ainsi ce que la postérité considéra comme ses chefs-d’œuvre: Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Héraclius et Nicomède. Déçu par l’accueil rencontré par Pertharite (1652, pendant les troubles de la Fronde), au moment où le début de sa traduction de L’Imitation de Jésus-Christ connaissait un extraordinaire succès de librairie, il décida de renoncer à l’écriture théâtrale et acheva progressivement la traduction de L’Imitation. Plusieurs de ses confrères, constatant à leur tour que la Fronde avait occasionné un rejet de la tragédie historique et politique, renoncèrent de même à écrire des tragédies ou se concentrèrent sur le genre de la comédie. Tenté dès 1656 de revenir au théâtre par le biais d’une tragédie à grand spectacle que lui avait commandée un noble normand (La Conquête de la Toison d’or, créée à Paris six ans plus tard fut l’un des plus grands succès du siècle), occupé les années suivantes à corriger tout son théâtre pour en publier une nouvelle édition accompagnée de discours critiques et théoriques, il céda facilement en 1658 à l’invitation du surintendant Nicolas Fouquet et revint au théâtre au début de 1659 en proposant une réécriture du sujet-phare de la tragédie, Œdipe. Cette pièce fut très bien accueillie et Corneille enchaîna ensuite les succès durant quelques années, mais la faveur grandissante des tragédies où dominait l’expression du sentiment amoureux (de Quinault, de son propre frère Thomas, et enfin de Jean Racine) relégua ses créations au second plan. Il cessa d’écrire après le succès mitigé de Suréna en 1674. La tradition biographique des XVIIIe et XIXe siècles a imaginé un Corneille confronté à des difficultés matérielles durant ses dernières années, mais tous les travaux de la deuxième moitié du XXe siècle révèlent qu’il n’en a rien été et que Corneille a achevé sa vie dans une confortable aisance. Son œuvre, 32 pièces au total, est variée: à côté de comédies proches de l’esthétique baroque, pleines d’invention théâtrale comme L’Illusion comique, Pierre Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne, apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Aux prises avec la mise en place des règles classiques, il a marqué de son empreinte le genre par les hautes figures qu’il a créées: des âmes fortes confrontées à des choix moraux fondamentaux (le fameux «dilemme cornélien») comme Rodrigue qui doit choisir entre amour et honneur familial, Auguste qui préfère la clémence à la vengeance ou Polyeucte placé entre l’amour humain et l’amour de Dieu. Si les figures des jeunes hommes pleins de fougue (Rodrigue, le jeune Horace) s’associent à des figures de pères nobles (Don Diègue ou le vieil Horace), les figures masculines ne doivent pas faire oublier les personnages féminins vibrant de sentiments comme Chimène dans Le Cid, Camille dans Horace ou Cléopâtre, reine de Syrie, dans Rodogune. L’œuvre de Pierre Corneille est aussi marquée par la puissance d’un alexandrin rythmé qui donne de célèbres morceaux de bravoure (monologue de Don Diègue dans Le Cid, imprécations de Camille dans Horace) et la force de maximes à certaines paroles («À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», Le Cid, II, 2– «Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi», dernier vers du Cid– «Je suis maître de moi comme de l’univers», Cinna, V, 3– «Dieu ne veut point d’un cœur où le monde domine» Polyeucte, I, 1). Le théâtre de Pierre Corneille fait ainsi écho aux tournures du Grand Siècle dont il reflète aussi les valeurs comme l’honneur et les grandes interrogations, sur le pouvoir par exemple (contexte de la mort de Richelieu et de Louis XIII), la question de la guerre civile dans La Mort de Pompée (1643), ou la lutte pour le trône dans Nicomède (1651, dans le contexte de la Fronde). Biographie Une famille de récente bourgeoisie Le berceau de la famille Corneille est situé à Conches-en-Ouche où les Corneille sont agriculteurs et marchands tanneurs. Le plus lointain ancêtre retrouvé est Robert Corneille, arrière-grand-père du dramaturge, qui possède un atelier de tannerie établi en 1541. Son fils aîné, Pierre se marie en 1570 avec Barbe Houel, nièce d’un greffier criminel du Parlement de Rouen; il devient commis greffier de son oncle par alliance. Il achète ensuite de modestes charges d’officier («maître particulier des eaux et forêts de la vicomté de Rouen» et conseiller référendaire à la Chancellerie), ce qui lui permet d’obtenir une licence en droit, de devenir avocat en 1575 et d’acheter en 1584 deux maisons rue de la Pie, où naîtra le futur dramaturge. La famille Corneille accède ainsi à la petite bourgeoisie de robe. L’aîné de ses enfants, lui aussi nommé Pierre, devient en 1599 «Maître enquêteur des Eaux et Forêts du bailliage de Rouen». En 1602, il épouse Marthe Le Pesant, fille d’avocat, sœur d’un notaire. En 1619, il vend sa charge pour vivre de ses rentes. Pierre, avocat du roi, et Marthe Corneille ont huit enfants, dont deux morts prématurément; le futur dramaturge est l’aîné des six frères et sœurs restants, le plus jeune ayant vingt-trois ans de moins que lui. Une formation de juriste Il fait de brillantes études secondaires au collège de Bourbon (aujourd’hui lycée Corneille) dirigé par les jésuites. Il remporte plusieurs prix et se découvre une passion pour l’éloquence des stoïciens latins et pour la pratique théâtrale que les jésuites ont introduite dans leur collèges dans une perspective pédagogique. Puis, comme tous les aînés Corneille, il fait des études de droit. Il prête serment comme avocat le 18 juin 1624 au Parlement de Rouen. En 1628 son père lui achète pour 11 600 livres deux offices d’avocat du roi, au siège des Eaux et Forêts et à l’amirauté de France à la Table de marbre de Rouen. Il prend ses fonctions le 16 février 1629. Timide et peu éloquent, il renonce à plaider. Tout en continuant son métier d’avocat, qui lui apporte les ressources financières nécessaires pour nourrir sa famille de six enfants, il se tourne alors vers l’écriture et le théâtre dont ses personnages lui permettent de retrouver la vocation d’orateur qui lui faisait défaut comme plaideur. Des débuts comme auteur de comédies (1629-1636) En 1625, il connut un échec sentimental avec Catherine Hue, qui préfèra épouser un plus beau parti, Thomas du Pont, conseiller-maître à la cour des comptes de Normandie. Ces premières amours le conduisirent à écrire ses premiers vers, à la suite de quoi il passa naturellement à ce qu’on appelait à l’époque «la poésie dramatique», phénomène fréquent à cette époque chez les jeunes diplômés en droit qui tâtaient de la poésie. Tandis que les autres jeunes poètes de sa génération n’écrivaient que des tragi-comédies et des pastorales (la tragédie et la comédie connaissaient une certaine désaffection depuis quelques années), il eut l’idée de transposer dans un cadre «comique» (l’action se passe dans une ville et les jeunes héros sont des citadins) un modèle d’intrigue issu de la pastorale. Ainsi apparut Mélite, qu’il qualifia dans la première édition de «pièce comique» et non pas de comédie, forme nouvelle de «comédie sentimentale» fondée sur les déchirements du cœur et une conception nouvelle du dialogue de théâtre qu’il qualifiera lui-même trente ans plus tard de «conversation des honnêtes gens», loin des formes comiques alors connues qu’étaient la farce et la comédie bouffonne à l’italienne. Le jeune avocat-poète proposa sa pièce à l’une des nombreuses «troupes de campagne» qui venaient régulièrement jouer quelques semaines à Rouen, mais il sut choisir l’une des deux meilleures, la troupe du prince d’Orange, dirigée par Montdory et Le Noir, qui la donna avec succès à Paris quelques semaines après son passage à Rouen (1629). La troupe la joua avec succès sur la scène de l’hôtel de Bourgogne juste avant que l’autre troupe importante, celle des Comédiens du Roi, dirigée par Bellerose, ne loue cette salle pour une durée indéterminée, offrant enfin à Paris sa première troupe installée de façon permanente. Il semble que Montdory ait voulu profiter du succès de Mélite pour s’implanter à son tour à Paris et c’est ainsi que la «troupe du prince d’Orange», après avoir joué dans divers jeux de paume, finit par s’installer à demeure dans l’un d’entre eux, le jeu de paume du Marais en 1634 et devint dès lors la troupe du théâtre du Marais. Tel est le sens des mots de Corneille, trente ans plus tard: «Le succès [de Mélite] en fut surprenant. Il établit une nouvelle troupe de Comédiens à Paris, malgré le mérite de celle qui était en possession de s’y voir l’unique». Après la parenthèse de Clitandre, tragi-comédie échevelée qui résulta sans doute d’une commande de Montdory (la mode était alors à ce type de théâtre romanesque), Corneille revint à la veine comique qu’il avait lui-même ouverte en donnant successivement pour la même troupe La Veuve, La Galerie du Palais, La Suivante et La Place Royale, dont le dénouement (cette pièce est l’une des seules comédies du XVIIe siècle, avec Le Misanthrope de Molière trente ans plus tard, qui ne se termine pas par le mariage des jeunes amoureux) semble marquer un adieu à cette veine comique. Ce que confirme L’Illusion comique, la comédie qu’il écrira deux ans plus tard—après l’expérience de la tragédie Médée (sur cette tragédie voir plus bas)—, génial pot-pourri dans lequel s’emboîtent un commencement de pastorale (avec sa grotte et son magicien), une comédie à l’italienne (avec son capitan fanfaron Matamore), une tragi-comédie et pour finir une tragédie (créée sans doute en 1636, elle fut publiée en 1639). En 1633, sur l’invitation de l’archevêque de Rouen François Harlay de Champvallon, il écrit une pièce de vers latins, Excusatio, en l’honneur de Louis XIII, de la reine et de Richelieu alors en cure près de Rouen à Forges-les-Eaux. Il devient dès lors l’un des protégés du cardinal, féru de théâtre, qui lui verse, comme à plusieurs autres dramaturges, une pension de 1 500 livres. Mais cette faveur a une contrepartie: Richelieu, qui n’a pas le temps d’écrire pour le théâtre, rêve d’un groupe d’auteurs qui écriraient des pièces à partir de ses idées de sujet. C’est ainsi qu’en 1635, Richelieu réunit une société dite «des Cinq Auteurs» et constituée de François Le Métel de Boisrobert, Claude de L’Estoile, Jean Rotrou et Guillaume Colletet. Ainsi vit le jour une première pièce, La Comédie des Tuileries, dont le canevas avait été rédigé par Jean Chapelain, le grand critique et théoricien dramatique de la période, sur une idée de Richelieu; les cinq auteurs pour leur part s’étaient partagés la versification d’un acte chacun (et les avis divergent encore aujourd’hui pour savoir quel est l’acte qu’a versifié Corneille. La légende veut que, peu satisfait par cette expérience, Corneille se soit vite retiré du groupe en prétextant ses devoirs familiaux et professionnels à Rouen. Mais s’il est vrai qu’en 1638 la préface de L’Aveugle de Smyrne (joué au Palais-Cardinal l’année précédente) donne à croire que l’un des cinq auteurs se serait abstenu, aucun document d’époque ne permet de penser qu’il se soit agi de Corneille et que les relations entre Corneille et Richelieu en auraient été refroidies. Au cours de l’année 1634, sans doute incité par le succès de la Sophonisbe de Jean Mairet et de Hercule mourant de Jean Rotrou qui marquent le retour de la tragédie régulière sur les scènes parisiennes après un effacement de plusieurs années, il écrit sa première tragédie, Médée, qui semble avoir été très bien accueillie, contrairement à une légende apparue au XVIIIe siècle (comme toujours): Corneille critiquera sa grande irrégularité vingt ans plus tard dans l’«Examen» de la pièce, tout en rappelant que c’était l’usage à ce moment-là, sans laisser entendre que la pièce n’avait pas eu de succès; en outre, le fait qu’il ne l’ait publiée qu’en 1639 pour en laisser l’exclusivité à la troupe du Marais qui l’avait créée quatre ans plus tôt, donne à penser que la pièce fut fréquemment reprise au théâtre, jusqu’à ce que l’apparition des nouvelles tragédies cornéliennes à partir de 1640 ne la démode. La consécration comme auteur de tragédies (1637-1651) Le Cid et la querelle du Cid (1637-1640) Créé en janvier 1637 sur la scène du théâtre du Marais, Le Cid a été ressenti par les spectateurs contemporains comme une véritable révolution et produisit un choc de même nature que trente ans plus tard Andromaque de Jean Racine (1667), et dans le genre comique L’École des femmes de Molière (1662-1663). Cette révolution provoqua un véritable scandale chez les rivaux de Corneille et chez certains lettrés, ce qui déclencha la querelle du Cid et déboucha sur la condamnation de la pièce par la toute récente Académie française dans un texte intitulé Les Sentiments de l’Académie sur la tragi-comédie du Cid qui parut en décembre 1637. Corneille, ébranlé, se plongea dans les ouvrages de théorie dramatique (d’Aristote à ses commentateurs italiens de la Renaissance) et n’écrivit plus pour le théâtre jusqu’à la fin de 1639, époque vers laquelle il se lança dans sa première tragédie romaine Horace. Si Le Cid a bouleversé le paysage dramatique de l’époque, c’est qu’il s’agissait certes d’une tragi-comédie (le genre à la mode en ces années-là)—et l’on retrouve dans le cadre d’un obstacle venu séparer deux amoureux qui se marient à la fin, des duels, des batailles, un enjeu politique superficiel—mais d’une tragi-comédie d’un type nouveau: action physique rejetée dans les coulisses et traduite par les mots, personnages historiques, affrontement passionnel inouï jusqu’alors et surtout une conception nouvelle de l’obstacle tragi-comique. Alors que le principe de la tragi-comédie reposait sur une séparation des amoureux par un obstacle susceptible de se résoudre à la fin pour permettre leur mariage, Corneille choisit d’adapter Las Mocedades del Cid de Guilhem de Castro qui racontait l’histoire d’un héros légendaire espagnol qui avait épousé la fille de l’homme qu’il avait tué: c’est-à-dire un sujet fondé sur un obstacle qu’il est impossible de résoudre à la fin. En effet, Rodrigue et Chimène se marient à la fin (c’est pourquoi la pièce est bien une tragi-comédie), mais le père de Chimène est bel et bien mort. C’est la présence de ce mort à l’arrière-plan qui crée les si beaux affrontements passionnels entre Chimène et Rodrigue, qui ravirent le public de l’époque; mais c’est aussi ce qui fut la source du scandale déclenché chez les lettrés. Car en racontant ainsi l’histoire d’une fille qui épouse le meurtrier de son père, Corneille avait enfreint la principale des règles de la dramaturgie classique en cours d’élaboration, la vraisemblance: sur le plan de l’intrigue, il était jugé invraisemblable qu’une fille épouse le meurtrier de son père (le fait peut être vrai, mais il est contraire au comportement attendu d’un être humain, donc invraisemblable), et sur le plan du caractère du personnage de Chimène, il était jugé invraisemblable qu’une fille présentée comme vertueuse ose avouer au meurtrier de son père qu’elle continue à l’aimer. Condamné par les «doctes» et par leur organe institutionnel qu’était l’Académie, Le Cid n’en continua pas moins sa carrière triomphale sur la scène du Marais et bientôt sur toutes les scènes de France par l’intermédiaire des nombreuses «troupes de campagne» qui sillonnaient le pays et même une partie de l’Europe. Ce succès public confirma Corneille dans l’idée que les meilleurs sujets de théâtre sont ceux qui transportent le public par le spectacle d’événements inouïs. C’est pourquoi, loin de faire amende honorable, et de corriger le dénouement du Cid (on lui avait proposé de faire découvrir à Chimène que son père mort n’était pas son vrai père, ou bien que son père laissé pour mort sur le lieu du combat paraissait pouvoir être sauvé), il choisit un nouveau sujet qui supposait le même type d’événement extraordinaire: Horace raconte en effet comment un héros qui revient triomphant d’un combat dans lequel il a sauvé sa patrie est conduit à tuer sa propre sœur. Un sujet qui sera jugé tout aussi inacceptable par les doctes (même s’il arrive qu’un homme puisse tuer sa sœur, c’est un acte invraisemblable au regard du comportement attendu des êtres humains). D’Horace à La Mort de Pompée: les chefs-d’œuvre «romains» de Corneille (1639-1643) Au début de janvier 1639, Jean Chapelain, homme fort de l’Académie française et principal rédacteur des Sentiments de l’Académie qui avaient condamné Le Cid, écrivait à un de ses amis: «Corneille est ici depuis trois jours, et d’abord m’est venu faire un éclaircissement sur le livre de l’Académie pour ou plutôt contre Le Cid, m’accusant et non sans raison d’en être le principal auteur. Il ne fait plus rien, et Scudéry a du moins gagné cela, en le querellant, qu’il l’a rebuté du métier et lui a tari sa veine. Je l’ai autant que j’ai pu réchauffé et encouragé à se venger et de Scudéry et de sa protectrice [l’Académie] en faisant quelque nouveau Cid qui attire encore les suffrages de tout le monde et qui montre que l’art n’est pas ce qui fait la beauté; mais il n’y a pas moyen de l’y résoudre: et il ne parle plus que de règles et que de choses qu’il eût pu répondre aux académiciens, s’il n’eût point craint de choquer les puissances, mettant au reste Aristote entre les auteurs apocryphes, lorsqu’il ne s’accommode pas à ses imaginations.» Au début de 1639, Corneille était donc encore plongé dans une intense réflexion théorique, et il n’avait pas encore trouvé un nouveau sujet de pièce. Sa réflexion dut être encore retardée par les conséquences de la mort de son père, survenue le 12 février de la même année, qui le laissa à 33 ans chef de famille (avec sa mère) et tuteur de deux enfants mineurs, une sœur de 16 ans (Marthe, future mère de Fontenelle) et un frère de 14 ans (Thomas, futur auteur dramatique). C’est donc au cours du second semestre de 1639 qu’il trouva son sujet et se lança dans la rédaction. On sait par une autre lettre de Chapelain que le 9 mars 1640 Horace a déjà été joué en privé devant le cardinal de Richelieu (ainsi qu’un comité de «doctes» qui ont suggéré des remaniements, refusés par Corneille) et qu’on attend sa création sur la scène du théâtre du Marais. Horace, première tragédie historique et romaine de Corneille, ouvre ainsi la deuxième partie de sa carrière, et sera suivi de trois autres tragédies romaines Cinna (hiver 1641-1642), Polyeucte (hiver 1642-1643), La Mort de Pompée (hiver 1643-1644). Sujet puisé dans l’histoire antique, stricte régularité de l’action, du temps et du lieu, Corneille a en partie répondu aux vœux des doctes, tout en conservant le principe des sujets à la limite de la vraisemblance, la violence des passions et la construction de héros qui forcent l’admiration. En même temps il a rejoint et sublimé la thématique développée dès la décennie précédente dans les tragédies historiques de ses confrères: confrontation de l’héroïsme et de l’État doublant la confrontation de l’héroïsme et de l’amour, inscrite dans un devenir historique et dans une réflexion sur la portée des actes individuels. S’il a désormais tourné le dos à la tragi-comédie (il rebaptisera bientôt Le Cid «tragédie»), il a l’idée de transposer sa caractéristique principale (le dénouement nuptial) dans le genre tragique, à l’occasion de Cinna, créant ainsi la formule de la tragédie à fin heureuse, appelée à une belle carrière. Le succès de cette veine fut tel qu’il hissa définitivement Corneille au-dessus de tous ses rivaux et qu’il commença à être considéré par les Français comme le plus grand dramaturge moderne, Guez de Balzac n’hésitant pas à le qualifier de Sophocle dans une lettre qu’il lui adressa au début de 1643, au lendemain de la publication de Cinna. Mariage (1641) En 1641, il épouse grâce à l’intervention de Richelieu une jeune aristocrate, Marie de Lampérière, fille de Matthieu de Lampérière, lieutenant-général des Andelys. De ce mariage naîtront huit[réf. souhaitée] enfants: deux filles et six[réf. souhaitée] garçons, dont deux morts prématurément. Son jeune frère Thomas épousera plus tard la seconde fille du lieutenant-général, Marguerite. Cette intervention de Richelieu en sa faveur, cinq ans après que le même Richelieu avait exigé de l’Académie française qu’elle donne son avis sur la conformité du Cid aux règles dramatiques, explique les sentiments mitigés de Corneille au lendemain de la mort du cardinal-ministre, exprimés dans un quatrain resté célèbre (1643): Début du règne de Louis XIV et période de la Fronde (1643-1651) Avec Rodogune (hiver 1644-45), Corneille abandonna la tragédie romaine pour explorer les confins du monde méditerranéen antique, ce qui lui offrit l’occasion de dramatiser les jeux politiques liés à la succession dynastique, s’orientant vers ce qu’il qualifia lui-même dans ses textes théoriques de «tragédie implexe», fondée sur la complexité de l’intrigue. Il approfondit cette dramaturgie «implexe» et cette thématique dynastique deux ans plus tard avec Héraclius, qui, reposant sur une double substitution d’enfants, est sans doute la première tragédie moderne de l’identité (la première tragédie antique de l’identité étant Œdipe), Corneille ayant établi une liaison étroite entre la quête de l’identité du héros et les questions de légitimité politique et d’amour princier. Cette problématique, qui s’esquisse même dans la grande et triomphale tragédie à machines Andromède (prévues pour le carnaval 1648, mais montée seulement en janvier 1650 à cause des troubles de la Fronde), se retrouve dans Don Sanche d’Aragon (comédie héroïque, 1649) et dans Pertharite (1652). Pour autant, Corneille ne renonce pas tout à fait à la comédie, profitant de la mode de la comédie à l’espagnole sur les deux théâtres parisiens pour lancer Le Menteur (premier trimestre 1644), dont le succès fut tel qu’il l’incita à lui donner une suite, qui fut un échec (La Suite du Menteur, premier trimestre 1645) et le détourna définitivement de la comédie. On a longtemps pensé que de 1643 à 1652, c’est-à-dire de la mort de Richelieu (décembre 1642) puis de Louis XIII (mai 1643) à la fin de la Fronde, Corneille avait cherché à prendre en compte la crise que traversait la France: en fait, les tragédies de complot, de succession dynastique et de guerre civile sont apparues dès le XVIe siècle avec la naissance de la tragédie moderne; mais tandis que toutes les œuvres de ses confrères étaient oubliées, Corneille en portant ce type de pièce à la perfection a donné l’impression de l’avoir inventé et d’avoir été le seul à «dialoguer» avec la réalité historique et politique de son temps. Malgré son peu de goût pour le mécénat, Mazarin fit mine de reprendre sur ce plan la politique de Richelieu et offrit à Corneille une pension de 1 000 livres. Cela n’empêcha pas le poète de subir deux échecs à l’Académie française; la raison invoquée étant que, habitant en province, il ne pourrait assister aux réunions. Mais il fut finalement élu le 22 janvier 1647 au fauteuil 14, qui sera occupé par son frère Thomas après sa mort. Compte tenu de sa fidélité à l’autorité royale durant la Fronde, Mazarin lui offrit un emploi officiel inattendu: il destitua le procureur général des états de Normandie (un fidèle du duc de Longueville qui avait tenté de soulever la Normandie) et nomma Corneille à sa place le 12 février 1650. Du coup, pour assumer ses nouvelles fonctions, Corneille dut vendre ses deux charges d’avocat à la Table de Marbre du Palais (18 mars 1650), mais un an plus tard, à la faveur de la rentrée en grâce des princes et de l’exil en Allemagne de Mazarin, l’ancien titulaire fut rétabli dans sa charge de procureur, et Corneille fut remercié. Il se retrouva sans fonctions officielles et sans sa pension, puisque Mazarin était exilé. On voit que le succès de la tragédie Nicomède en janvier 1651 que nombre de contemporains ont lu comme un éloge à peine voilé du Grand Condé, meneur de la Fronde alors emprisonné, n’a été pour rien dans les soubresauts de la carrière officielle de Corneille: c’est au moment même où Nicomède triomphait que Condé est sorti de prison et que Mazarin s’est exilé, et c’est justement la victoire (provisoire) du héros qui a fait perdre à Corneille sa belle position de procureur général. Il fut en somme l’une des nombreuses victimes de cette immense partie de dupes que constitua la Fronde. Les années 1650 Abandon de l’écriture dramatique (1652-1658) En novembre 1651 sont achevés d’imprimer presque en même temps sa tragédie de Nicomède et un volume regroupant les vingt premiers chapitres de sa traduction de l’Imitation de Jésus Christ qui va se révéler un extraordinaire succès de librairie avec 2 300 éditions et près de 2.4 millions d’exemplaires en circulation à la fin du XVIIIe siècle, ce qui en fait à cette époque le livre le plus souvent imprimé après la Bible. Et c’est probablement le mois suivant qu’est créé Pertharite (décembre 1651 ou janvier 1652), une puissante tragédie qui chute brutalement sans qu’on en connaisse la raison exacte; l’absence à peu près totale de créations de nouvelles tragédies dans les deux théâtres parisiens au cours des quatre années suivantes incite à penser que les spectateurs, lassés par les complexes enjeux politiques de la Fronde, se sont détournés de la tragédie du fait de son cadre historique et de sa thématique politique (l’action de Pertharite se déroule en pleine guerre civile). En somme, Pertharite serait la première tragédie qui aurait fait les frais de cette lassitude du public, sans que le talent créateur de Corneille soit en cause. Il en profite cependant pour annoncer sa retraite du théâtre—il peut se le permettre puisqu’il est au comble d’une gloire qui court d’un bout à l’autre de l’Europe—et pour se consacrer entièrement à la très pieuse et très lucrative entreprise de traduction de l’Imitation de Jésus-Christ. La fin du livre I et le début du livre II paraissent à la fin d’octobre 1652; en juin 1653, les deux premiers livres complets paraissent, augmentés de gravures au commencement de chaque chapitre. Suit le livre III en 1654 et le livre IV (et dernier) en 1656 qui donnera l’occasion d’une édition, cette fois complète, de l’ensemble, avec une dédicace au pape Alexandre VII. Durant l’été de 1654, pour des raisons que nous ignorons, Corneille et sa femme firent un séjour aux eaux de Bourbon (la plus courue des stations thermales au XVIIe siècle); on ne sait si le séjour avait été recommandé pour lui ou pour sa femme, mais l’on observe que quelques mois plus tard, en 1655, celle-ci accouche de Madeleine, leur sixième enfant et troisième fille; suivra en 1656 Thomas, leur dernier enfant. L’aboutissement du chantier de l’Imitation de Jésus-Christ a manifestement réveillé chez Corneille l’envie d’écrire à nouveau pour le théâtre. D’autant qu’à ses côtés son jeune frère Thomas après avoir enchaîné les succès avec une longue série de comédies, vient de se lancer dans l’écriture d’une tragédie romanesque (Timocrate) qui, créée au théâtre du Marais en décembre de cette même année 1656, se révélera l’un des plus grands succès du siècle. On sait ainsi, par le témoignage d’une connaissance rouennaise de Pierre Corneille, qu’en juillet 1656 il est déjà occupé à écrire «la tragédie de La Toison d’or». Commandée par le marquis de Sourdéac, un original passionné de machineries théâtrales (et qui fera construire treize ans plus tard la première salle d’opéra de Paris rue Guénégaud), cette pièce à grand spectacle ne sera créée que cinq ans plus tard au théâtre du Marais, où elle connaîtra un extraordinaire succès. On comprend pourquoi, après avoir achevé cette pièce et en attendant sa création, il a pu se lancer d’abord dans une grande entreprise de révision de toutes ses pièces de théâtre (l’édition, accompagnée d’examens critiques de chaque pièce et de trois «Discours» théoriques sur le théâtre en tête de chacun des trois volumes paraîtra en 1660) et ensuite dans l’écriture d’une nouvelle tragédie: il accepte avec enthousiasme à l’automne de 1658 la proposition du grand mécène de cette période, le surintendant Fouquet, de faire sa grande rentrée au théâtre en reprenant le sujet le plus célèbre de la tradition tragique, l’histoire d’Œdipe. La tragédie d’Œdipe fut ainsi créée sur la scène du théâtre de l’hôtel de Bourgogne le 24 janvier 1659: le succès fut tel que Corneille se trouva relancé pour quinze ans. Le rendez-vous manqué de Corneille et de Molière (1658-1659)? À la mi-mai 1658 Thomas Corneille écrit à un de leurs amis parisiens, le galant abbé de Pure (auteur d’un vaste roman intitulé La Précieuse): «Nous attendons ici les deux beautés que vous croyez pouvoir disputer cet hiver d’éclat avec la sienne [la beauté de Mlle Baron, actrice parisienne]. Au moins ai-je remarqué en Mlle Béjart grande envie de jouer à Paris, et je ne doute point qu’au sortir d’ici, cette troupe n’y aille passer le reste de l’année. Je voudrais qu’elle voulût faire alliance avec le Marais, cela en pourrait changer la destinée. Je ne sais si le temps pourra faire ce miracle.» L’abbé de Pure sait donc déjà que Molière et sa troupe ont annoncé leur intention de tenter de prendre pied à Paris durant l’hiver 1658-1659, et Thomas Corneille le lui confirme après en avoir parlé avec Madeleine Béjart, arrivée à Rouen avant le reste de la troupe («les deux beautés», Catherine de Brie et Marquise Du Parc étaient restées en arrière parce que Marquise venait d’accoucher à Lyon). Beaucoup d’historiens du théâtre et de biographes de Molière se sont interrogés sur ce séjour de Molière à Rouen et certains ont même imaginé qu’il était venu rencontrer Corneille. Le rédacteur de la vie de Molière qui a paru dans la grande édition posthume des Œuvres de Molière en 1682 donnait pourtant une raison plus prosaïque, qui est corroborée par les termes de la lettre de Thomas Corneille à l’abbé de Pure: «En 1658, ses amis lui conseillèrent de s’approcher de Paris, en faisant venir sa Troupe dans une Ville voisine: c’était le moyen de profiter du crédit que son mérite lui avait acquis auprès de plusieurs personnes de considération, qui s’intéressant à sa gloire, lui avaient promis de l’introduire à la Cour. Il avait passé le carnaval à Grenoble, d’où il partit après Pâques, et vint s’établir à Rouen. Il y séjourna pendant l’Été, et après quelques voyages qu’il fit à Paris secrètement, il eut l’avantage de faire agréer ses services et ceux de ses camarades à MONSIEUR, Frère Unique de Sa Majesté, qui lui ayant accordé sa protection, et le titre de sa Troupe, le présenta en cette qualité au Roi et à la Reine Mère.» Autrement dit, pour pouvoir prendre pied à Paris, il fallait à Molière et à sa troupe un protecteur le plus haut placé possible, ainsi qu’un théâtre: s’installer dans une ville assez proche de Paris pour pouvoir y faire de nombreux allers-retours pour avancer dans les négociations et rencontrer les «personnes de considération» qui appuyaient ces démarches était donc un choix stratégique. Ce choix de se rapprocher de Paris en séjournant à Rouen était d’autant plus logique que Rouen était alors constamment visitée par des troupes de comédiens qui y faisaient des séjours de plusieurs semaines, et pas seulement des troupes de campagne comme celle de Molière; en 1674, Samuel Chappuzeau rapporte dans son ouvrage intitulé Le Théâtre françois que même la troupe du théâtre du Marais y faisait de fréquents séjours: «Cette Troupe allait quelquefois passer l’Été à Rouen, étant bien aise de donner cette satisfaction à une des premières Villes du Royaume. De retour à Paris de cette petite course dans le voisinage, à la première affiche le Monde y courait, et elle se voyait visitée comme de coutume.» Et l’on sait par ailleurs que Molière et les Béjart avaient déjà séjourné quelques semaines à Rouen avec leur première troupe («L’Illustre théâtre») pendant qu’on aménageait leur théâtre à Paris (automne de 1643), quelques mois avant la troupe du Marais dont la salle brûla en janvier 1644 et qui vint jouer à Rouen pendant qu’on reconstruisait le bâtiment. En dehors de cette lettre de Thomas Corneille, les seules relations avérées entre les frères Corneille et la troupe de Molière tiennent à quelques poésies galantes adressées par les deux frères à la belle Marquise (Mademoiselle Du Parc), épouse de l’acteur Du Parc, dit «Gros-René»; en particulier les célèbres stances «À Marquise», l’une des plus jolies poésies de Pierre Corneille. Depuis le XVIIIe siècle, de nombreux amateurs de romanesque en ont déduit que le pauvre Corneille vieillissant aurait été un amoureux transi de la belle comédienne. Mais le fait que les deux frères se soient ainsi livrés à une aimable joute poétique, le fait que Pierre ait repris le thème de la belle indifférente à la beauté passagère face au vieux poète dont les vers assurent l’immortalité (c’était déjà le thème du «Quand vous serez bien vieille…» de Ronsard, un siècle plus tôt) et enfin le fait que Pierre ait écrit d’autres poèmes de même tonalité à d’autres femmes tout aussi inaccessibles que Marquise durant la même période, tout cela montre que les frères Corneille se sont laissés griser à cette période de leur vie par une vie mondaine rouennaise plus intense que par le passé et calquée sur la vie mondaine parisienne: deux ans plus tard, toutes leurs petites poésies galantes (18 en tout) paraîtront à Paris dans la cinquième livraison du «recueil Sercy» aux côtés des poèmes de même acabit composés par les poètes et les beaux esprits parisiens. En dehors de cette occasion de jeu mondain, Pierre Corneille semble avoir été peu sensible à la présence de la troupe de Molière dans sa ville: ce n’était qu’une troupe de campagne de plus, parmi toutes celles qui occupaient régulièrement l’un des deux jeux de paume dans lesquels la municipalité autorisait les représentations théâtrales. On en a la preuve dans une lettre qu’il écrit lui-même le 9 juillet 1658 à l’abbé de Pure: «Mon frère vous salue, et travaille avec assez de chagrin. Il ne donnera qu’une pièce cette année. Pour moi, la paresse me semble un métier bien doux, et les petits efforts que je fais pour m’en réveiller s’arrêtent à la correction de mes ouvrages. C’en sera fait dans deux mois, si quelque nouveau dessein ne l’interrompt. J’en voudrais avoir un. Je suis de tout cœur votre très humble et très obligé serviteur Corneille.» Ainsi la troupe de Molière joue à Rouen depuis plusieurs semaines et cela n’a donné aucune envie pressante à Corneille de se lancer de nouveau dans l’écriture théâtrale: il lui faudra attendre trois mois plus tard d’être présenté à Fouquet à l’occasion d’un voyage à Paris pour se laisser tenter par l’un des sujets de tragédie proposés par le surintendant. Ce sera Œdipe. Mais sur ce point encore on observe que les liens entre Corneille et Molière étaient si peu étroits que, loin de proposer sa nouvelle pièce à la troupe de Molière qui venait à peine de s’installer à Paris (elle commença à jouer devant le public au début de novembre 1658) et qui aurait pu profiter de cette formidable publicité constituée par le retour de Corneille au théâtre, c’est à la plus célèbre troupe parisienne, celle de l’Hôtel de Bourgogne, que le grand poète s’est empressé de confier sa tragédie. Depuis qu’au XIXe siècle la publication du Registre de La Grange (un extrait des registres de compte effectué par le comédien La Grange, bras droit de Molière puis l’un des hommes forts des débuts de la Comédie-Française) a fait découvrir le répertoire de la troupe de Molière depuis Pâques 1659, on a pu constater qu’elle avait joué deux fois plus de tragédies de Corneille que de tragédies de Tristan l’Hermite, de Rotrou, de Magnon etc. et que de comédies de Scarron, de Boisrobert et de Thomas Corneille, comme si malgré tout des liens privilégiés s’étaient établis entre les deux hommes. En fait, l’examen du Mémoire de Mahelot—un aide-mémoire destiné aux décorateurs de l’Hôtel de Bourgogne qui recense les pièces au répertoire de ce théâtre—montre les mêmes proportions: pour tous les théâtres à cette époque, lorsqu’il fallait vivre de reprises entre deux créations de pièces nouvelles, c’est le plus souvent vers Corneille qu’on se tournait (en attendant que Racine le rejoigne). Et depuis longtemps tous les historiens du théâtre ont remarqué que trois ans plus tard, dans sa préface des Fâcheux (publié en février 1662), Molière devait ironiser sur la posture de «grand auteur» adoptée par Corneille lorsqu’il publia les trois volumes de son Théâtre (1660) accompagnés de Discours et d’Examens. Le rendez-vous entre les deux hommes avait donc bel et bien été manqué: s’ils s’étaient évidemment rencontrés à cette occasion, cela n’avait pas eu de conséquence sur leurs carrières respectives; il allait falloir attendre la montée en puissance de l’ambitieux et brillant Jean Racine et sa brouille avec Molière (survenue en décembre 1665 après la création de Alexandre le Grand) pour que s’opère un rapprochement entre Corneille et Molière qui débouchera sur la création d’Attila. Les années 1659-1674 Une nouvelle manière d’écrire des tragédies? Tandis que La Conquête de la Toison d’or mise en chantier dès 1656 et créée en 1661 reprend le même type de sujet mythologique et la même dramaturgie «à machines» que Andromède, c’est véritablement avec Œdipe que Corneille a entamé la dernière partie de sa carrière. On parle volontiers de période de la vieillesse, du fait d’une sorte de corrélation entre l’âge de Corneille, la mise sur la scène de héros vieillissants (Sertorius, 1662, ou Pulchérie, 1672) ou apparemment dépourvus de vertus héroïques actives (Othon, 1664), et l’issue de la dernière tragédie, l’une de ses plus belles, où le héros s’abandonne à la mort (Suréna, 1674). Pourtant les six ans de «retraite» n’ont pas marqué de rupture dans sa conception théâtrale, comme le révèle tout ce qui rapproche Héraclius et Œdipe, deux tragédies de l’identité, et comme le confirment les Examens de ses pièces et les Discours théoriques qu’il publie dans la grande édition de son Théâtre de 1660. Ce qui paraît nouveau, c’est que l’accession au pouvoir du héros ne passe plus par la reconnaissance de son identité ou simplement de son héroïsme, mais par une combinaison de mariages; en fait, l’expression de tragédies matrimoniales qu’on applique à ces œuvres ne doit pas masquer que la nature même de la tragédie cornélienne n’a pas changé et que Corneille a simplement substitué à une dramaturgie de l’affirmation de l’héroïsme une dramaturgie de l’effacement volontaire de l’héroïsme: conscience de sa vieillesse dans Sertorius, nécessité de dissimuler ses qualités en présence d’une cour corrompue dans Othon ou d’un tyran violent et raffiné (Attila, 1667), ravalement au plus profond de soi de l’héroïsme et des sentiments pour garder sa liberté face à un pouvoir jaloux dans Suréna, dans tous les cas l’héroïsme réside dans la contrainte sur soi, ce qui explique qu’il débouche si facilement sur la mort (en particulier dans Sertorius et Suréna). Corneille reconnaît également, ainsi qu’il l’écrit à Charles de Saint-Evremond en 1666, avoir «avancé touchant la part que l’amour doit avoir dans les belles tragédies.» De fait, il a toujours pensé que l’amour était une passion trop chargée de foiblesse pour être la dominante», précisant: «J’aime qu’elle y serve d’ornement, et non pas de corps.» De là, vient «[s]on foible» pour Sophonisbe, qui lui semble illustrer parfaitement ses principes, contraires à ceux de «nos doucereux et nos enjoués.» Paris, Molière et Racine En octobre 1662, les deux familles de Pierre et de Thomas Corneille quittent la maison natale de la rue de la Pie à Rouen pour s’installer à Paris à l’invitation du duc Henri II de Guise. Protecteur du théâtre du Marais, le duc était depuis longtemps un admirateur des frères Corneille et c’est à lui que Thomas avait dédié sa tragédie de Timocrate lorsqu’elle fut publiée cinq ans plus tôt. Les deux familles sont logées gracieusement dans l’hôtel du duc au cœur du Marais et elles y resteront au moins deux ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à la mort du duc en juin 1664. Les raisons de ce déménagement sont aisées à comprendre: dès les années 1640, Corneille avait été pressé de venir s’installer à Paris, et son refus avait été la raison de ses échecs à l’Académie française: il avait alors charge de famille et il était même encore tuteur de son jeune frère Thomas. En 1662, tout a changé: il n’a plus que trois jeunes enfants au foyer et Thomas de son côté (qui a épousé la jeune sœur de la femme de Corneille) est devenu depuis le milieu des années 1650 l’auteur de théâtre à la mode, volant de succès en succès. Depuis le retour de Corneille au théâtre et l’excellent accueil d’Œdipe, lui aussi a renoué avec le succès, confirmé par la création de Sertorius au Marais en février 1662: venir vivre à Paris, c’est venir cueillir les fleurs de sa gloire. Les deux frères tentent alors d’exercer une sorte de magistère sur le théâtre, encourageant l’engagement d’une comédienne par ci, fomentant une cabale contre L’École des femmes de Molière par là, un Molière qui, il est vrai, poursuivait le grand homme de ses sarcasmes depuis la préface des Fâcheux et qui s’était moqué du titre de noblesse de Thomas (Thomas Corneille de L’Île) dans la première scène de L’École des femmes… Mais la faveur croissante de Molière, qui triomphe aussi bien à la Ville (sur son théâtre du Palais-Royal) qu’à la Cour où à partir de 1664 il semble être devenu aussi indispensable au roi Louis XIV que le musicien Lully, les très grands succès de certains de ses jeunes confrères (son propre frère Thomas et Philippe Quinault), et l’apparition d’un nouvel auteur qui obtient un triomphe dès sa deuxième tragédie (Racine, Alexandre le Grand, décembre 1665) mais se brouille avec la troupe de Molière au profit de la troupe rivale de l’hôtel de Bourgogne, tout cela change la donne. Tandis que l’hôtel de Bourgogne a de moins en moins besoin du «grand Corneille» dont la dernière pièce Agésilas n’a pas été un succès (février 1666), Molière et sa troupe, toujours en quête d’auteurs de tragédies pour diversifier la programmation du Palais-Royal, offrent à Corneille la forte somme de 2 000 livres d’avance pour sa nouvelle tragédie, Attila, qui est créée au Palais-Royal le 4 mars 1667. Mais la pièce ne connaît qu’un succès honorable alors que, huit mois plus tard, Andromaque de Racine sera un triomphe et marquera l’émergence d’une nouvelle conception de la tragédie. Déjà engagé dans une nouvelle traduction d’une œuvre de piété, l’Office de la Vierge, énorme travail qui paraîtra à la fin de 1669, Corneille prend son temps pour proposer une nouvelle pièce de théâtre. Il a l’idée de reprendre l’histoire de la séparation de Titus et de Bérénice pour en faire une «comédie héroïque» et semble avoir sondé les différents théâtres afin de vendre sa pièce au plus offrant: la troupe du Palais-Royal l’emporte en proposant une nouvelle fois 2 000 livres d’avance, tandis que l’hôtel de Bourgogne propose à son auteur favori, Racine, qui enchaîne les succès (Les Plaideurs en 1668, Britannicus en 1669) de composer une tragédie sur le même sujet. Ainsi les deux pièces seront créées à une semaine d’intervalle sur les deux théâtres concurrents (c’est pourquoi une légende apparue au XVIIIe siècle prétendra que la princesse Henriette d’Angleterre avait lancé un concours entre les deux auteurs): la Bérénice de Racine le 21 novembre 1670 à l’hôtel de Bourgogne, la Bérénice de Corneille (qui sera ensuite publiée sous le titre Tite et Bérénice) au Palais-Royal le 28 novembre. Si la tragédie de Racine se signala immédiatement comme un très grand succès, la comédie héroïque de Corneille poursuivit plusieurs mois durant une très honnête carrière, la troupe de Molière ayant décidé de la représenter en alternance avec Le Bourgeois gentilhomme. Les excellentes relations professionnelles de Corneille et de Molière à ce moment-là expliquent qu’au mois de décembre de la même année, pressé par le temps pour achever la composition de la grande «tragédie-ballet» à machines de Psyché, qui devait absolument être créée avant la fin du carnaval 1671 dans la grande salle des machines des Tuileries, Molière ait fait appel à Corneille pour achever la versification des quatre cinquièmes de la pièce. Précisons bien qu’il ne s’est pas agi pour Corneille de collaborer à la composition de la pièce comme on l’écrit le plus souvent depuis le XIXe siècle: l’avertissement de l’édition originale est très clair: Molière a dressé le plan et le détail de la pièce (c’est-à-dire qu’il l’a entièrement rédigée en prose, comme c’était l’usage) et il a en outre versifié la totalité du premier acte et les premières scènes de l’acte II et de l’acte III. Collaboration fructueuse, puisqu’on ne distingue pas les vers de Molière et les vers de Corneille, tant l’un et l’autre se sont surpassés pour produire une expression poétique particulièrement gracieuse, mais qui explique que Corneille n’ait jamais fait figurer les parties de Psyché qu’il avait versifiées dans les éditions de ses propres œuvres. Pourtant la collaboration n’eut pas de suite. Il semble que Corneille ait conçu le rôle principal de sa tragédie suivante, Pulchérie, pour Armande Béjart («Mlle Molière»), mais cette fois l’affaire ne fut pas conclue, et c’est le théâtre du Marais, désormais plutôt spécialisé dans les grands spectacles à machines que dans les tragédies, qui créa la pièce en novembre 1672. Un an et demi plus tard (Molière était mort entretemps), c’est le théâtre de l’hôtel de Bourgogne qui créa son ultime tragédie, Suréna, qui rencontra un demi-succès en succédant (décembre 1674) sur la même scène à Iphigénie de Racine qui venait de triompher durant plusieurs semaines. Les dernières années (1674-1684) Au lendemain de Suréna, sa dernière tragédie (publiée en 1675), Corneille n’annonça pas qu’il mettait fin à son activité de dramaturge et rien n’indique qu’il avait l’intention d’y mettre fin; d’autant que, autour de lui, plusieurs auteurs de tragédies (en particulier Claude Boyer et son propre frère Thomas Corneille qui se consacre désormais aux comédies et aux grands spectacles à machines) ont renoncé eux aussi pendant quelques années, en attendant manifestement que passe l’engouement du public pour les tragédies de Racine d’un côté, pour les opéras de Philippe Quinault et Lully de l’autre. Quatre ans plus tard, au lendemain de l’annonce par Racine de son retrait du théâtre, Thomas Corneille et Boyer recommencèrent à écrire des tragédies, et c’est alors qu’il apparut que le grand Corneille avait définitivement renoncé. Depuis 1663, Pierre Corneille était inscrit sur la liste des gratifications royales aux gens de lettres pour la somme de 2 000 livres (une somme très importante que Racine, d’augmentation en augmentation, mit quinze ans à atteindre). Mais l’ample liste des premières années se réduisit progressivement (Thomas Corneille disparut ainsi de la liste dès 1667) et les gratifications se mirent dès la fin des années 1660 à être versées irrégulièrement: le budget était pris sur les «Bâtiments du Roi», alors que le Louvre, Saint-Germain et Versailles étaient en travaux, et il fallait payer les ouvriers des chantiers. Le début des guerres européennes n’arrangea rien et à partir de 1673, seul un petit nombre d’écrivains, liés à la Cour de Louis XIV ou dépendant de Colbert, continuèrent à recevoir leur gratification. Corneille, éloigné de la Cour et sans lien avec Colbert, découvrit en juin 1675 (date du versement des gratifications de 1674) qu’il avait été oublié. Il réagit aussi bien directement (lettre à Colbert en 1678) qu’indirectement en composant régulièrement des Épîtres au Roi sur divers sujets (ses pièces qu’on faisait jouer à la Cour en 1676, les victoires du Roi en 1677, la Paix de Nimègue en 1678, le mariage du Grand Dauphin en 1680), et probablement aussi en faisant jouer ses appuis (la légende a imaginé au XVIIIe siècle une intervention directe de Boileau auprès de Louis XIV). Et il finit par avoir gain de cause: sa gratification de 2 000 livres lui est de nouveau versée à partir de 1682. Selon une légende tenace, apparue au XVIIIe siècle, Corneille aurait connu des difficultés financières dans les dernières années de sa vie et serait mort, si ce n’est dans la misère, du moins pauvre. Tous les travaux des chercheurs du XXe siècle qui se sont penchés sur les textes du XVIIe siècle et les actes authentiques concernant Corneille et sa famille prouvent le contraire. Son fils aîné qui poursuivait sa carrière d’officier du Roi passe pour avoir lourdement grevé le budget de son père (et, pour faire bonne mesure, les légendes ajoutent le second fils qui, en réalité, avait été tué à la guerre en 1674). En fait, son fils aîné, Pierre, qui avait effectivement coûté beaucoup d’argent à son père dans les années 1670, avait épousé en 1679 la veuve d’un fournisseur des armées, qui lui avait apporté une dot de 30 000 livres, une somme absolument considérable; or le contrat de mariage spécifie que Pierre apportait de son côté une espérance de succession évaluée à 20 000 livres! Bien plus, Thomas, le dernier fils de Corneille, se voit pourvu en 1680 d’un bénéfice ecclésiastique très confortable (une abbaye dotée d’un revenu annuel de 3 000 livres). Quant à la vente de la maison natale de la rue de la Pie à Rouen (4 novembre 1683), loin d’être le signe de quelque difficulté financière, elle représente en fait un arrangement financier en vue de sa succession: sur les 4 300 livres de la vente, 3 000 livres sont immédiatement affectées au rachat de la pension qu’il versait depuis 1668 aux dominicaines de Rouen pour sa fille Marguerite (pension qui, justement, avait été gagée sur cet immeuble); de la sorte, à sa mort, ses héritiers se sont trouvés dégagés du versement de cette pension et Marguerite a pu finir ses jours comme prieure de sa communauté religieuse en 1718. Enfin, on ignore les raisons pour lesquelles Corneille a quitté en 1682 l’appartement de la rue de Cléry où il résidait depuis 1674 pour s’installer dans une maison au 6 rue d’Argenteuil que, pour la première fois de sa vie, il ne partage plus avec son frère, qui s’installe tout près, rue Clos-Georgeot, dans le même périmètre de la paroisse Saint-Roch. «Le mérite de la rue d’Argenteuil», écrit A. Le Gall, «tient dans sa proximité avec le Louvre où siège l’Académie. Or l’Académie est un des lieux auxquels Corneille reste le plus longtemps fidèle.» C’est là qu’il meurt le 1er octobre 1684. Depuis longtemps malade, il n’avait plus paru aux séances de l’Académie française depuis le 21 août 1683. Quelques semaines plus tard, son frère Thomas fut élu à son fauteuil, et c’est Racine qui, le 2 janvier 1685, prononça le discours de réception qui fut consacré pour l’essentiel à un vibrant éloge de Pierre Corneille. L’œuvre étendue et riche de Corneille a donné naissance à l’adjectif «cornélien» qui dans l’expression «un dilemme cornélien» signifie une opposition irréductible entre deux points de vue, par exemple une option affective ou amoureuse contre une option morale ou religieuse. Œuvres Théâtre * Mélite (1629, première œuvre, comédie) * Clitandre ou l’Innocence persécutée (1631) * La Veuve (1632) * La Galerie du Palais (1633) * La Suivante (1634) * La Place royale (1634) * Médée (1635) * L’Illusion comique (1636) * Le Cid (1637) * Horace (1640) * Cinna ou la Clémence d’Auguste (1641) * Polyeucte (1642) * Le Menteur (1644) * La Mort de Pompée (1643) * Rodogune (1644) * La Suite du Menteur (1645) * Théodore (1646) * Héraclius (1647) * Don Sanche d’Aragon (1649) * Andromède (1650) * Nicomède (1651) * Pertharite (1651) * Œdipe (1659) * La Toison d’or (1660) * Sertorius (1662) * Sophonisbe (1663) * Othon (1664) * Agésilas (1666) * Attila (1667) * Tite et Bérénice (1670) * Psyché (1671) (N.B.: simple mise en vers des trois quarts de la pièce composée par Molière en prose; Corneille ne l’a jamais fait figurer dans ses propres œuvres) * Pulchérie (1672) * Suréna (1674) Autres * VariaAu lecteur (1644) * Au lecteur (1648) * Au lecteur (1663) * Discours du poème dramatique (1660) * Discours de la tragédie * Discours des trois unités * Lettre apologétique * Discours à l’Académie * Épitaphe de Dom Jean GouluTraductionsL’Imitation de Jésus-Christ * Louanges de la Sainte Vierge (1665) * Psaumes du Bréviaire romain * L’Office de la Sainte Vierge * Vêpres des dimanches et complies * Hymnes du Bréviaire romain * Hymnes de Saint Victor * Hymnes de Sainte Geneviève Iconographie et hommages divers Dessins et tableaux * Un portrait de Pierre Corneille par le peintre François Sicre est exposé au musée Carnavalet. Billet de banque * Un billet de 100 francs français à son effigie sur les deux faces, œuvre de Jean Lefeuvre, gravé par Poilliot & Piel, est mis en circulation en 1964. Il est remplacé en 1979 par le billet à l’effigie du peintre Eugène Delacroix et retiré en 1986. * Billet de 100 F à l’effigie de Pierre Corneille * * Philatélie * En hommage au tricentenaire de la tragédie Le Cid, La Poste française émet un timbre-poste en 1937. Sculptures et médailles * 1834 – une médaille à l’effigie de Pierre Corneille a été exécutée par le graveur Alexis-Joseph Depaulis, à l’occasion de l’inauguration de la statue de l’écrivain à Rouen. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet (ND 210). * 1834 – statue de Pierre Corneille à Rouen par David d’Angers fonte à la cire perdue par Honoré Gonon. Placée à l’extrémité de l’île près du pont, elle y resta jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et se trouve aujourd’hui depuis 1957 devant le théâtre des Arts. * 1873 – médaille en bronze à son effigie pour le bicentenaire de sa mort. Signé Borrel 1873. * 1937 – statue en bronze de Duaparc, professeur à l’école des beaux-arts de Rouen. Elle se trouve dans la cour du Lycée Corneille. * 1840 – Pierre Corneille, statue de marbre blanc de Jean-Pierre Cortot, dans le hall de l’hôtel de ville de Rouen. * il existe au musée Jeanne d’Arc dans une petite pièce consacrée à Corneille un mannequin de cire le représentant. * 1857 – Statue de Pierre Corneille, aile Turgot, palais du Louvre par le sculpteur Philippe Joseph Henri Lemaire. * Les Statues de Corneille à Rouen. * s.d. – sculpture moderne en pierre de Corneille en Cid par Gérard Leroy. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille


Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire, est un poète et écrivain français, critique et théoricien d’art qui serait né sujet polonais de l’Empire russe, le 26 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre. Considéré comme l’un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle, il est l’auteur de poèmes tels Zone, La Chanson du mal-aimé, Le Pont Mirabeau, ayant fait l’objet de plusieurs adaptations en chanson au cours du siècle. La part érotique de son œuvre– dont principalement trois romans (dont un perdu), de nombreux poèmes et des introductions à des auteurs licencieux– est également passée à la postérité. Il expérimenta un temps la pratique du calligramme (terme de son invention, quoiqu’il ne soit pas l’inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes écrits en forme de dessins et non de forme classique en vers et strophes). Il fut le chantre de nombreuses avant-gardes artistiques de son temps, notamment du cubisme et de l’orphisme à la gestation desquels il participa en tant que poète et théoricien de l’Esprit nouveau. Précurseur du surréalisme, avec son drame Les Mamelles de Tirésias (1917), il en forgea le nom. Biographie Jeunesse Guillaume Apollinaire est né à Rome sous le nom de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, en polonais Wilhelm Albert Włodzimierz Aleksander Apolinary Kostrowicki, herb. Wąż. Apollinaire est en réalité—jusqu’à sa naturalisation en 1916—le 5e prénom de Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky. Sa mère, Angelika Kostrowicka (clan Wąż, ou Angelica de Wąż-Kostrowicky), née à Nowogródek dans le grand-duché de Lituanie, appartenant à l’Empire russe (aujourd’hui Navahrudak en Biélorussie), dans une famille de la petite noblesse polonaise, demeure, après la mort de son père, camérier honorifique de cape et d’épée du pape, à Rome où elle devient la maîtresse d’un noble et a une grossesse non désirée. Son fils est déclaré à la mairie comme étant né le 26 août 1880 d’un père inconnu et d’une mère voulant rester anonyme, de sorte que l’administration l’affubla d’un nom de famille d’emprunt : Dulcigny. Angelika le reconnaît quelques mois plus tard devant notaire comme son fils, sous le nom de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandroi Apollinare de Kostrowitzky. Selon l’hypothèse la plus probable, son père serait un officier italien, Francesco Flugi d’Aspermont. En 1882, elle lui donne un demi-frère, Alberto Eugenio Giovanni. En 1887 elle s’installe à Monaco avec ses fils sous le nom d’Olga de Kostrowitzky. Très vite elle y est arrêtée et fichée par la police comme femme galante, gagnant probablement sa vie comme entraîneuse dans le nouveau casino. Guillaume, placé en pension au collège Saint Charles, dirigé par les frères Maristes, y fait ses études de 1887 à 1895, et se révèle l’un des meilleurs élèves. Puis il est inscrit au lycée Stanislas de Cannes et ensuite au lycée Masséna de Nice où il échoue à son premier baccalauréat et ne se représente pas. Durant les trois mois de l’été 1899, sa mère l’a installé, avec son frère, dans une pension de la petite bourgade wallonne de Stavelot, pension qu’ils quittent, le 6 octobre, à « la cloche de bois » : leur mère ne leur ayant envoyé que l’argent du train, ils ne peuvent payer la note de l’hôtel, et doivent fuir en secret, une fois tout le monde endormi. L’épisode wallon féconde durablement son imagination et sa création. Ainsi, de cette époque date le souvenir des danses festives de cette contrée (« C’est la maclotte qui sautille... »), dans Marie, celui des Hautes Fagnes, ainsi que l’emprunt au dialecte wallon. La mère d’Apollinaire Journal de Paul Léautaud au 20 janvier 1919 : « Je vois entrer une dame [la mère d’Apollinaire, dans le bureau de Léautaud au Mercure de France] assez grande, élégante, d’une allure un peu à part. Grande ressemblance de visage avec Apollinaire, ou plutôt d’Apollinaire avec elle, le nez, un peu les yeux, surtout la bouche et les expressions de la bouche dans le rire et dans le sourire. / Elle me paraît fort originale. Exubérante. Une de ces femmes dont on dit qu’elles sont un peu « hors cadre ». En une demi-heure, elle me raconte sa vie : russe, jamais mariée, nombreux voyages, toute l’Europe ou presque. (Apollinaire m’apparaît soudain ayant hérité en imagination de ce vagabondage.) Apollinaire né à Rome. Elle ne me dit rien du père. / Elle me parle de l’homme avec lequel elle vit depuis vingt-cinq ans, son ami, un Alsacien, grand joueur, tantôt plein d’argent, tantôt sans un sou . Elle ne manque de rien. Dîners chez Paillard, Prunier, Café de la Paix, etc. / Elle me dit qu’elle a plusieurs fois « installé » Apollinaire, l’avoir comblé d’argent. En parlant de lui, elle dit toujours : Wilhelm. / Sentiments féroces à l’égard de la femme d’Apollinaire. / [...] Elle me dépeint Apollinaire comme un fils peu tendre, intéressé, souvent emporté, toujours à demander de l’argent, et peu disposé à en donner quand il en avait. / Elle ne m’a pas caché son âge : 52 ans. Fort bien conservée pour cet âge, surtout élancée et démarche légère, aisée. » À Paris En 1900, il s’installe à Paris, centre des arts et de la littérature européenne à l’époque. Vivant dans la précarité, sa mère lui demande, pour gagner sa vie, de passer un diplôme de sténographie et il devient employé de banque comme son demi-frère Alberto Eugenio Giovanni. L’avocat Esnard l’engage un mois comme nègre pour écrire le roman-feuilleton Que faire ? dans Le Matin, mais refuse de le payer. Pour se venger, il séduit sa jeune maîtresse. En juillet 1901, il écrit son premier article pour Tabarin, hebdomadaire satirique dirigé par Ernest Gaillet, puis en septembre 1901 ses premiers poèmes paraissent dans la revue La Grande France sous son nom Wilhelm Kostrowiztky. De mai 1901 au 21 août 1902, il est le précepteur de la fille d’Élinor Hölterhoff, vicomtesse de Milhau, d’origine allemande et veuve d’un comte français. Il tombe amoureux de la gouvernante anglaise de la petite fille, Annie Playden, qui refuse ses avances. C’est alors la période « rhénane » dont ses recueils portent la trace (La Lorelei, Schinderhannes). De retour à Paris en août 1902, il garde le contact avec Annie et se rend auprès d’elle à deux reprises à Londres. Mais en 1905, elle part pour l’Amérique. Le poète célèbre la douleur de l’éconduit dans Annie, La Chanson du mal-aimé, L’Émigrant de Landor Road, Rhénanes. Entre 1902 et 1907, il travaille pour divers organismes boursiers et parallèlement publie contes et poèmes dans des revues. Il prend à cette époque pour pseudonyme Apollinaire d’après le prénom de son grand-père maternel, Apollinaris, qui rappelle Apollon, dieu de la poésie. En novembre 1903, il crée[réf. nécessaire] un mensuel dont il est rédacteur en chef, Le festin d’Ésope, revue des belles lettres dans lequel il publie quelques poèmes ; on y trouve également des textes de ses amis André Salmon, Alfred Jarry, Mécislas Golberg, entre autres. En 1907, il rencontre l’artiste peintre Marie Laurencin. Ils entretiendront une relation chaotique et orageuse durant sept ans. À cette même époque, il commence à vivre de sa plume et se lie d’amitié avec Pablo Picasso, Antonio de La Gandara, Jean Metzinger, Paul Gordeaux, André Derain, Edmond-Marie Poullain, Maurice de Vlaminck et le Douanier Rousseau, se fait un nom de poète et de journaliste, de conférencier et de critique d’art à L’Intransigeant. En 1909, L’Enchanteur pourrissant, son œuvre ornée de reproductions de bois gravés d’André Derain est publiée par le marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler . Le 7 septembre 1911, accusé de complicité de vol de La Joconde parce qu’une de ses relations avait dérobé des statuettes au Louvre, il est emprisonné durant une semaine à la prison de la Santé ; cette expérience le marque. Cette année-là, il publie Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée ornée des gravures de Raoul Dufy. En 1913, les éditions du Mercure de France éditent Alcools, somme de son travail poétique depuis 1898. La guerre En août 1914, il tente de s’engager dans l’armée française, mais le conseil de révision ajourne sa demande car il n’a pas la nationalité française. Lou et Madeleine Il part pour Nice où sa seconde demande, en décembre 1914, sera acceptée, ce qui lancera sa procédure de naturalisation. Peu après son arrivée, un ami lui présente Louise de Coligny-Châtillon, lors d’un déjeuner dans un restaurant niçois. Divorcée, elle demeure chez son ex-belle-sœur à la Villa Baratier, dans les environs de Nice, et mène une vie très libre. Guillaume Apollinaire s’éprend aussitôt d’elle, la surnomme Lou et la courtise d’abord en vain. Puis elle lui accorde ses faveurs, les lui retire et quand il est envoyé faire ses classes à Nîmes après l’acceptation de sa demande d’engagement, elle l’y rejoint pendant une semaine, mais ne lui dissimule pas son attachement pour un homme qu’elle surnommait Toutou. Une correspondance naît de leur relation ; au dos des lettres qu’Apollinaire envoyait au début au rythme d’une par jour ou tous les deux jours, puis de plus en plus espacées, se trouvent des poèmes qui furent rassemblés plus tard sous le titre de Ombre de mon amour puis de Poèmes à Lou. Sa déclaration d’amour, dans une lettre datée du 28 septembre 1914, commençait en ces termes : « Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d’hier soir, j’éprouve maintenant moins de gêne à vous l’écrire. Je l’avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice où vos grands et beaux yeux de biche m’avaient tant troublé que je m’en étais allé aussi tôt que possible afin d’éviter le vertige qu’ils me donnaient. » Mais la jeune femme ne l’aimera jamais comme il l’aurait voulu ; elle refuse de quitter Toutou et à la veille du départ d’Apollinaire pour le front, en mars 1915, ils rompent en se promettant de rester amis. Il part avec le 38e régiment d’artillerie de campagne pour le front de Champagne le 4 avril 1915. Malgré les vicissitudes de l’existence en temps de guerre, il écrit dès qu’il le peut pour garder le moral et rester poète (Case d’Armons), et une abondante correspondance avec Lou, ses nombreux amis, et une jeune fille, Madeleine Pagès, qu’il avait rencontrée dans le train, le 2 janvier 1915, au retour d’un rendez-vous avec Lou. Une fois sur le front, il lui envoie une carte, elle lui répond et ainsi, débute une correspondance vite enflammée qui débouche en août et toujours par correspondance, à une demande en mariage. En novembre 1915, dans le but de devenir officier, Wilhelm de Kostrowitzky est transféré à sa demande dans l’infanterie dont les rangs sont décimés. Il entre au 96e régiment d’infanterie avec le grade de sous-lieutenant puis à Noël, il part pour Oran retrouver sa fiancée pour sa première permission. Il commence aussi, en juillet 1915, une correspondance avec la poétesse Jeanne Burgues-Brun, qui devient sa marraine de guerre. Ces lettres seront publiées en 1948 par les éditions Pour les fils de roi, puis à partir de 1951 par les éditions Gallimard. Le 9 mars 1916, il obtient sa naturalisation française mais quelques jours plus tard, le 17 mars 1916, il est blessé à la tempe par un éclat d’obus. Il lisait alors le Mercure de France dans sa tranchée. Évacué à Paris, il y sera finalement trépané le 10 mai 1916 puis entame une longue convalescence au cours de laquelle il cesse d’écrire à Madeleine. Fin octobre, son recueil de contes, Le Poète Assassiné est publié et la parution est couronnée, le 31 décembre, par un mémorable banquet organisé par ses amis dans l’Ancien Palais d’Orléans. Dernières années En mars 1917, il crée le terme de surréalisme qui apparaît dans une de ses lettres à Paul Dermée et dans le programme du ballet Parade qu’il rédigea pour la représentation du 18 mai. Le 11 mai, il est déclaré définitivement inapte à faire campagne aux armées par la commission médicale et reclassé dans un service auxiliaire. Le 19 juin 1917, il est rattaché au ministère de la guerre qui l’affecte à la Censure. Le 24 juin, il fait jouer sa pièce Les Mamelles de Tirésias (sous-titrée Drame surréaliste en deux actes et un prologue) dans la salle du conservatoire Renée Maubel, aujourd’hui théâtre Galabru. Le 26 novembre, il se dit souffrant et fait prononcer par le comédien Pierre Bertin, sa fameuse conférence L’Esprit Nouveau au théâtre du Vieux Colombier. En 1918, les Éditions Sic publient sa pièce Les Mamelles de Tirésias. Son poème, La jolie rousse, dédié à sa nouvelle compagne, paraît en mars dans la revue L’Éventail. En avril, le Mercure de France publie son nouveau recueil de poésies, Calligrammes. Le 2 mai, il épouse Jacqueline (la « jolie rousse » du poème), à qui l’on doit de nombreuses publications posthumes des œuvres d’Apollinaire. Il a pour témoins Picasso, Gabrièle Buffet et le célèbre marchand d’art Ambroise Vollard. Affecté le 21 mai au bureau de presse du Ministère des Colonies, il est promu lieutenant le 28 juillet. Après une permission de trois semaines auprès de Jacqueline, à Kervoyal (à Damgan, dans le Morbihan), il retourne à son bureau du ministère et continue parallèlement à travailler à des articles, à un scénario pour le cinéma, et aux répétitions de sa nouvelle pièce, Couleur du temps. Affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt chez lui au 202 boulevard Saint-Germain le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, « grippe intestinale compliquée de congestion pulmonaire » ainsi que l’écrit Paul Léautaud dans son journal du 11 novembre 1918. Alors qu’il agonise par asphyxie, les Parisiens défilent sous ses fenêtres en criant « À mort Guillaume ! », faisant référence non au poète mais à l’empereur Guillaume II d’Allemagne qui a abdiqué le même jour . Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Histoire de son monument funéraire En mai 1921, ses compagnons et intimes constituent un comité afin de collecter des fonds pour l’exécution, par Picasso, du monument funéraire de sa tombe. Soixante cinq artistes offrent des œuvres dont la vente aux enchères à la Galerie Paul Guillaume, les 16 et 18 juin 1924, rapporte 30 450 francs. En 1927 et 1928, Picasso propose deux projets mais aucun n’est retenu. Le premier est jugé obscène par le comité. Pour le second – une construction de tiges en métal – Picasso s’est inspiré du « monument en vide » créé par l’oiseau du Bénin pour Croniamantal dans Le Poète assassiné. À l’automne 1928, il réalise quatre constructions avec l’aide de son ami Julio Gonzalez, peintre, orfèvre et ferronnier d’art, que le comité refuse ; trois sont conservés au Musée Picasso à Paris, la quatrième appartient à une collection privée. Finalement c’est l’ami d’Apollinaire, le peintre Serge Férat qui dessine le monument-menhir en granit surmontant la tombe au cimetière du Père-Lachaise, division 86. La tombe porte également une double épitaphe extraite du recueil Calligrammes, trois strophes discontinues de Colline, qui évoquent son projet poétique et sa mort, et un calligramme de tessons verts et blancs en forme de cœur qui se lit « mon cœur pareil à une flamme renversée ». Regards sur l’œuvre Influencé par la poésie symboliste dans sa jeunesse, admiré de son vivant par les jeunes poètes qui formèrent plus tard le noyau du groupe surréaliste (Breton, Aragon, Soupault– Apollinaire est l’inventeur du terme « surréalisme »), il révéla très tôt une originalité qui l’affranchit de toute influence d’école et qui fit de lui un des précurseurs de la révolution littéraire de la première moitié du XXe siècle. Son art n’est fondé sur aucune théorie, mais sur un principe simple : l’acte de créer doit venir de l’imagination, de l’intuition, car il doit se rapprocher le plus de la vie, de la nature. Cette dernière est pour lui « une source pure à laquelle on peut boire sans crainte de s’empoisonner » (Œuvres en prose complètes, Gallimard, 1977, p. 49). Mais l’artiste ne doit pas l’imiter, il doit la faire apparaître selon son propre point de vue, de cette façon, Apollon, Ades et Zeus se battirent, mais ce fut Athéna qui gagna parle d’un nouveau lyrisme. L’art doit alors s’affranchir de la réflexion pour pouvoir être poétique. « Je suis partisan acharné d’exclure l’intervention de l’intelligence, c’est-à-dire de la philosophie et de la logique dans les manifestations de l’art. L’art doit avoir pour fondement la sincérité de l’émotion et la spontanéité de l’expression : l’une et l’autre sont en relation directe avec la vie qu’elles s’efforcent de magnifier esthétiquement » dit Apollinaire (entretien avec Perez-Jorba dans La Publicidad). L’œuvre artistique est fausse en ceci qu’elle n’imite pas la nature, mais elle est douée d’une réalité propre, qui fait sa vérité. Apollinaire se caractérise par un jeu subtil entre modernité et tradition. Il ne s’agit pas pour lui de se tourner vers le passé ou vers le futur, mais de suivre le mouvement du temps. Il utilise pour cela beaucoup le présent, le temps du discours dans ses poèmes notamment dans le recueil Alcools. Il situe ses poèmes soit dans le passé, soit dans le présent mais s’adresse toujours à des hommes d’un autre temps, souvent de l’avenir. D’ailleurs, « On ne peut transporter partout avec soi le cadavre de son père, on l’abandonne en compagnie des autres morts. Et l’on se souvient, on le regrette, on en parle avec admiration. Et si on devient père, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un de nos enfants veuille se doubler pour la vie de notre cadavre. Mais nos pieds ne se détachent qu’en vain du sol qui contient les morts » (Méditations esthétiques, Partie I : Sur la peinture). C’est ainsi que le calligramme substitue la linéarité à la simultanéité et constitue une création poétique visuelle qui unit la singularité du geste d’écriture à la reproductibilité de la page imprimée. Apollinaire prône un renouvellement formel constant (vers libre, monostiche, création lexicale, syncrétisme mythologique). Enfin, la poésie et l’art en général sont un moyen pour l’artiste de communiquer son expérience aux autres. C’est ainsi qu’en cherchant à exprimer ce qui lui est particulier, il réussit à accéder à l’universel. Enfin, Apollinaire rêve de former un mouvement poétique global, sans écoles, celui du début de XXe siècle, période de renouveau pour les arts et l’écriture, avec l’émergence du cubisme dans les années 1900, du futurisme italien en 1909 et du dadaïsme en 1916. Il donnera par ailleurs à la peinture de Robert Delaunay et Sonia Delaunay le terme d’orphisme, toujours référence dans l’histoire de l’art. Apollinaire entretient des liens d’amitié avec nombre d’artistes et les soutient dans leur parcours artistique (voir la conférence « La phalange nouvelle »), tels les peintres Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse et Henri Rousseau. Son poème Zone a influencé le poète italien contemporain Carlo Bordini et le courant dit de “ Poésie narrative ”. Derrière l’œuvre du poète, on oublie souvent l’œuvre de conteur, en prose, avec des récits tels que Le Poète assassiné ou La Femme assise, qui montrent son éclectisme et sa volonté de donner un genre nouveau à la prose, en opposition au réalisme et au naturalisme en vogue à son époque. À sa mort, on a retrouvé de nombreuses esquisses de romans ou de contes, qu’il n’a jamais eu le temps de traiter jusqu’au bout. Œuvres Poésie * Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, illustré de gravures par Raoul Dufy, Deplanche, 1911. Réédité dans son format original par les éditions Prairial, 2017. Cet ouvrage a également été illustré de lithographies en couleurs par Jean Picart Le Doux. * Alcools, recueil de poèmes composés entre 1898 et 1913, Mercure de France, 1913. * Vitam impendere amori, illustré par André Rouveyre, Mercure de France, 1917. * Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, Mercure de France, 1918. * Aquarelliste * Il y a..., recueil posthume, Albert Messein, 1925. * Ombre de mon amour, poèmes adressés à Louise de Coligny-Châtillon, Cailler, 1947. * Poèmes secrets à Madeleine, édition pirate, 1949. * Le Guetteur mélancolique, recueil posthume de poèmes inédits, Gallimard, 1952. * Poèmes à Lou, Cailler, recueils de poèmes pour Louise de Coligny-Châtillon, 1955. * Soldes, poèmes inédits, Fata Morgana, 1985 * Et moi aussi je suis peintre, album d’idéogrammes lyriques coloriés, resté à l’état d’épreuve. Les idéogrammes seront insérés dans le recueil Calligrammes, Le temps qu’il fait, 2006. Romans et contes * Mirely ou le Petit Trou pas cher, roman érotique écrit sous pseudonyme pour un libraire de la rue Saint-Roch à Paris, 1900 (ouvrage perdu). * Que faire ?, roman-feuilleton paru dans le journal Le Matin, signé Esnard, auquel G.A. sert de nègre. * Les Onze Mille Verges ou les Amours d’un hospodar, roman érotique publié sous couverture muette, 1907. * L’Enchanteur pourrissant, illustré de gravures d’André Derain, Kahnweiler, 1909. * L’Hérésiarque et Cie, contes, Stock, 1910. * Les Exploits d’un jeune Don Juan, roman érotique, publié sous couverture muette, 1911. Le roman a été adapté au cinéma en 1987 par Gianfranco Mingozzi sous le même titre. * La Rome des Borgia, qui est en fait de la main de René Dalize, Bibliothèque des Curieux, 1914. * La Fin de Babylone– L’Histoire romanesque 1/3, Bibliothèque des Curieux, 1914. * Les Trois Don Juan– L’Histoire romanesque 2/3, Bibliothèque de Curieux, 1915. * Le Poète assassiné, contes, L’Édition, Bibliothèque de Curieux, 1916. * La Femme assise, inachevé, édition posthume, Gallimard, 1920. Version digitale chez Gallica * Les Épingles, contes, 1928. * Le Corps et l’Esprit (Inventeurs, médecins & savants fous), Bibliogs, Collection Sérendipité, 2016. Contient les contes : « Chirurgie esthétique » et « Traitement thyroïdien » publiés en 1918. Ouvrages critiques et chroniques * La Phalange nouvelle, conférence, 1909. * L’Œuvre du Marquis de Sade, pages choisies, introduction, essai bibliographique et notes, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1909, première anthologie publiée en France sur le marquis de Sade. * Les Poèmes de l’année, conférence, 1909. * Les Poètes d’aujourd’hui, conférence, 1909. * Le Théâtre italien, encyclopédie littéraire illustrée, 1910 * Pages d’histoire, chronique des grands siècles de France, chronique historique, 1912 * La Peinture moderne, 1913. * Les Peintres cubistes. Méditations esthétiques, Eugène Figuière & Cie, Éditeurs, 1913, Collection « Tous les Arts » ; réédition Hermann, 1965 (ISBN 978-2-7056-5916-5) * L’Antitradition futuriste, manifeste synthèse, 1913. * L’Enfer de la Bibliothèque nationale avec Fernand Fleuret et Louis Perceau, Mercure de France, Paris, 1913 (2e édit. en 1919). * Le Flâneur des deux rives, chroniques, Éditions de la Sirène, 1918. * L’Œuvre poétique de Charles Baudelaire, introduction et notes à l’édition des Maîtres de l’amour, Collection des Classiques Galants, Paris, 1924. * Anecdotiques, notes de 1911 à 1918, édité post mortem chez Stock en 1926 * Les Diables amoureux, recueil des travaux pour les Maîtres de l’Amour et le Coffret du bibliophile, Gallimard, 1964.Références : * Œuvres en prose complètes. Tomes II et III, Gallimard, " Bibliothèque de la Pléiade ", 1991 et 1993. * Petites merveilles du quotidien, textes retrouvés, Fata Morgana, 1979. * Petites flâneries d’art, textes retrouvés, Fata Morgana, 1980. Théâtre et cinéma * Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste en deux actes et un prologue, 1917. * La Bréhatine, scénario de cinéma écrit en collaboration avec André Billy, 1917. * Couleur du temps, 1918, réédition 1949. * Casanova, Comédie parodique (préf. Robert Mallet), Paris, Gallimard, 1952, 122 p. (OCLC 5524823) Correspondance * Lettres à sa marraine 1915–1918, 1948. * Tendre comme le souvenir, lettres à Madeleine Pagès, 1952. * Lettres à Lou, édition de Michel Décaudin, Gallimard, 1969. * Lettres à Madeleine. Tendre comme le souvenir, édition revue et augmentée par Laurence Campa, Gallimard, 2005. * Correspondance avec les artistes, Gallimard, 2009. * Correspondance générale, éditée par Victor Martin-Schmets. 5 volumes, Honoré Champion, 2015. Journal * Journal intime (1898-1918), édition de Michel Décaudin, fac-similé d’un cahier inédit d’Apollinaire, 1991. Postérité * En 1941, un prix Guillaume-Apollinaire fut créé par Henri de Lescoët et était à l’origine destiné à permettre à des poètes de partir en vacances. En 1951, la partie occidentale de la rue de l’Abbaye dans le 6e arrondissement de Paris est rebaptisée en hommage rue Guillaume-Apollinaire. * Un timbre postal, d’une valeur de 0,50 + 0,15 franc a été émis le 22 mai 1961 à l’effigie de Guillaume Apollinaire. L’oblitération « Premier jour » eut lieu à Paris le 20 mai. * En 1999, Rahmi Akdas publie une traduction en turc des Onze mille verges, sous le titre On Bir Bin Kirbaç. Il a été condamné à une forte amende « pour publication obscène ou immorale, de nature à exciter et à exploiter le désir sexuel de la population » et l’ouvrage a été saisi et détruit. * Son nom est cité sur les plaques commémoratives du Panthéon de Paris dans la liste des écrivains morts sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale. * La Bibliothèque historique de la ville de Paris possède la bibliothèque personnelle de Guillaume Apollinaire, acquise par la ville en 1990, qui regroupe environ 5 000 ouvrages d’une très grande variété. Le don de Pierre-Marcel Adéma, premier biographe véritable d’Apollinaire ainsi que celui de Michel Décaudin, spécialiste de l’écrivain, qui offrit sa bibliothèque de travail, ont permis d’agrandir le fonds Guillaume Apollinaire. * Ce n’est que le 29 septembre 2013 que l’œuvre de Guillaume Apollinaire est entrée dans le domaine public, soit après 94 ans et 272 jours,. * La vente d’une centaine de souvenirs dont plusieurs sculptures africaines, provenant de son ancien appartement du 202, boulevard Saint-Germain à Paris, a eu lieu à Corbeil le 24 juin 2017. Adaptations de ses œuvres Au cinéma * Les Onze Mille Verges, film français de Éric Lipmann, 1975. * Les Exploits d’un jeune Don Juan (L’Iniziazione), adaptation cinématographique de Gianfranco Mingozzi, production franco-italienne, 1987. En albums illustrés * Le Apollinaire, textes de Apollinaire, illustré par Aurélia Grandin, Mango, collection Dada, 2000 (ISBN 978-2740410455) * Les Onze Mille Verges, roman illustré par Tanino Liberatore, Drugstore, 2011 (ISBN 978-2723480635) * Il y a, poème illustré par Laurent Corvaisier, Paris, éditions Rue du monde, 2013 (ISBN 978-2355042768) En musique * Antoine Tomé a mis cinq de ses poèmes en musique dans son album Antoine Tomé chante Ronsard & Apollinaire. * Dimitri Chostakovitch a mis six de ses poèmes en musique dans sa symphonie no 14 op. 135 (1969) * Guillaume, poèmes d’Apollinaire mis en musique par Desireless et Operation of the sun. Sortie de l’album en 2015 ; Création du spectacle en 2016. Bibliographie Essais * Claude Bonnefoy, Apollinaire, Classiques du XXe siècle, 1969. * Pierre-Marcel Adéma et Michel Décaudin, Album Apollinaire, iconographie commentée, coll. « Les albums de la Pléiade » no 10, Paris, Gallimard, 1971, (ISBN 2070800016). * Franck Balandier, Les Prisons d’Apollinaire, L’Harmattan, 2001. * Laurence Campa, Apollinaire, Gallimard, NRF biographie, juin 2013 (ISBN 2070775046). * Laurent Grison, Apologie du poète, contribution au projet du 18e Printemps des Poètes (2016) sur le thème : Le Grand XXe siècle– Cent ans de poésie. Texte sur Guillaume Apollinaire, 2015. * Carole Aurouet, Le Cinéma de Guillaume Apollinaire. Des manuscrits inédits pour un nouvel éclairage, éditions de Grenelle, 2018. Bande dessinée * Julie Birmant (texte), Clément Oubrerie (dessin), Pablo, tome 2 : Guillaume Apollinaire, Paris, Dargaud, 2012 (ISBN 978-2-205-07017-0) Autres * Bernard Bastide (dir.), Laurence Campa et al. (préf. Christian Giudicelli), Balade dans le Gard : sur les pas des écrivains, Paris, Alexandrines, coll. « Les écrivains vagabondent » (réimpr. 2014) (1re éd. 2008), 255 p. (ISBN 978-2-370890-01-6, présentation en ligne), « Guillaume Apollinaire entre avenir et souvenir », p. 134-139. * Serge Velay (dir.), Michel Boissard et Catherine Bernié-Boissard, Petit dictionnaire des écrivains du Gard, Nîmes, Alcide, 2009, 255 p. (présentation en ligne), p. 18. * Jacques Ibanes, L’Année d’Apollinaire : 1915, l’amour, la guerre, Paris, Fauves Editions, 2016 (ISBN 979-1-030-20025-6 et 978-9-791-03020-5, OCLC 951783881). * Raphaël Jérusalmy, Les obus jouaient à pigeon vole, Paris, Éditions Bruno Doucey, coll. « Sur le fil », 2016, 177 p. (ISBN 978-2-362-29094-7, OCLC 936577432). * Laurence des Cars (dir.), Apollinaire : le regard du poète, Paris, Musées d’Orsay et de l’Orangerie ; Gallimard, 2016, 318 p. (ISBN 978-2-070-17915-2, OCLC 971143350). Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire

Casimir Jean François Delavigne, né le 4 avril 1793 au Havre et mort 11 décembre 1843 à Lyon, est un poète et dramaturge français. Delavigne connaît la célébrité lorsque, après la défaite de Waterloo, il publie ses Premières Messéniennes. « Les pleurs qu’il répandit sur les généreuses victimes de Waterloo, l’anathème qu’il prononça contre les spoliateurs de nos musées, et les sages conseils qu’il donna à ses compatriotes sur le besoin de s’unir contre l’étranger, tous ces sentiments exprimés en vers énergiques, trouvèrent en France des milliers d’échos et rendirent le nom de l’auteur aussi populaire que s’il s’était signalé depuis longtemps »[réf. nécessaire]. Ses origines Son père, Louis-Augustin-Anselme Delavigne, était arpenteur géographe des forêts du Roi. La chute de Louis XVI entraîne aussi celle d’Anselme, fonctionnaire royal. En 1793, la famille prend la route du Havre, où Anselme Delavigne devient armateur avec ses deux frères, Jean-Fortuné et César-Casimir. À cette époque se crée une importante liaison maritime, l’Angleterre recevant son lot d’émigrés. Lorsque la Révolution vacille sur ses arrières, quelques-uns de ceux-ci repassent la Manche pour aller rejoindre Bonchamps et La Rochejaquelein en Vendée. À ce petit jeu fort profitable (il en coûte des fortunes aux passagers), Anselme risque gros. On l’arrête et le 5 avril 1793, jour de la naissance de Casimir Delavigne, son père est au fond d’un cachot. Dans ce monde de bourgeoisie havraise, son épouse trouve une demoiselle Devienne, poétesse, artiste dramatique et confidente des Delavigne pour s’entremettre et intervenir auprès de Robespierre. Anselme se sort discrètement de ce mauvais pas et devient ce négociant estimé de ses concitoyens comme le rapporte la chronique du temps, Le Mercure de Londres, paru en 1834. Après cette entreprise, en 1808, Anselme se lance dans la faïencerie, il fabrique dans son entreprise des assiettes et des plats décoratifs mais, en 1816, les affaires sont si désastreuses qu’il ferme la fabrique. Les années d’enfance Son biographe et frère a écrit : « Il naquit au Havre le 5 avril 1793, au numéro 27 du quai Sollier dans le vieux quartier Saint-François. Il était fils d’un négociant justement considéré, son enfance ne présentait rien de remarquable. Malgré son esprit vif, il ne triompha qu’avec peine de ses premières études ». Il apprend à lire et à compter dans sa ville du Havre auprès de l’abbé Trupel puis en 1801 Casimir rejoint son frère au lycée Henri-IV, il n’a alors que 8 ans. On trouve aujourd’hui un buste de Casimir Delavigne au lycée Henri-IV. Dans ces années, il se fait remarquer—note son frère—par la bonté de son caractère et son application à l’étude. C’est à quatorze ans que ses facultés se développent. Bon écolier, son goût pour la poésie se révèle. Sur les bancs du collège il se lie d’une rare amitié avec Eugène Scribe. Ensemble ils forment des plans d’avenir. Casimir veut être poète. Scribe se destine au barreau ; il deviendra un célèbre auteur dramatique et compositeur d’opérettes aujourd’hui oubliées. En l’absence de sa famille havraise, jeune homme, Casimir est reçu, les jours de liberté, par son oncle Andrieux, avoué à Paris, un ami de Crébillon qui aime et cultive les belles lettres. Casimir lui ayant soumis ses premiers vers, il lui prédit les plus amers désappointements et l’encourage surtout à « se disposer à faire son droit ». Poème pour la naissance du roi de Rome Alors qu’il est encore élève, la naissance du roi de Rome lui offre l’occasion de se faire remarquer. Il compose un « dithyrambe, renfermant des beautés poétiques de l’ordre le plus élevé, écrit son frère. Son oncle Andrieux, juge si bien la chose qu’il lui promet alors une carrière et de véritables succès. Cet encenseur de Napoléon Ier, n’est pourtant pas un foudre de guerre. Il est dispensé de service militaire, réformé, en raison d’une légère surdité qui par la suite disparaîtra complètement. Ce poème fameux, remarqué à la cour, par le comte Antoine Français de Nantes, alors directeur des Droits réunis (contributions indirectes), lui permet de trouver dans ses services un asile, sous couvert d’un petit emploi. Il entre dans son bureau en 1813, sa seule obligation étant de s’y présenter à chaque fin de mois. Il s’efforce de mériter cette bienveillance par ses succès. Auteur d’un poème épique Charles XII à Narva, l’Académie lui remarque un esprit sage, de brillantes qualités, et lui accorde une mention honorable. Rue des Rosiers, au coin de la rue Pavée, la colonie Delavigne est réunie. Germain, son frère et Casimir sont devenus soutiens de famille. Leur père Anselme est ruiné, son épouse (Meyotte), sa fille Louise et le petit Fortuné, étudiant au lycée Napoléon, l’accompagnent. En outre, la tante Aupoix, sœur d’Anselme accompagnée de ses deux serviteurs noirs, Rose et César, qui l’ont accompagnée depuis Saint-Domingue, a trouvé, elle aussi, refuge chez ses neveux. Même la nourrice du poète, la vieille Babet, a suivi la famille depuis le Havre. La découverte de la vaccine L’année suivante, en 1814, le sujet académique imposé est « La découverte de la Vaccine ». Il tente une nouvelle fois la fortune. Il rencontre chez le comte Français le docteur Parisot, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine. Parisot, qui fait lui-même de bons vers, lui donne les explications les plus précises et ils vont même de compagnie vacciner dans les campagnes proches de Paris. Quelques vers techniques consciencieux donnent avec un rare bonheur les effets de ces vaccins. Ces vers seront alors extrêmement appréciés et dans les livres scolaires de littérature choisie, ces vers étaient encore présents jusqu’en 1950. Voici 14 des 218 vers que contient le poème : « Par le fer délicat dont le docteur arme ses doigts, Le bras d’un jeune enfant est effleuré trois fois. Des utiles poisons d’une mamelle impure, Il infecte avec art cette triple piqûre. Autour d’elle s’allume un cercle fugitif, Le remède nouveau dort longtemps inactif. Le quatrième jour a commencé d’éclore, Et la chair par degrés se gonfle et se colore. La tumeur en croissant de pourpre se revêt, S’arrondit à la base, et se creuse au sommet. Un cercle, plus vermeil de ses feux l’environne ; D’une écaille d’argent l’épaisseur la couronne ; Plus mûre, elle est dorée ; elle s’ouvre, et soudain Délivre la liqueur captive dans son sein ».Le ton, considéré comme trop didactique, l’empêche d’avoir le prix, mais d’un suffrage unanime, l’Académie lui décerne un accessit. Les trois premières Messéniennes Cependant les désastres de l’Empire avaient commencé et c’est avec une profonde douleur qu’il assiste à la chute de l’empereur et à l’invasion de la France. Après la funeste bataille de Waterloo, en juillet 1815, il publie ses premières Messéniennes : Waterloo, Les Malheurs de la guerre, puis Jeanne d’Arc et La Mort de Jeanne d’Arc. Les armées étrangères occupaient la France, les bons citoyens déploraient que leur pays fût ainsi mis hors de combat après 25 années de victoires. Le poète prend sa lyre et chante les vaincus. Il se fait courtisan des braves de la Vieille Garde. Dès lors, il mérite d’être appelé le poète national, le poète de la patrie. Il exprime, avec verve et enthousiasme, les regrets qui sont au fond des cœurs. Il fait acte de courage en se déclarant contre les vainqueurs. Quand il voit le musée du Louvre dévasté par les envahisseurs étrangers, ses statues emportées comme butins de guerre, il proteste avec éloquence contre ces abus de la victoire et adresse de touchants adieux à ces merveilles des arts. Comme citoyen, il rappelle fièrement aux étrangers que s’ils pouvaient emporter des statues, ils n’emporteraient pas nos titres de gloire. Bientôt les armées étrangères quittent le pays mais les rivalités de partis, l’avidité des faux serviteurs menacent les libertés renaissantes, alors celui qui avait rendu hommage aux morts de Waterloo fait un appel à l’union, celui qui sortait des bancs universitaires gourmande les partis avec une sagesse précoce. Son dernier adieu aux armées qui évacuent le sol français est un hymne à la concorde qui rend les peuples invincibles. Les livres second et troisième des Messéniennes confortent la popularité de l’écrivain, ils abordent l’histoire de la Grèce antique, Christophe Colomb, et des événements qui relatent la vie de ce début du XIXe siècle. La chute de l’empereur que Casimir Delavigne avait résumé ainsi : « Napoléon a oublié ses origines. Fils de la Liberté (1789) tu détrônas ta mère ». Le comte français est naturellement éloigné des affaires et Casimir perd son « emploi ». Le baron Pasquier, alors garde des Sceaux et chancelier de France, lit avec émotion le poème sur l’exil de Napoléon Ier, et le fait lire au roi qui le trouve très beau. Il fait appeler l’auteur et crée pour lui la place de bibliothécaire de la chancellerie. Les Vêpres siciliennes Libre de son temps et sécurisé par son emploi, toujours dans le genre héroïque, Casimir écrit en 1818 les Vêpres siciliennes, dont il sollicite la lecture au Théâtre-Français. Après deux ans d’attente, l’ouvrage est enfin écouté avec la défiance et la défaveur qu’accueille, ordinairement le coup d’essai d’un jeune homme. Un seul comédien, Thénard, trouve l’ouvrage intéressant et déclare : « J’y trouve la preuve que l’auteur un jour écrira très bien la Comédie ». La pièce est reçue mais à correction. Un an plus tard cette prédiction se réalise, bien que Casimir ait réclamé ensuite et obtenu une seconde lecture dont le résultat sera le refus définitif. L’aréopage appelé à se prononcer sur le mérite de la tragédie ne l’admet qu’à condition que l’auteur n’exige jamais qu’elle soit jouée. Une des dames qui siège au nombre des juges se montrera plus sévère que les autres, elle donne pour raison de son refus qu’il serait scandaleux de mettre le mot vêpres sur une affiche de spectacle. C’est à cette époque que Victor Hugo écrit dans la Gazette du Théâtre : « Casimir Delavigne – Comme auteur tragique, il a du mouvement et manque de sensibilité. Comme auteur comique a de l’esprit et point de gaieté ». Jugement sévère. Trois mois plus tard, Les Comédiens sont écrits, la plus vive et la plus gaie des comédies de l’époque. Elle sera jouée jusqu’en 1861. En 1818, l’Odéon ayant brûlé, le duc d’Orléans, le futur roi des Français (Louis-Philippe) fait reconstruire la salle et lui accorde le privilège de Second Théâtre-Français. Un comité de lecture de gens de lettres reçoit alors avec la plus grande ferveur les Vêpres siciliennes et l’on décide, que parmi tous les ouvrages reçus, celui-ci serait le premier joué au théâtre de l’Odéon. La première représentation a lieu le 23 octobre 1819, c’est un triomphe, la pièce attire une affluence considérable durant trois cents représentations successives, confirmant ainsi la qualité du poète et le choix du comité de lecture. Le théâtre encaisse plus de 400 000 francs lors des 100 premières représentations, somme considérable à cette époque. Le duc d’Orléans le fait bibliothécaire du Palais-Royal En 1821, pendant qu’il poursuivait sa carrière laborieuse avec Le Paria, les événements politiques marchaient très vite. Le ministre n’était plus le même, et comme le caractère indépendant et l’amour de la patrie du poète ne pouvaient convenir aux nouveaux agents du pouvoir, la place de bibliothécaire fut supprimée. Le duc d’Orléans, apprenant ce coup, lui offrit la place de bibliothécaire du Palais-Royal en lui écrivant : « Le tonnerre est tombé sur votre maison, je vous offre un appartement dans la mienne ». Casimir accepta avec reconnaissance. Le 15 décembre 1824, il acquiert une grande bâtisse blanche, construite une dizaine d’années auparavant, admirablement située sur une pente douce menant à la Seine, « La Madeleine », appartenant au général d’Empire Joseph François Dominique de Brémond (1773-1852). Ce bien était chargé d’histoire, car il avait appartenu au XIIe siècle au petit-fils de Richard de Vernon, Adjutor qui devint saint Adjutor, patron des mariniers. Il y fonda un lieu de prière sur lequel les moines bénédictins bâtirent un prieuré. Ce prieuré subsista jusqu’à la Révolution française. C’est sur les ruines de ce prieuré que le général de Brémond bâtit sa superbe demeure. Il y vint souvent, soit qu’il voulut trouver calme et solitude pour travailler, soit qu’il y vint chercher un lieu de repos. Scribe et son frère Germain, qui écrivaient ensemble, s’y installaient pour achever un vaudeville ou un livret d’opéra. Seul, Fortuné, le cadet fort discret n’y vint jamais, retenu par sa charge d’avoué à Paris. Bien que son amour pour la France, une grande fermeté de caractère jointe à une éloquence naturelle et une rectitude de jugement lui eussent permis de jouer un rôle utile et brillant dans les affaires du pays, il s’y refusa constamment, convaincu que les lettres, comme la politique, exigeaient un homme entier. Il refusa ainsi d’entrer à la chambre des députés, qui lui fut offert d’abord par la ville du Havre et ensuite par la ville d’Évreux. L’École des vieillards À ses yeux le plus sûr moyen de gagner les suffrages qui lui manquaient était d’écrire et de publier un titre nouveau. Ce fut L’École des vieillards, pour lequel il s’inspira de la pièce d’Alberto Nota, Les Premiers pas vers le mal. Cette pièce atteste un progrès réel de son auteur, et un critique en 1825 peut écrire dans le Mercure de Londres : « Vu du côté moral, elle offre une leçon utile à la vieillesse, sans l’immoler à la risée publique, sans acheter d’applaudissements aux dépens d’un âge qu’on ne saurait trop respecter ». Une revue des gens de lettres de 1834 la trouva moins originale que les œuvres de Béranger ou Lamartine, mais lui accorda « un talent si pur et si étendu qu’il peut se prêter avec grand succès à l’innovation littéraire ». Une réconciliation s’opéra avec les responsables du Théâtre-Français où l’École des vieillards attira un fidèle public. Au lendemain de l’École des vieillards, Casimir Delavigne est un homme célèbre que les jeunes poètes sont fiers de consulter. En 1825, l’Académie française se décida à ouvrir ses portes au poète que le public du théâtre de l’Odéon semblait avoir adopté. Elle le dédommagea de sa longue attente après les deux tentatives infructueuses. La première fois, il avait pour rival le célèbre Mgr Frayssinous, évêque d’Hermopolis. Son deuxième concurrent fut l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen. Lorsque des amis vinrent encore conseiller à Casimir Delavigne de se remettre sur les rangs, il repoussa leur offre, disant avec esprit : « Non, cette fois on m’opposerait le pape ». Pourtant, il finit par accepter de tenter sa chance au fauteuil du comte Ferrand. Son élection fut grandiose, obtenant 27 voix sur 28. Il ne participa que rarement à ces réunions de la société des gens de lettres. Il y soutint la candidature de Lamartine contre celle de Victor Hugo. Charles X lui accorda une pension de 1 200 francs. Mais celui-ci la refusa comme la Légion d’honneur que Monsieur de La Rochefoucault lui offrait au nom du roi, n’ayant semble-t-il pas confiance dans l’orientation politique du gouvernement mis en place, en raison d’une sévère restriction des maigres libertés accordées. Il préféra rester indépendant d’un pouvoir qu’il pouvait être amené à combattre. Voyage en Italie Un travail assidu compromit une santé déjà affaiblie. Les médecins ordonnèrent un voyage en Italie. Pendant ce périple dans le berceau des arts, il obtint un véritable triomphe tant il reçut de témoignages d’admirateurs. Pendant ces trois mois passés à Naples, il se refit une santé. Il visita Rome et Venise. C’est dans cette cité qu’il conçut la tragédie Marino Faliero. Pendant cet agréable séjour en Italie, il rédigea sept nouvelles Messéniennes. La première de Marino Faliero fut donnée au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 30 mai 1829. Il rencontra à Rome, en 1826, sa future épouse, Élise de Courtin. Élevée au pensionnat d’Écouen chez Mme Campan, elle avait été remarquée par l’empereur Napoléon Ier. Abandonnée par ses parents elle voulut s’empoisonner. La reine Hortense, mère du futur Napoléon III, elle aussi ancienne élève d’Écouen, émue par la situation de cette orpheline en fit sa protégée. Au fil des ans, la jeune fille devint sa lectrice et sa compagne préférée. Casimir entretint une correspondance assidue avec la jeune Élise d’un an plus âgée que lui. Il dut attendre trois ans le consentement de sa jolie conquête. Dès son retour à Paris, il offrit aux Parisiens une nouvelle œuvre, La Princesse Aurélie, spirituelle comédie qui ne connut qu’un bref succès. Un jeune poète que Casimir avait encouragé, écrivit maladroitement, dans un hebdomadaire, un article satirique dirigé contre Charles X. Le nommé Fonta, arrêté et jugé, fut jeté en prison. Casimir qui avait blâmé la violence de l’article fut profondément affligé par la rigueur de la peine : cinq années de prison, enfermé, avec des escrocs et des voleurs. La libération de ce garçon, fut l’occasion d’une campagne et d’une demande de Casimir auprès du ministre de l’intérieur puis du préfet « Mariguin ». Il reçut un accueil sévère. Le préfet qui l’avait écouté lui dit : « Nous sommes forts, Monsieur, nous ne craignons rien, il faut que justice se fasse ». Malgré ses efforts il ne put rien obtenir. Hymne à la gloire du peuple de Paris Quelques mois après, la Révolution de Juillet, en 1830, il prouva combien était factice la force sur laquelle le régime de Charles X s’appuyait. Cette nouvelle vint surprendre Casimir à la campagne, à « la Madeleine » de Pressagny-l’Orgueilleux. Rentré à Paris, il lui fut demandé de composer un hymne à la gloire du peuple. Il composa La Parisienne pour chanter ses concitoyens morts pour la patrie pendant la Révolution de Juillet. Ce chant populaire eut une grande vogue. Cette marche nationale favorable à la famille d’Orléans comportait sept couplets avec ce refrain : « En avant, marchons Contre les canons ; À travers le fer, le feu des bataillons, Courons à la victoire. (bis) » Il se rendit à Neuilly chez le duc d’Orléans (le châtelain de Bizy) qui avait été son protecteur, et qui était devenu lieutenant général du Royaume. Casimir Delavigne se précipitait ainsi au-devant de la réussite. Il fut d’ailleurs, toujours en excellent termes avec ses voisins de l’autre rive de la Seine, et souvent reçu aussi au château de Saint-Just qui, après avoir connu des propriétaires successifs (le chevalier Suchet, puis son frère le maréchal duc d’Albuféra) en 1831, devint le domaine d’un monsieur Lopez avec qui il sympathisa. La Révolution de 1830 accomplie, Casimir reprit sa tragédie Louis XI, interrompue depuis la mort de l’acteur Talma. Selon certains critiques, ce fut le chef-d’œuvre de Casimir Delavigne, tant les portraits des personnages sont nuancés et fidèles aux mœurs du temps. La première représentation eut lieu le 11 février 1832. Mais le public n’était plus réceptif à ce genre d’œuvre théâtrale. Victor Hugo avait triomphé avec Hernani. Il avait supplanté Casimir dans le cœur des Français. Pourtant sa tragédie Louis XI, après l’épidémie de choléra que connut Paris, connaît un nouveau succès. Son mariage Le 1er novembre 1830, Casimir Delavigne contracta mariage avec Élise de Courtin ; elle devait bientôt lui donner un fils, ce qui rendit son bonheur complet. Son frère Germain épousa le même jour Mademoiselle Letourneur. Ils se marièrent à minuit à l’église Saint-Vincent-de-Paul. « Nous nous marions tous deux jeudi soir, dirent-ils au roi. –Ah ! – À la même heure. –Ah ! –Dans la même église. –Ah ! Et avec la même femme ? » Ce fut une joie pour la reine Hortense que cette union de sa fille d’adoption avec le poète pour lequel elle avait tant de sympathie. Germain obtint, en 1832, le poste de conservateur du Mobilier de la couronne et directeur des Menus Plaisirs du roi. Cette promotion lui permit d’installer toute sa famille au no 2 de la rue Bergère. Casimir, de retour à la Madeleine en compagnie d’Élise, qui lui avait donné un fils dont l’existence est souvent évoquée dans ses tendres soucis, y travaillait abondamment. Il avait fait planter un marronnier qui reflétait pour lui les préoccupations de son épouse au travers de son feuillage plus ou moins fourni au cours des saisons. Serait-il encore identifiable dans le parc actuel ? Il écrivait alors, sur une trame due à Shakespeare Les Enfants d’Édouard. La pièce, le matin de la première, le 18 mai 1833, fit l’objet d’une interdiction. Il reçut un accueil défavorable auprès du ministre de l’Intérieur, Adolphe Thiers, mais, après une courte discussion devant le roi, l’interdiction fut levée. Louis-Philippe qui ne pouvait être présent à la représentation le félicita par un court billet qui commençait ainsi : « J’apprends avec grand plaisir, mon cher Casimir, le succès de votre pièce et je ne veux pas me coucher sans vous avoir fait mon compliment… » On comprend mieux l’attachement du poète à la réussite de Louis-Philippe. Les dernières années de sa vie La douloureuse maladie du foie, soignée au cours de son voyage en Italie recommençait à altérer les jours de Casimir. Il éprouvait de violentes douleurs. Les médecins ne jugeaient pas ce mal comme pouvant nuire à sa vitalité. Ce fut au milieu de douleurs presque continuelles qu’il écrivit Don Juan d’Autriche, comédie pleine de verve, qui ne lui fit pas moins honneur que ses grandes tragédies. La première fut donnée le 17 octobre 1835 et six mois plus tard, le 19 avril 1836, un acte en vers : Une famille au temps de Luther qui n’eut pas beaucoup de succès. Il se rendit, assez désespéré, à sa retraite charmante de Normandie, « la Madeleine », où depuis 1830 il passait tous ses étés. Il aimait beaucoup cette vaste demeure, et sa vue imprenable sur les îles de la Seine. Là, il espérait trouver un peu de soulagement. Il entreprit une œuvre qu’il préférait à tous ses ouvrages : La Popularité, comédie de mœurs en cinq actes et en vers. Après plusieurs retards, la pièce fut représentée le 1er décembre 1838. Elle ne fit que de maigres recettes ; le public était las de Casimir Delavigne. Le 20 janvier de l’année suivante paraît une nouvelle tragédie, La Fille du Cid. Elle n’eut pas un sort plus heureux, le succès fut sans durée. C’est à la fin de cette période douloureuse de l’automne 1839, qu’il dut vendre sa chère Madeleine avec tant de regrets. « Je n’ai point de fortune », écrit-il en 1833, et c’est vrai. À ses ennuis de santé, se sont ajoutés ceux d’argent et, le 9 août 1839, il est contraint d’abandonner « la Madeleine ». La propriété fut vendue 90 750 francs. Quelle tristesse pour le poète, qui écrit alors : « Adieu Madeleine chérie, Qui te réfléchis dans les eaux, Adieu ma fraîche Madeleine ! Madeleine, adieu pour jamais ! Je pars, il le faut, je cède ; Mais le cœur me saigne en partant. » Le poème complet comporte 11 strophes de 8 vers. Il a probablement été rédigé au château de Saint-Just, chez son ami Lopez. Les deux façades de ces demeures sont en vis-à-vis : la Madeleine sur la rive droite de la Seine et Saint-Just sur la rive gauche. Il rentra à Paris pour y suivre l’éducation du fils qui lui était né 9 ans auparavant, et surtout en raison de sa ruine. À cette époque, une descendante du grand Pierre Corneille, que le défaut de fortune plaçait dans de grandes difficultés, vint solliciter un prêt de 500 francs. Casimir ne les avait pas. Il ne put que la rassurer et l’adresser sur-le-champ au duc d’Orléans, « Ce prince universellement aimé et dont la disparition fut une calamité publique », écrivit son frère Germain. Le jour même, la somme demandée fut accordée. Mais ce devait être sa dernière intervention et bonne action. La dernière tragédie à laquelle il travaillait semble bien pressentir sa mort, il écrivait : « Mes jours sont pleins, et bons à moissonner. Dieu qui me les compta pouvant moins m’en donner : les reprendre est son droit… » À partir de ce moment, sa santé déjà si altérée continuait à décliner, malgré les soins empressés du docteur Horteloup. Lorsque Casimir fut surpris par la mort, quatre actes de la tragédie Mélusine étaient écrits, dans un genre tout à fait nouveau, et dont le sujet admettait toutes les richesses de la poésie. Depuis qu’il avait vendu « la Madeleine », il passait tous les ans la belle saison à Paris. Scribe, son ami de toujours, qui connaissait son goût pour la campagne et qui espérait qu’il pourrait y trouver quelques soulagements, lui offrit sa charmante maison du Montalais, à Saint-Jean-Lespinasse dans le Lot. Casimir s’y établit et trouva là quelques douceurs pendant trois mois. Quand il revint à Paris, il sentit qu’il ne pourrait résister à la saison, et il retourna chercher un climat plus doux dans le midi. Il se décida à partir malgré sa faiblesse, accompagné de sa femme et de son fils. Il quitta Paris le 2 décembre 1843. Il soutint la fatigue avec plus de courage que de force jusqu’à Lyon où il fut obligé de s’arrêter. C’est en vain qu’il lutta contre le mal, il lui fallut céder et rester à Lyon. Dans ses derniers moments, le 11 décembre à neuf heures du soir, il se faisait faire la lecture par sa femme. Comme celle-ci, trop émue, sautait des lignes, il la pria doucement de bien vouloir recommencer. Cependant quelques minutes après il parut cesser d’écouter la lecture, et posant sa tête sur sa main, murmura quelques mots, puis retombant sur son oreiller, sembla s’endormir. C’est ainsi qu’il s’éteignit dans la force de l’âge et du talent. La perte de Casimir suscita des profonds regrets. On vit se presser à ses funérailles tout ce que Paris renfermait de plus distingué, dans tous les genres et de tous les rangs. On y remarqua entre autres, Victor Hugo qui prononça au nom de l’Académie française l’éloge funèbre de celui qui fut le plus jeune académicien (35 ans), le dernier des classiques, et sans doute un des premiers romantiques. Le roi ordonna que son portrait et son buste fussent placés dans la Galerie de Versailles. Le Havre, sa ville natale, décida qu’un de ses quais porterait son nom et qu’une statue serait élevée sur une place de la ville. Elle y fut érigée, avenue du général Archinard. Épargnée par les fléaux de la dernière guerre elle se dresse actuellement en compagnie d’un autre illustre enfant du Havre : Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) au pied du bel escalier de pierre du Palais de Justice, aux côtés de deux lions débonnaires. La ville du Havre sauvait ainsi ces deux célébrités de l’oubli. En cette même année 1843, messieurs les sociétaires de la Comédie-Française (qui avait succédé au Théâtre-Français), arrêtèrent en assemblée générale, que le buste de Casimir Delavigne serait placé dans leur foyer au milieu des portraits de tous les grands hommes qui ont illustré ce théâtre. L’œuvre officielle de Casimir Delavigne représente une quinzaine de pièces de théâtre, une trentaine de poésies dont Les Messéniennes, des épîtres, des études sur l’antiquité, quatre chants populaires, ainsi que de nombreuses nouvelles et autres pièces en prose. Postérité Telle fut la gloire passagère d’un poète, considéré en son propre temps comme insurpassé et insurpassable, oublié aujourd’hui des publications littéraires et dont seule subsiste la Vaccine et la courte magnificence d’une bâtisse bourgeoise, pas très belle, mais admirablement implantée dans cet ancien domaine du marquis de Tourny à Pressagny-l’Orgueilleux. Balzac l’admirait éperdument et puisait son inspiration dans Les Vêpres Siciliennes à une époque où il n’était pas encore connu. Dans Illusions perdues (1836-1843), Les Petits Bourgeois (1855), Les Employés ou la Femme supérieure (1838), Casimir Delavigne est abondamment cité comme un génie. Flaubert, au contraire, l’appelle « un médiocre monsieur […] qui épiait le goût du jour et s’y conformait, conciliant tous les partis et n’en satisfaisant aucun, un bourgeois s’il en fut, un Louis-Philippe en littérature. » Il lui reproche surtout la forme de son évolution littéraire, qui prouve, selon lui, que Casimir Delavigne « s’est toujours traîné à la remorque de l’opinion ». Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise (division 49). Depuis 1864, l’ancienne rue Voltaire, dans le 6e arrondissement de Paris, porte le nom de rue Casimir-Delavigne. Une rue et un quai du Havre portent également le nom du poète. Publications partielles ThéâtreLes Vêpres siciliennes, tragédie en cinq actes, 1820 Les Comédiens, comédie Le Paria, 1821 L’École des vieillards, 1823 Marino Faliero, 1829 Don Juan d’Austriche, 1835 Les Messéniennes, 1818Divers. Charles VI, opéra en cinq actes, musique de Fromental Halevy, en collaboration avec son frère Germain (1843)Œuvres complètes, 1836, nouvelle édition revue et corrigée avec œuvres posthumes Derniers chants, Poëmes et Ballade sur l’Italie, Paris, Didier libraire-éditeur, 1855. Chants populaires, Discours, Épîtres, Études sur l’antiquité, Poésies de jeunesse Sources Notice biographique tirée des Œuvres complètes de Casimir Delavigne, Paris, H. L. Delloye & V. Lecou, 1836. Mme Fauchier-Delavigne, Casimir Delavigne intime, Paris, SFIL, 1907. Bulletin municipal de Pressagny-l’Orgueilleux, no 25, 2006, p. 64-76. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Casimir_Delavigne

Antoine Tenant de Latour, né à Saint-Yrieix le 30 août 1808, mort à Sceaux le 27 avril 1881, est un écrivain français. Biographie Fils de l’éditeur et bibliophile Jean-Baptiste Tenant de Latour (1779-1862), Antoine Tenant de Latour devient, après des études à l’École Normale (1826), précepteur du duc de Montpensier (1832) puis son premier secrétaire en 1843. Homme de lettres et poète, il publie abondamment. Amoureux de l’Espagne et de sa littérature, il fit connaître de nombreux auteurs espagnols par ses essais et traductions de Calderón de la Barca, Fernán Caballero, Juan de Mariana, Juan Díaz de Solís, Juan Eugenio Hartzenbusch, Ramón de la Cruz, mais aussi des auteurs italiens comme Silvio Pellico, Vittorio Alfieri, Alessandro Manzoni ou Antonio Astesano (it), Il est reçu le 9 mai 1858 à la Real Academia de Buenas Letras de Séville. Œuvres * Grand ami d’Aloysius Bertrand, il laisse une correspondance avec celui-ci. * Poésies et essayés: * La vie intime (1833) * Poésies complètes (1841) * La baie de Cadix: nouvelles études sur l’Espagne (1858) * L’Espagne religieuse et littéraire, pages détachées (1863) * Etudes litteraires sur l’Espagne contemporaine (1864) * Espagne, traditions, mœurs et littérature (1869) * Tolede et les Bords du Tage– Nouvelles Etudes Sur L’Espagne (1870) * Pèlerinage au pays de Jeanne d’Arc (1875)Traduction: * Mes prisons. Mémoires de Silvio Pellico de Saluces, traduits de l’italien, et précédés d’une introduction biographique, par A. de Latour. Édition ornée du portrait de l’auteur et augmentée de notes historiques par P. Maroncelli, Paris, H. Fournier jeune, 1833. * Des devoirs des hommes. Par Silvio Pellico, traduit de l’italien, avec une introduction, par Antoine de Latour, Paris, Fournier, 1834. * Œuvres dramatiques de Calderon, traduction de M. Antoine De Latour (vol. I e II), 1871. * Œuvres dramatiques de Calderon (II Comédies), 1875. * Don Miguel De Mañara: Sa Vie, Son Discours Sur La Vérité, Son Testament, Sa Profession De Foi, Classic Reprint, 2012. * Mémoires de Victor AlfieriVittorio Alfieri, d’Asti, écrits par lui-même, et traduits de l’italien par Antoine de Latour, Classic Reprint, 2012. * Sainètes de Ramon de la Cruz, Traduits de l’espagnol et précédés d’une introduction par Antoine de Latour, Classic Reprint, 2018.Archives: * Paris, Bibliothèque Nationale * Saluces, Archives historique de la Maire Bibliographie * Jean-Claude Polet, Patrimoine littéraire européen: Index général, De Boeck, 2000, p. 447. Liens internes * Pedro Calderón de la Barca * Silvio Pellico * Vittorio Alfieri * Ramon de la Cruz Liens externes * Sur les liens avec Aloysius Bertrand: [1] * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Catalogne • Bibliothèque apostolique vaticane • WorldCat Portail de la littérature française Portail de la France au XIXe siècle Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Latour


La comtesse Anna-Élisabeth de Noailles, née Bibesco Bassaraba de Brancovan, est une poétesse et une romancière française, d’origine roumaine, née à Paris le 15 novembre 1876 et morte à Paris le 30 avril 1933. Biographie Née à Paris (22 boulevard de La Tour-Maubourg), descendante des familles de boyards Bibescu de Roumanie, elle est la fille d’un expatrié roumain âgé de 50 ans, le prince Grégoire Bibesco Bassaraba de Brancovan lui-même fils du prince valaque Georges Bibesco (en roumain: Gheorghe Bibescu) et de la princesse Zoé Bassaraba de Brancovan (en roumain: Brâncoveanu). Sa mère, plus jeune de 21 ans, est la pianiste grecque née à Constantinople Raluca Moussouros (ou Rachel Musurus), à qui Paderewski a dédié nombre de ses compositions. Sa tante, la princesse Hélène Bibesco, a joué un rôle actif dans la vie artistique parisienne à la fin du XIXe siècle jusqu’à sa mort en 1902. Anna est la cousine germaine des princes Emmanuel et Antoine Bibesco, amis intimes de Proust. Avec son frère aîné Constantin et sa sœur cadette Hélène, Anna de Brancovan mène une vie privilégiée. Elle reçoit son instruction presque entièrement au foyer familial, parle l’anglais et l’allemand en plus du français et a une éducation tournée vers les arts, particulièrement la musique et la poésie. La famille passe l’hiver à Paris et le reste de l’année dans sa propriété, la Villa Bassaraba à Amphion, près d’Évian sur la rive sud du lac Léman. La poésie d’Anna de Noailles portera plus tard témoignage de sa préférence pour la beauté tranquille et l’exubérance de la nature des bords du lac sur l’environnement urbain dans lequel elle devra par la suite passer sa vie. Un rare guéridon au piétement en bois sculpté d’un sphinx ailé (vers 1800) provenant de la collection Antocolsky dispersée en 1906, fut alors acquis par Anna de Noailles pour sa maison d’Amphion, décorée par Emilio Terry, fut exposé par la galerie Camoin Demachy lors de la XIVe biennale des Antiquaires de Paris (reproduit dans Connaissance des Arts no 439, septembre 1988, p. 75). Le 18 août 1897 Anne-Élisabeth, dite Anna, épouse à l’âge de 19 ans le comte Mathieu de Noailles (1873-1942), quatrième fils du septième duc de Noailles. Le couple, qui fait partie de la haute société parisienne de l’époque, aura un fils, le comte Anne Jules (1900-1979). Anna de Noailles fut la muse et entretint une liaison avec Henri Franck normalien et poète patriote proche de Maurice Barrès, frère de Lisette de Brinon et cousin d’Emmanuel Berl, mort de tuberculose à 24 ans en 1912. Elle fut également rendue responsable du suicide, en 1909, du jeune Charles Demange, un neveu de Maurice Barrès qui souffrait pour elle d’une passion qu’elle ne partageait pas. Au début du XXe siècle, son salon de l’avenue Hoche attire l’élite intellectuelle, littéraire et artistique de l’époque parmi lesquels Edmond Rostand, Francis Jammes, Paul Claudel, Colette, André Gide, Maurice Barrès, René Benjamin, Frédéric Mistral, Robert de Montesquiou, Paul Valéry, Jean Cocteau, Léon Daudet, Pierre Loti, Paul Hervieu, l’abbé Mugnier ou encore Max Jacob, Robert Vallery-Radot et François Mauriac. C’est également une amie de Georges Clemenceau. En 1904, avec d’autres femmes, parmi lesquelles Jane Dieulafoy, Julia Daudet, Daniel Lesueur, Séverine et Judith Gautier, fille de Théophile Gautier, elle crée le prix « Vie Heureuse », issu de la revue La Vie heureuse, qui deviendra en 1922 le prix Fémina, récompensant la meilleure œuvre française écrite en prose ou en poésie. Elle en est la présidente la première année, et laisse sa place l’année suivante à Jane Dieulafoy. Elle meurt en 1933 dans son appartement du 40 rue Scheffer (avant 1910, elle habitait au 109 avenue Henri-Martin,) et est inhumée au cimetière du Père-Lachaise à Paris, mais son cœur repose dans l’urne placée au centre du temple du parc de son ancien domaine d’Amphion-les-Bains. Distinctions Elle fut la première femme commandeur de la Légion d’honneur ; la première femme reçue à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (au fauteuil 33 ; lui ont succédé Colette et Cocteau). Elle était aussi membre de l’Académie roumaine. En 1902, elle reçoit le prix Archon-Despérouses. En 1920, son premier recueil de poèmes (Le Cœur innombrable) est couronné par l’Académie française. En 1921, elle en reçoit le Grand prix de littérature. Plus tard, l’Académie française créera un prix en son honneur. Elle a été décorée de l’ordre du Sauveur de Grèce et de Pologne. Œuvre Anna de Noailles a écrit trois romans, une autobiographie et un grand nombre de poèmes. Son lyrisme passionné s’exalte dans une œuvre qui développe, d’une manière très personnelle, les grands thèmes de l’amour, de la nature et de la mort. Romans La Nouvelle Espérance (1903) ; disponible sur Wikisource ; réédition, LGF, coll. « Le Livre de poche" Biblio » no 33578 (2015) (ISBN 978-2-253-02045-5) Le Visage émerveillé (1904) La Domination (1905) disponible sur Gallica ; réédition, LGF, coll. « Le Livre de poche » (2017) Poésie Le Cœur innombrable (1901) disponible sur Gallica L’Ombre des jours (1902) ; réédition en 2011 aux éditions du Livre unique disponible sur Gallica Les Éblouissements (1907) disponible sur la BNR https://ebooks-bnr.com/tag/noailles-anna-de/ Les Vivants et les Morts (1913) disponible sur Gallica De la rive d’Europe à la rive d’Asie (1913) Les Forces éternelles (1920) Les Innocentes, ou la Sagesse des femmes (1923) ; réédition Buchet-Chastel (2009) Poème de l’amour (1924) disponible sur Gallica Passions et Vanités (1926) [lire en ligne] L’Honneur de souffrir (1927) disponible sur Gallica Poèmes d’enfance (1929) Exactitudes (Grasset, 1930) Choix de poésies, Fasquelle (1930) ; réédition avec préface de Jean Rostand de 1960 chez Grasset (1976) Derniers Vers (1933) Autobiographie Le Livre de ma vie (1932) Anthologies posthumes L’Offrande, choix et présentation par Philippe Giraudon, Éditions de la Différence, coll. « Orphée » no 80 (1991) ; réédition en 2012 (ISBN 978-2-7291-1981-2) Anthologie poétique et romanesque: « Je n’étais pas faite pour être morte », LGF, coll. « Le Livre de poche. Classiques » no 32973 (2013) (ISBN 978-2-253-16366-4) Autres publications À Rudyard Kipling (1921) Discours à l’Académie belge (1922) Elle a également écrit la préface du livre du commandant Pierre Weiss, L’Espace (Louis Querelle éditeur, 1929) Témoignages de contemporains « Impossible de rien noter de la conversation. Mme de Noailles parle avec une volubilité prodigieuse ; les phrases se pressent sur ses lèvres, s’y écrasent, s’y confondent ; elle en dit trois, quatre à la fois. Cela fait une très savoureuse compote d’idées, de sensations, d’images, un tutti-frutti accompagné de gestes de mains et de bras, d’yeux surtout qu’elle lance au ciel dans une pâmoison pas trop feinte, mais plutôt trop encouragée. (...) Il faudrait beaucoup se raidir pour ne pas tomber sous le charme de cette extraordinaire poétesse au cerveau bouillant et au sang froid. » —André Gide, Journal, 20 janvier 1910, Gallimard (Folio: Une anthologie), 1951/2012, p. 109-110. « Mme Mathieu de Noailles aime les approbations (...) Elle voudrait la croix, l’Arc de Triomphe, être Napoléon. C’est l’hypertrophie du moi. Elle est le déchaînement. Elle aurait dû vivre à l’époque alexandrine, byzantine. Elle est une fin de race. Elle voudrait être aimée de tous les hommes qui aiment d’autres femmes qu’elle (...) elle aurait dû épouser le soleil, le vent, un élément. » —Abbé Mugnier, Journal, 24 novembre 1908– Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 1985, p. 174 « Achevé le roman: Le Visage émerveillé (...) pour la forme, il y a là du nouveau, des instantanés, et des inattendus. Des sensations qui deviennent des sentiments. Des couleurs, des saveurs, des odeurs prêtées à ce qui n’en avait pas jusqu’ici. Mme de Noailles a renchéri sur Saint-François d’Assise: elle se penche encore plus bas, elle dit au melon blanc: " Vous êtes mon frère", à la framboise, " Vous êtes ma sœur"! Et il y a encore et surtout des joies subites, des désirs qui brûlent, de l’infini dans la limite... » —Abbé Mugnier, Journal, 1er décembre 1910, p. 197 « Le poète des Éblouissements était au lit, dans une chambre sans luxe (...) Une volubilité d’esprit et de paroles qui ne me permettait pas toujours de la suivre (...) Elle m’a dit combien elle aimait Michelet, l’idole préférée, admire Victor Hugo, aime moins Lamartine, admire Voltaire, Rousseau, préfère George Sand à Musset (...) Aujourd’hui, elle n’a plus de vanité (...) Même ses vers les plus lyriques sur le soleil, elle les écrivait avec le désir de la mort. Elle n’était pas joyeuse... Très amusantes anecdotes sur la belle-mère, à Champlâtreux, contées avec un esprit voltairien (...) Elle avait pensé à cette chapelle en écrivant le Visage émerveillé. Elle a écrit sur la Sicile des vers encore inédits (...) à l’intelligence, elle préfère encore la bonté". » —Abbé Mugnier, Journal, 2 décembre 1910, p. 198 et 199 « Elle était plus intelligente, plus malicieuse que personne. Ce poète avait la sagacité psychologique d’un Marcel Proust, l’âpreté d’un Mirbeau, la cruelle netteté d’un Jules Renard. » —Jean Rostand, préface à Choix de poésies d’Anna de Noailles, 1960 « Sacha Guitry admirait infiniment Mme de Noailles, mais qui n’admirait pas Anna de Noailles ? C’était un personnage extraordinaire, qui avait l’air d’un petit perroquet noir toujours en colère, et qui ne laissait jamais placer un mot à personne. Elle recevait dans son lit, les gens se pressaient en foule dans sa ruelle [...] et cela aurait pu être un dialogue étourdissant mais c’était un monologue bien plus étourdissant encore [...] Sacha m’a dit d’elle: quand on l’entend monter l’escalier on a toujours l’impression qu’il y a deux personnes en train de se parler, et quand elle redescend, il semble qu’une foule s’éloigne. » —Hervé Lauwick, Sacha Guitry et les femmes « Elle surgit d’une porte-fenêtre, précédée d’un multitude de cousins multicolores comme dans un ballet russe. Elle avait l’air d’une fée-oiselle condamnée par le maléfice d’un enchanteur à la pénible condition de femme (...). Il me semblait que si j’avais pu prononcer le mot magique, faire le geste prescrit, elle eût, recouvrant son plumage originel, volé tout droit dans l’arbre d’or où elle nichait, sans doute, depuis la création du monde. Puisque c’était impossible, elle parlait. Pour elle seule. Elle parla de la vie, de la mort, les yeux fixés sur Lausanne, moi regardant son profil. Elle ne m’écoutait pas. Il était rare qu’elle le fit. Malheureusement, elle n’avait pas besoin d’écouter pour comprendre. (...). Je reçus tout à coup, en pleine figure, ses énormes yeux, elle rit de toutes ses dents et me dit: "Comment pouvez-vous aimer les jeunes filles, ces petits monstres gros de tout le mal qu’ils feront pendant cinquante ans ? » —Emmanuel Berl, Sylvia, Gallimard, 1952, réédition 1994, p. 89-90 « Octave Mirbeau la ridiculise dans La 628-E8 (passage repris dans la Revue des Lettres et des Arts du 1er mai 1908), la montrant comme une « idole » entourée de « prêtresses »: « Nous avons en France, une femme, une poétesse, qui a des dons merveilleux, une sensibilité abondante et neuve, un jaillissement de source, qui a même un peu de génie… Comme nous serions fiers d’elle!… Comme elle serait émouvante, adorable, si elle pouvait rester une simple femme, et ne point accepter ce rôle burlesque d’idole que lui font jouer tant et de si insupportables petites perruches de salon! Tenez! la voici chez elle, toute blanche, toute vaporeuse, orientale, étendue nonchalamment sur des coussins… Des amies, j’allais dire des prêtresses, l’entourent, extasiées de la regarder et de lui parler. / L’une dit, en balançant une fleur à longue tige: / —Vous êtes plus sublime que Lamartine! / —Oh!… oh!… fait la dame, avec de petits cris d’oiseau effarouché… Lamartine!… C’est trop!… C’est trop! / —Plus triste que Vigny! / —Oh! chérie!… chérie!… Vigny!… Est-ce possible ? / —Plus barbare que Leconte de Lisle… plus mystérieuse que Mæterlinck! / —Taisez-vous!… Taisez-vous! / —Plus universelle que Hugo! / —Hugo!… Hugo!… Hugo!… Ne dites pas ça!… C’est le ciel!… c’est le ciel! / —Plus divine que Beethoven!… / —Non… non… pas Beethoven… Beethoven!… Ah! je vais mourir! / Et, presque pâmée, elle passe ses doigts longs, mols, onduleux, dans la chevelure de la prêtresse qui continue ses litanies, éperdue d’adoration. —Encore! encore!… Dites encore! » » —Octave Mirbeau, La 628-E8, 1907, réédition Éditions du Boucher, 2003, p. 400. L’orientation de ce portrait est reprise par l’ambassadeur de France à Bucarest le comte de Saint-Aulaire, dans ses mémoires qui la montre sans-gêne, prétentieuse et monopolisant la conversation. Charles Maurras fait d’Anna de Noailles l’une des quatre femmes de lettres qu’il prend comme exemplaires du romantisme féminin dont il voit une résurgence à la fin du XIXe siècle, aux côtés de Renée Vivien, Marie de Régnier et Lucie Delarue-Mardrus. Ces qualités sont aussi vantées par les travaux de la critique littéraire antiféministe Marthe Borély. Postérité Les établissements d’enseignement suivants portent son nom: le lycée Anna-de-Noailles à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) ; le collège Anna-de-Noailles à Luzarches (Val-d’Oise) ; le collège Anna-de-Noailles à Noailles (Oise) ; le collège Anna-de-Noailles à Larche (Corrèze) ; une école élémentaire à Barentin (Seine-Maritime). une école élémentaire à Sarcelles (Val-d’Oise). le lycée Anna-de-Noailles à Bucarest, Roumanie. Iconographie Le portrait d’Anna de Noailles par Jean-Louis Forain est conservé au musée Carnavalet. Il lui a été légué par le comte Anne-Jules de Noailles en 1979. Célébrité de son temps, plusieurs peintres de renom de l’époque firent son portrait, comme Antonio de la Gandara, Kees van Dongen, Jacques-Émile Blanche ou Philip Alexius de Laszlo (illustration sur cette page). En 1906, elle fut le modèle d’un buste en marbre par Auguste Rodin, aujourd’hui exposé au Metropolitan Museum of Art à New York ; le modèle en terre glaise, qui lui donne comme un bec d’oiseau, comme le portrait-charge de profil par Sem reproduit sur cette page, est lui exposé au Musée Rodin à Paris. Anna de Noailles avait refusé ce portrait, c’est pourquoi le marbre du Metropolitan porte la mention: « Portrait de Madame X ».[réf. nécessaire]Au cours de l’inauguration du musée Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye, Jean-Claude Brialy demande au sculpteur Cyril de La Patellière la réalisation d’une statue représentant la poétesse d’où sera tiré à part un portrait (2002).[réf. nécessaire]

François Marie Robert-Dutertre (3 juin 1815, Ernée– 15 août 1898) est un écrivain, homme politique libre-penseur français. Biographie Il étudia le droit. Il fut pendant les 17 dernières années de sa vie adjoint d’Ernée .Il a publié, outre une série d’articles dans divers périodiques, différents ouvrages. (voir ci-dessous) Publications Chants composés pour l’orphéon d’Ernée, Fougères, Douchin, s.d., in-8, 14 p. ; Principes généraux d’agriculture, Mayenne, Derenne, 1861, in-8, 59 p. ; Notice sur... le Comice agricole d’Ernée, Mayenne, Derenne, 1862, in-8, 32 p. ; M. le Progrès et Mme la Routine, scénario, mêlé de chants, Mayenne, Derenne, 1864, in-8, 24 p. ; Ensemencements et labours ; Notice sur... comice agricole d’Ernée, Mayenne, Derenne, 1866, in-8, 22 p. ; Loisirs lyriques, Paris, 1866 ; Les angoisses d’un mari sexagénaire, comédie, 1 acte en vers, Laval, Moreau, 1866, in-12, 42 p. ; Les campagnes de Crimée, poème, Laval, Lenormand, 1866, in-8, 12 p. Histoire d’un grain de blé, Laval, Bonnieux, 1875, in-12, 159 p. ; La bonne agriculture rationnellement démontrée, Paris, Marie Blanc, 1877, in-12, 29 p. ; Eloge de Voltaire, poésies, Paris, Marie Blanc, 1877, in-8, 22 p. ; Les bataillons scolaires, poème, Laval, 1884, in-8, 4 p. ; L’article VII et l’instruction des femmes, poème, Laval, imprimerie Jamin, s.d., in 12, 16 p. Voir aussi Les grenouilles de bénitier et les crapauds de sacristie. sur le site: Les Athées d’Ille et Vilaine. Source « François-Marie Robert-Dutertre », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne) Portail de la Mayenne Portail de la littérature française Portail de l’agriculture et l’agronomie Portail de la politique française Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/François-Marie_Robert-Dutertre


Charles Dovalle est un poète français né à Montreui, l-Bellay en 1807 et tué en duel à Paris en 1829. Biographie Descendant d’une longue lignée d’hommes de loi et d’officiers de finances du Saumurois, Charles Dovalle naquit à Montreuil-Bellay le 23 juin 1807. Il fit de brillantes études au collège de Saumur, où il écrivit des poèmes remarqués. Après des études de droit à Poitiers, il partit pour Paris et se lança avec ardeur dans la vie littéraire. Il publia des poésies en forme de chansons, qui figurent toujours dans les manuels de morceaux choisis, comme Bergeronnette, Mon Rêve, Le Curé de Meudon, Le Sylphe... Obligé de se consacrer à des travaux de jurisprudence, tout en écrivant dans Le Figaro, il devint rédacteur au Journal des Salons. Le jeune homme, qui habitait alors rue de la Harpe, n’en continuait pas moins à se consacrer à la poésie. Malheureusement, sa carrière devait être interrompue prématurément par une mort tragique à l’âge de 22 ans. Critique théâtral, il commit un calembour facile sur Mira, le directeur du théâtre des Variétés, qui lui avait refusé l’entrée de son établissement. Il écrivit dans Le Lutin: «Mira peut être Mira-sévère, mais il ne sera jamais Mira-beau». Ce dernier, qui était laid et vindicatif, le provoqua en duel. Blessé à l’épaule à la suite d’un premier assaut à l’épée, il exigea contre toutes les règles que le duel se poursuive au pistolet; au troisième échange, le pauvre Dovalle fut touché, après que la balle eut traversé son portefeuille, et mourut le 30 novembre 1829. Une colonne de marbre blanc fut érigée sur sa tombe dans le cimetière de Montmartre,. L’édition complète de ses œuvres, Le Sylphe, Poésies de feu Charles Dovalle, parut à Paris aux éditions Ladvocat, Palais-Royal, en 1830, avec une préface de Victor Hugo. Bibliographie Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, t.1, Ch.Delagrave, 1876, p. 831 Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Dovalle


Manuel José Quintana y Lorenzo (Madrid; 11 de abril de 1772 - ídem; 11 de marzo de 1857), poeta español de la Ilustración y una de las figuras más importantes en la etapa de transición al Romanticismo. Hijo de padres extremeños, estudió en Madrid primeras letras y después latinidad en Córdoba con Manuel de Salas. Después vuelve a Madrid, donde ya el 14 de julio de 1787 recita una oda en la Academia de San Fernando. Pasó a estudiar Derecho en Salamanca, donde se llevó muy bien con el rector liberal Diego Muñoz-Torrero, pero no con quien le sucedió, Tejerizo, quien lo expulsó en 1793, aunque fue readmitido al año siguiente. Sus maestros salmantinos, en derecho y poesía, fueron los neoclásicos Juan Meléndez Valdés, Pedro Estala, Nicasio Álvarez de Cienfuegos y Gaspar Melchor de Jovellanos.


Alexis-Félix Arvers, né le 23 juillet 1806 à Paris et mort le 7 novembre 1850 à la maison municipale de santé Dubois à Paris est un poète et dramaturge français, célèbre pour son Sonnet, l'une des pièces poétiques les plus populaires de son siècle. Biographie Il était le fils d'un marchand de vins de la ville de Cézy dans l'Yonne, où résidait sa famille. Étudiant en droit avant de devenir clerc de notaire, il poursuivait pourtant déjà ardemment le désir de se faire écrivain. Cédant un jour radicalement à ce qu'il croyait être sa vocation, il parvint à faire jouer une douzaine de comédies légères, le genre de comédies dont raffolait le public petit-bourgeois de Paris (cf. Octave Feuillet). Ces larges succès lui permirent de mener une existence « de dandy », familier des boulevards et des coulisses des petits théâtres, et il se mit à fréquenter le Cénacle de l'Arsenal, fréquentant notamment Alfred Tattet et Alfred de Musset, dont il semble avoir été très proche. À quarante-quatre ans, il décéda d'une maladie de la moelle épinière, pauvre et oublié. L'oubli dans lequel ont plongé ses pièces, pourtant fameuses en leur temps, n'est pas sans rappeler le destin des tragédies de Voltaire. Il publia un recueil de poèmes intitulé Mes Heures perdues (1833). Perdues surtout, a-t-on fait remarquer, pour son employeur, Mr Marcelin-Benjamin Guyet-Desfontaines, notaire, chez qui il avait débuté en qualité de sixième clerc ; mais cet excellent homme, ami des belles-lettres et des poètes romantiques, savait fermer les yeux. Il est enterré à Cézy Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Félix_Arvers


Leconte de Lisle est un poète français, né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul sur l’île de la Réunion et mort le 17 juillet 1894 à Voisins (Louveciennes). Leconte de Lisle est le vrai nom de famille du poète. Il l’adopta comme nom de plume, sans mentionner ses prénoms (Charles Marie René), et ce choix a été repris dans les éditions de ses œuvres, dans sa correspondance, ainsi que dans la plupart des ouvrages qui lui sont consacrés et dans les anthologies. C’est ce nom qui est utilisé dans la suite de l’article. Son prénom usuel, utilisé par ses proches, était « Charles ». Leconte de Lisle passa son enfance à l’île de la Réunion et en Bretagne. En 1845, il se fixa à Paris. Après quelques velléités d’action politique lors des événements de 1848, il y renonça et se consacra entièrement à la poésie. Son œuvre est dominée par trois recueils de poésie, Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884), ainsi que par ses traductions d’auteurs anciens: Homère, Hésiode, les tragiques grecs (Eschyle, Sophocle, Euripide), Théocrite, Biôn, Moskhos, Tyrtée, Horace, etc. Il est considéré comme le chef de file du mouvement parnassien ou tout au moins comme le maître des jeunes poètes de cette école, autant par l’autorité que lui a conférée son œuvre poétique propre que par des préfaces dans lesquelles il a exprimé un certain nombre de principes auxquels se sont ralliés les poètes d’une génération—entre la période romantique et le symbolisme—regroupés sous le terme de parnassiens à partir de 1866. L’Empire lui assura une pension et le décora. La République l’attacha à la bibliothèque du Sénat, dont il devint sous-bibliothécaire en 1872, et le nomma officier de la Légion d’honneur en 1883. En 1886, neuf ans après une candidature infructueuse à l’Académie française, où il n’eut que les voix de Victor Hugo et d’Auguste Barbier, Leconte de Lisle fut élu, succédant à Victor Hugo. Il y fut reçu par Alexandre Dumas fils le 31 mars 1887. Idées Idées littéraires Le choix de certains thèmes et leur traitement par Leconte de Lisle le relient au romantisme, notamment: la description de la nature sauvage (couleur, exotisme, animaux, …), les sujets historiques et mythologiques, le goût de la liberté dans la fantaisie, l’énergie. Mais, amplifiant l’impulsion donnée par Théophile Gautier avec son culte de l’Art pour l’Art et par Théodore de Banville, Leconte de Lisle rompt avec ce mouvement et défend une doctrine nouvelle—celle qui va servir de modèle aux parnassiens—caractérisée par quelques principes: la poésie doit rester impersonnelle (le poète ne doit pas chanter son ego) ; le poète doit privilégier le travail de la forme plutôt que se laisser aller à sa seule inspiration débridée ; il doit viser la beauté, dont l’antiquité (grecque, hindoue, nordique, etc.) fournit les modèles absolus ; par opposition aux sentiments, la science, guidée par la raison, constitue un champ d’expression infini ; le poète ne doit pas s’impliquer dans la vie moderne. Idées philosophiques [Cette section est un extrait de J. Calvet, Manuel illustré d’histoire de la littérature française, J. de Gigord, 13e édition, 1946, p. 715.] À l’Antiquité grecque et à l’Inde, Leconte de Lisle ne demandait pas seulement des mythes pour ses rêves et des images pour sa poésie: il y cherchait aussi des idées. Voué au culte de la Beauté, il estime qu’elle n’a été aimée et réalisée que par le paganisme grec et que le christianisme en a détruit le culte. De là cette haine contre l’Église, les papes et les rois, dont il emprunte l’expression, en l’amplifiant, à Victor Hugo et à Flaubert. Pour le monde moderne, fermé au sens de la beauté, il n’a pas assez de sarcasmes. Ne trouvant partout que déception et douleur, il va chercher dans l’Inde la philosophie consolatrice: c’est le nirvana, l’écoulement et l’anéantissement de l’être ; tout est vain, tout est illusion, même la vie, il n’y a qu’une réalité, le calme du néant où la mort nous précipitera en nous guérissant de la fièvre d’avoir été. La poésie est une distraction, et elle nous prépare à accepter et à souhaiter le néant. Biographie Discours de Jean Mistler [Cette section reprend une grande partie d’un discours prononcé par Jean Mistler à la Bibliothèque nationale, le 23 septembre 1977.] Il naquit à Saint-Paul en 1818, et cette île berça son enfance sous ses palmiers peuplés d’oiseaux éclatants. Son paysage intérieur a été formé de ces images, de ces couleurs, de ces parfums. En écrivant ses poèmes bibliques, il n’a eu nul besoin de puiser dans les récits de la Genèse pour évoquer le paradis terrestre, il lui a suffi de se souvenir. Leconte de Lisle avait trente ans lorsque la Révolution de 1848 apporta la liberté aux esclaves. Sans attendre cette date, il avait combattu le servage dans ses premiers écrits, notamment dans les deux nouvelles publiées vers 1845: l’une montrait le Noir Job amoureux de la créole Marcie, et l’autre, un esclave, Sacatove, qui enlevait sa jeune maîtresse. Ces deux récits finissaient dans le sang et de manière un peu mélodramatique, mais ils montrent que le problème de l’égalité des hommes se posait déjà fortement pour le jeune écrivain. Cette libération des esclaves, répondant à son idéal de justice, posa cependant de difficiles problèmes pour son père et pour lui. Réalisée peut-être après une préparation insuffisante, la réforme fut suivie, à la Réunion, d’une grave crise économique, sa famille fut ruinée et la pension que le jeune étudiant parisien recevait n’arriva plus qu’irrégulièrement, puis cessa tout à fait, et ce fut pour lui la misère. Le groupe d’artistes décrit par Henry Murger dans sa Vie de Bohème ne fut pas le seul, dans le Paris de 1850, à vivre d’expédients! Des enfants des Îles, amis de notre poète et poètes eux-mêmes, ou journalistes, tels que Lacaussade et Laverdan, d’autres nés à Paris, Thalès Bernard, Louis Ménard, connurent comme lui, non seulement des fins de mois difficiles, mais des mois entiers d’expédients et de privations, les cachets impayés à la pension Laveur en retard chez les logeuses et une liberté s’alimentant au pain et à l’eau, comme dans les prisons. Un cousin de Leconte de Lisle, Foucque, qui est riche, ne lui donne point d’argent, mais des conseils: « Tu rimes facilement, pourquoi n’écrirais-tu pas des chansons pour Thérésa ? » Écrire, oui, le jeune homme écrira, mais pas pour les chanteuses de cafés-concerts! Ses amis et lui-même visent plus haut: Lacaussade achève une traduction d’Ossian, Thalès Bernard travaille à un savant Dictionnaire de la mythologie, Louis Ménard, qui gagne à peu près convenablement sa vie comme préparateur au laboratoire du chimiste Pelouze (et qui, par parenthèse, y découvrira un jour le collodion), se plonge dans l’exégèse des religions et des mythes et étudie les textes symboliques de la vieille Égypte. Les bourgeois peuvent bien rire en voyant Ménard se promener au Luxembourg, portant autour du cou un boa de plumes passablement dépenaillé, mais le soir, lorsque les amis se retrouvent, au cinquième étage de Leconte de Lisle, sans feu, autour d’une chandelle de suif qui pleure sur la table, dans l’épaisse fumée des pipes, ils évoquent les ciels lumineux de l’Orient, les marbres de la Grèce, et ce sont déjà les rêves mystiques et païens que fera revivre un jour Louis Ménard. La politique ? Oui, ils en font beaucoup et ils ont applaudi à la chute du roi citoyen. Ils sont affiliés à des clubs d’extrême gauche et Leconte de Lisle sera même chargé d’une campagne électorale, dans les Côtes-du-Nord, par le Club des clubs, sorte de centrale des groupements extrémistes: ce voyage ne lui vaudra que quelques horions. Il n’y a pas grand-chose non plus à retenir de sa collaboration à La Démocratie pacifique ou à d’autres organes plus ou moins fouriéristes. Retenons simplement—conclusion prévisible—l’échec du jeune homme à la licence en droit. Quant à croire qu’il fit vraiment le coup de feu pendant les journées de juin et qu’il alla, comme on l’a raconté, laver dans la Seine « sa figure noire de poudre », j’en doute un peu: les gardes nationales avaient la détente facile ces soirs-là, et je pense que, s’il coucha une nuit ou deux au poste, ce fut tout. En tout cas, de cette période de bouillonnement intellectuel, Leconte de Lisle garda des opinions farouchement républicaines qui ne se calmèrent un peu qu’au spectacle de la Commune en 1871. Du moins, ce qui ne devait point pâlir, ce fut son anticléricalisme. Le poète descendit de sa tour d’ivoire—entendez le cinquième du boulevard des Invalides, ou, plus tard, le quatrième de la rue Cassette—pour rédiger un Catéchisme populaire républicain en trente-deux pages, et ensuite une Histoire populaire du christianisme, qui furent ses deux plus grands succès de librairie, mais n’ajoutent rien à Qaïn ou à Hypathie. Né dans toute l’Europe du bouleversement politique et social qui avait renversé tant de trônes et d’institutions, le romantisme prétendait apporter du nouveau, non seulement dans les arts et les lettres, mais aussi dans les idées et dans les mœurs. Le Parnasse eut des ambitions plus étroitement littéraires. Arrivant à un moment de notre histoire où s’étaient succédé, en soixante ans, sept ou huit régimes politiques, et groupant des hommes plus âgés de quinze à vingt ans que les jeunes chevelus du Cénacle, les Parnassiens cherchaient moins à régenter et à formuler des théories qu’à donner des exemples. Ils ne fondèrent pas une revue, comme avait été jadis la Muse française, mais ils publièrent un recueil collectif de poésie, le Parnasse contemporain, un in-octavo qui parut trois fois: en 1866, sur deux cent quatre-vingt-quatre pages, en 1869, sur quatre cent une, enfin en 1876, sur quatre cent cinquante et une. Cette dernière édition groupait soixante-neuf poètes. L’ordre alphabétique n’y était troublé que par la contribution de Jean Aicard qui, parvenue trop tard, fut rejetée à la fin. Dans les trois éditions, on retrouvait tous les noms connus, et même plusieurs inconnus. De Baudelaire à Verlaine et Catulle Mendès (dont il existe depuis peu une biographie téléchargeable sur Amazon) à Mallarmé, tous les poètes étaient là sauf le plus grand. Certes Hugo était en exil en 1866, lorsque parut le premier Parnasse, mais ses livres étaient publiés en France sans entrave. Ne fut-il donc pas sollicité ? On a peine à le croire, mais encore plus de peine à supposer qu’il aurait refusé. Les contributions étaient aussi inégales en qualité qu’en étendue: vingt-six sonnets de Heredia, vingt-quatre rondeaux de Banville, un acte d’Anatole France, les Noces corinthiennes, un énorme poème de Leconte de Lisle, l’Épopée du moine. Leconte de Lisle, à qui la responsabilité des choix n’incombait point, jugeait l’ensemble sans indulgence, et voici ce qu’il en disait, dans une lettre du 19 janvier 1875 à Heredia: « Ce que je connais des rimes envoyées est assez misérable, celles de Prudhomme, de Manuel, de Mme Ackermann, de Mme Blanchecotte et de Soulary sont écœurantes. En outre, on a donné à Lemerre une poésie de Baudelaire, et absolument authentique, quoi qu’en disent quelques-uns, attendu qu’il me l’a récitée lui-même, il y a bien des années. Ces vers sont fort obscènes et non des meilleurs qu’il ait faits. » Tout ce que je sais de ce poème, c’est qu’il ne devait point figurer dans le volume paru en 1876. Tel quel, le Parnasse contemporain fut ce qu’on appelle aujourd’hui une manifestation de masse. Son effet se prolongea longtemps après la mort de ses principaux participants, et l’Université ne fut pas étrangère à sa durée: elle retrouvait en effet chez Leconte de Lisle, et même chez Heredia, le solide héritage de la tradition gréco-latine et des poètes qui, tels Ronsard ou Chénier, avaient su la faire revivre sur le terroir français. Reconnu chef d’école, Leconte de Lisle devait, assez naturellement, penser à l’Académie. Il ne se hâta pourtant pas et s’y présenta pour la première fois qu’à près de soixante ans. […] La modeste indemnité académique—quinze cents francs à l’époque, mais des francs-or—n’eût cependant pas été à dédaigner pour l’auteur des Poèmes barbares, dont la situation matérielle était très difficile. Marié depuis trente ans avec une jeune orpheline rencontrée jadis chez les Jobbé-Duval, il menait la vie la plus simple: la pauvreté en redingote. Ses droits d’auteur étaient insignifiants et les articles qu’il donnait de temps en temps dans la presse, fort mal payés. Le Conseil général de la Réunion lui versait une petite subvention, mais elle fut supprimée en 1869. Le gouvernement impérial, désireux d’encourager la littérature, avait accordé au poète, à partir de 1863, une pension annuelle de 3 600 francs. Les anciens rois de France avaient octroyé de telles faveurs à plusieurs écrivains et les souverains du XIXe siècle avaient repris cette tradition. Mais, après le 4 septembre, cette allocation fut retirée et on la reprocha durement à Leconte de Lisle. L’intervention de quelques amis fit obtenir au poète une modeste sinécure, un poste de conservateur-adjoint à la bibliothèque du Sénat. Son caractère ombrageux prit fort mal la chose et il écrivit à Heredia: « Ce n’est au fond qu’une insulte de plus ajoutée à toutes celles que j’ai déjà endurées. » Cependant, l’agréable appartement de fonction attaché à cette place, avec ses fenêtres sur le jardin du Luxembourg, lui fit un certain plaisir. Chaque année, il allait au bord de la mer, en Normandie ou en Bretagne, soit dans un modeste meublé, soit chez des amis. Mais il se plaignait souvent de la chaleur excessive! Au Puis, près de Dieppe, par exemple, en septembre 1891, il se réjouit de voir arriver « de copieuses ondées qui rafraîchissent l’air et de bons vieux nuages assez noirs qui obscurcissent l’atroce sérénité du ciel ». Mais après cette « atroce sérénité », il enchaîne, peut-être en souriant sous cape: « J’aurais dû naître ou vivre au fond de quelque fjord de Norvège, dans un perpétuel brouillard, en compagnie des phoques dont je partage les goûts et les mœurs, n’ayant jamais su lire ni écrire et fumant d’éternelles pipes en l’honneur des Dieux Norses. » Malgré tout, ses amis, et notamment le fidèle Heredia, lui conseillent toujours de se présenter à l’Académie. Le 9 août 1883, répondant sans doute à une lettre particulièrement pressante, il écrivait à Heredia cette curieuse page qui nous introduit dans le cercle de Victor Hugo: « Quant à l’Académie, j’y renonce absolument, sauf dans le cas où Hugo mourrait avant moi… » […] Cependant, Hugo meurt le 22 mai 1885, et alors, à l’élection du 11 février 1886, brusque changement à vue: dès le premier tour, Leconte de Lisle est élu, par vingt et une voix contre six à Ferdinand Fabre, le romancier des gens d’église! François Coppée eut ce commentaire: « Leconte de Lisle répandra à l’Académie sa noire méchanceté, comme la seiche dans les flots de la mer. » Si c’est être méchant que d’être juste, je dois à la vérité de dire que l’auteur des Poèmes barbares a porté sur Coppée plus d’un jugement où la justice tient davantage de place que l’indulgence. Il fit pour sa réception un consciencieux éloge de Hugo et, dans sa réponse, Alexandre Dumas fils ne dépassa point l’esthétique du Demi-monde et de la Dame aux camélias. Les Goncourt, qui assistaient à la séance, notèrent dans leur Journal que, pendant les discours, Coppée regarda beaucoup en l’air, vers la Coupole… La fin de la vie de Leconte de Lisle fut sans grands événements extérieurs. Il ne mourut point en pleine jeunesse, comme Chénier, Nerval, Apollinaire, il n’atteignit pas non plus l’âge des patriarches, mais c’est dans ses dernières années qu’il connut le plus profondément les joies et les tortures de l’amour, et cet homme qui avait fait de l’impassibilité le premier article de son art poétique, écrivit: Amour, tu peux mourir, ô lumière des âmes, Car ton rapide éclair contient l’Éternité.Il s’éteignit le 17 juillet 1894, en pleine lucidité. […] Au lendemain de sa mort, un poète écrivait que Leconte de Lisle « avait rendu leurs anciens noms aux dieux ». Oui, mais il ne s’est pas borné à ceux de la Grèce et de Rome, à ceux du Parthénon et du temple d’Égine. Son horizon ne s’est point limité à la Méditerranée classique, il y a fait entrer les vents et les nuages de tous les ciels, les houles de tous les océans. Dans cette poésie cosmique, l’histoire est présente. Oui, le même vaisseau qui emporta Hélène est toujours paré pour emporter nos rêves. Là-bas, vers ce point de l’horizon marin d’où sans cesse, depuis Eschyle, accourt l’innombrable troupeau des vagues rieuses. Galerie Portraits Monuments Chronologie Œuvres Poésie * L’apport littéraire essentiel de Leconte de Lisle est constitué par les trois recueils de poésie qu’il a destinés à la publication, tels que mentionnés dans le tableau suivant. Compte tenu du nombre d’éditions et d’évolutions que ces recueils ont connues de son vivant, ce tableau précise pour chacun d’eux les éditions les plus significatives: * la première édition, en raison du rôle qu’elle a joué dans l’histoire littéraire ; * la dernière édition composée par lui, appelée de ce fait « édition de référence ».En dehors de ces trois recueils, il existe des poèmes, publiés de son vivant ou pas, qui ont fait l’objet de deux recueils posthumes dans la décennie qui a suivi sa disparition: * Pendant près d’un siècle et demi, la structure adoptée pour la publication des poésies complètes de Leconte de Lisle a été celle de l’éditeur Alphonse Lemerre, en quatre volumes, constitués entre 1872 et 1895: Poèmes antiques, Poèmes barbares, Poèmes tragiques, Derniers Poèmes. * En 2011, Edgard Pich, dans son édition critique nouvelle, a mis en évidence qu’entre 1837 et 1847, Leconte de Lisle avait constitué sans les publier quatre recueils de poésie: Essais poétiques de Ch. Leconte de Lisle ; Cœur et âme ; Odes à la France ; Hypatie. * Les poèmes de Leconte de Lisle sont sur wikisource. Liste des œuvres * Outre la poésie qui constitue l’essentiel de son œuvre, Leconte de Lisle a écrit des pièces de théâtre, des traductions d’auteurs anciens, des manifestes, des récits en prose, des œuvres polémiques, des notices, des discours, des préfaces, des pétitions. La liste suivante répartit les œuvres connues de Leconte de Lisle selon ces catégories et, à l’intérieur de chaque catégorie, les range par ordre chronologique de publication. Pour certaines œuvres, les dates des rééditions parues avant 1900 sont aussi mentionnées. Une partie importante des œuvres est disponible sur wikisource. * Les deux œuvres suivantes sont mentionnées séparément, car elles posent problème: * 1854. Épître au Czar, au sujet des lieux saints adressée à S. M. Nicolas Ier, par Le Cte de Lisle, Paris, chez Ledoyen, in-8, IX-63 p. Cette œuvre est attribuée à Leconte de Lisle dans l’ouvrage collectif Le premier siècle de l’Institut de France, sous la direction du comte de Franqueville (1895). En réalité, ce comte de Lisle a écrit, p. 30 de son œuvre, qu’il était « propriétaire et rédacteur en chef du journal La France, qu’il avait fondé dans les intérêts monarchiques et religieux de l’Europe ». Il n’a donc rien à voir avec le poète. * 1873. Grand Dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas. La contribution de Leconte de Lisle est inconnue. En mars 1870, Dumas remet son manuscrit à l’éditeur Alphonse Lemerre. Il ne le verra pas publié: il meurt le 5 décembre de la même année. Après la guerre et la Commune, Lemerre confie à Leconte de Lisle et au jeune Anatole France la direction éditoriale de l’ouvrage, qui paraît en 1873. Ce sont d’ailleurs vraisemblablement ces deux écrivains qui ont signé L.T. l’avant-propos « Alexandre Dumas et le Grand Dictionnaire de cuisine », L. pour Leconte de Lisle et T. pour Thibault, le vrai nom de France. À l’appui supplémentaire de cette hypothèse, l’hommage appuyé à Baudelaire, qu’admiraient tant les poètes parnassiens. On doit peut-être à Leconte de Lisle la part importante qui y est donnée aux épices et aux recettes exotiques. Articles * Esquisses littéraires. Article premier. Hoffmann. De la satire fantastique, « La Variété », deuxième livraison, mai 1840, p. 44-49 ; texte sur wikisource. * George Sand. Cosima, « La Variété », deuxième livraison, mai 1840, p. 58-60 ; texte sur wikisource. * Esquisses littéraires. Article deuxième. Sheridan. De l’art comique en Angleterre, « La Variété », troisième livraison, juin 1840, p. 66-72 ; texte sur wikisource. * Esquisses littéraires. Article troisième. André Chénier. De la poésie lyrique à la fin du XVIIIe siècle, « La Variété », cinquième livraison, août 1840, p. 129-135 ; texte sur wikisource. * Revue mensuelle. Toussaint Louverture. Romans et nouvelles. Poésies. Une revue critique, « La Variété », cinquième livraison, août 1840, p. 159-160 ; texte sur wikisource. * Revue mensuelle. Revue parisienne. Romans. Poésie de Lacenaire. M. Alexandre Dumas, « La Variété », septième livraison, octobre 1840, p. 190-192 ; texte sur wikisource. * Revue dramatique. Vaudeville. Les Fleurs animées.—Gymnase. Les Quatre Reines.—Palais Royal. Mon Voisin d’omnibus, « La Démocratie pacifique », 21 juillet 1846 ; texte sur wikisource. * Les Femmes de Byron, « La Phalange », t. IV, septembre 1846, p. 184-188 ; texte sur wikisource. * Théâtre-Français. Don Gusman ou la Journée d’un séducteur, comédie en cinq actes et en vers par M. Adrien de Courcelles, « La Phalange », t. IV, octobre 1846, p. 383 ; texte sur wikisource. * La Justice et le Droit, « La Démocratie pacifique », 25 octobre 1846, p. 1 ; texte sur wikisource. * Un dernier attentat contre la Pologne!, « La Démocratie pacifique », t. VII, no 122, 22 novembre 1846 ; texte sur wikisource. * L’Oppression et l’Indigence, « La Démocratie pacifique », 29 novembre 1846 ; texte sur wikisource. Correspondance Répertoires * La correspondance de Leconte de Lisle a fait l’objet de répertoires: * Irving Putter, La dernière illusion de Leconte de Lisle, Librairie Droz– Genève, 1968, appendice A, p. 166-170. Il s’agit d’un répertoire des principaux ouvrages contenant des lettres de Leconte de Lisle. * Œuvres de Leconte de Lisle, édition critique par Edgard Pich, IV, Œuvres diverses, Société d’édition « Les Belles Lettres », 1978, p. 576-596. Sélection d’ouvrages * 1902. Lettres à Julien Rouffet ; Texte sur wikisource * 1968. Lettres à Émilie Leforestier * 1894. Lettres à Jules Huret, à l’occasion du différend de Leconte de Lisle avec Anatole France en 1891 ; les lettres figurent en appendice de: Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1894, p. 439-442 ; texte sur wikisource * 1927. Lettre à Gustave Flaubert. * 1933. Lettres échangées avec Jean Marras * 2004. Correspondance entre Leconte de Lisle et Franz Servais * 2004. Lettres à José-Maria de Heredia Entrevues * Le Télégraphe, 8 juin 1885, La succession de Victor Hugo à l’Académie Française. Chez M. Leconte de Lisle. * Le Matin, 15 février 1886, Leconte de Lisle ; Texte sur Gallica * Gazette anecdotique, 31 octobre 1888, p. 235, [Shakespeare] * L’Écho de Paris, 29 avril 1891, Enquête sur l’évolution littéraire, article signé Jules Huret, p. 2 ; journal sur Gallica ; article repris dans Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1894, p. 278-286 ; texte sur wikisource * Le Journal, 30 septembre 1892, Une statue à Baudelaire– Chez M. Leconte de Lisle. * Le Rappel, 5 janvier 1893, Chez M. Leconte de Lisle—La santé du poète—Au dîner celtique—Les chances de M. Zola—Les décadents. Article signé Noël Amaudru. texte de l’article sur Gallica. * Le Gaulois, 20 mars 1893, Interview-Express ; texte sur Gallica * L’Éclair, 21 janvier 1894, Le sort d’une tête– Comment devrait être composée la commission des grâces. Sources Éditions modernes des œuvres de Leconte de Lisle * Les éditions des œuvres ou poésies complètes sont, selon l’ordre chronologique inverse de leur publication: * 2011-2015. Leconte de Lisle, Œuvres complètes, édition critique par Edgard Pich, collection « Textes de littérature moderne et contemporaine », Paris, Honoré Champion éditeur, en cinq tomes, n’incluant pas les traductions. Les tomes I à IV sont reliés et le tome V est broché: * Tome I: L’Œuvre romantique (1837-1847), 2011. (ISBN 978-2-7453-2157-2) * Tome II: Poèmes antiques (1837-1848), 2011. (ISBN 978-2-7453-2238-8) * Tome III: Poèmes barbares, 2012. (ISBN 978-2-7453-2399-6) * Tome IV: Poèmes tragiques, Les Érinnyes, Derniers Poèmes, L’Apollonide, 2014. (ISBN 978-2-7453-2631-7) * Tome V: Œuvres en prose (1852-1894), 2015. (ISBN 978-2-7453-2835-9) * 2011. Leconte de Lisle, Œuvres complètes, édition critique publiée par Vincent Vivès, Classiques Garnier, collection « Bibliothèque du XIXe siècle » sous la direction de Pierre Glaudes et Paolo Tortonese, no 11, série Leconte de Lisle dirigée par Didier Alexandre, en onze tomes, incluant les traductions: * Tome I: Poèmes antiques, 2011. (ISBN 978-2-8124-0304-0) * Tome II à XI: à paraître ? (Le projet semble avoir été abandonné.) * 1976-1978. Œuvres de Leconte de Lisle, édition critique par Edgard Pich, publiée par la Société d’édition « Les Belles Lettres », en quatre tomes: * Tome I: Poèmes antiques, 1977. * Tome II: Poèmes barbares, 1976. * Tome III: Poèmes tragiques– Derniers Poèmes, 1977. * Tome IV: Œuvres diverses, 1978.Pour compléter cette édition, signalons qu’Edgard Pich avait déjà rassemblé un certain nombre de textes de Leconte de Lisle: * Articles, Préfaces. Discours, textes recueillis, présentés et annotés par Edgard Pich, Les Belles Lettres, 1971. * 1927-1928. Poésies complètes de Leconte de Lisle, texte définitif avec notes et variantes [de Jacques Madeleine et Eugène Vallée, mentionnés tome IV, p. 228], eaux-fortes de Maurice de Becque, Lemerre, en quatre tomes: * Tome I: Poèmes antiques, 1927. * Tome II: Poèmes barbares, 1927. * Tome III: Poèmes tragiques. – Les Érinnyes. – L’Apollonide, 1928. * Tome IV: Derniers poèmes, La Passion, Pièces diverses, Notes et variantes, 1928.En format de poche, il existe une édition de deux recueils, présentée, établie et annotée par Claudine Gothot-Mersch, Gallimard, collection « Poésie »: * 1985. Poèmes barbares, collection « Poésie » no 202 ; * 1994. Poèmes antiques, collection « Poésie » no 279.Depuis 2000: * 2001, éditions Paléo: Homère: Hymnes, La Batrakhomyomakhie, Épigrammes. * 2007, éditions Omnibus: Mourir pour Troie, Eschyle, Sophocle, Euripide. Édition établie par Annie Collognat-Barès. * 2009, éditions Bibliobazaar: Poèmes Barbares ; Poèmes Tragiques ; Catéchisme populaire républicain. * 2009, éditions Kessinger Publishing: Catéchisme populaire républicain ; Le Sacre de Paris ; Homère: Odyssée ; Eschyle ; Histoire populaire du Christianisme. * 2009, éditions Pocket classiques: Homère: Odyssée, préface de Paul Wathelet ; Homère: Iliade, préface d’Odile Mortier-Waldschmidt, commentaires d’Annie Collognat-Barès. * 2010, éditions Bibliobazaar: Poëmes et poésies ; Discours de réception de Leconte de Lisle et réponse d’Alexandre Dumas fils. * 2010, éditions Kessinger Publishing: Premières poésies et lettres intimes * 2010, éditions Nabu Press: Poèmes antiques ; Poèmes barbares ; Poèmes tragiques ; Derniers Poèmes. La Passion. L’Apollonide. Poètes contemporains ; Euripide ; Homère: Odyssée ; Catéchisme populaire républicain ; Discours de réception à l’Académie française ; Sophocle ; Poèmes et poésies ; Idylles de Théocrite et Odes anacréontiques ; Histoire populaire de la Révolution française ; Eschyle ; Le Sacre de Paris. Ouvrages sur la vie de Leconte de Lisle Témoignages directs * Théodore de Banville, Camées parisiens, troisième et dernière série, « Petite bibliothèque des curieux », Paris, chez René Pincebourde, 1873 ; quatrième douzaine, ch. I, Leconte de Lisle, p. 115. Texte sur wikisource * Léon Barracand: * Leconte de Lisle, Revue bleue, 28 juillet 1894, p. 97-101. Texte sur wikisource * Souvenirs d’un homme de lettres, in Revue des deux mondes, 15 août et 1er septembre 1937. Texte sur wikisource * Jules Breton, Un peintre paysan, Alphonse Lemerre, 1896, p. 187-196 ; texte sur wikisource. * Léon Daudet, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux, Nouvelle Librairie Nationale, 1920, pages 54-56. texte sur wikisource. * Jean Dornis * Leconte de Lisle intime, 1895 ; texte sur wikisource * Essai sur Leconte de Lisle, 1909 ; texte sur wikisource * Henry Houssaye, Discours de réception à l’Académie française, avec l’éloge de Leconte de Lisle, prononcé le 12 décembre 1895. Texte sur wikisource * José Maria de Heredia, Léon Bourgeois, Sully Prudhomme, etc., Discours prononcés et poème lu lors de l’inauguration du monument de Denys Puech érigé « à Leconte de Lisle » au jardin du Luxembourg, le 10 juillet 1898, Le Temps, 11 juillet 1898 ; texte sur Gallica * Jacques-Vincent, Un salon parisien d’avant-guerre, Éditions Jules Tallandier, 1929, ch. 1 à 3, Période: 1892-1894. * Jules Massenet, Mes souvenirs, 1848-1912, Pierre Lafitte & Cie, 1912, chapitre IX, Au lendemain de la guerre. Texte sur wikisource. * Jean Moréas, Feuillets, Éditions de la Plume, 1902, ch. I, « Leconte de Lisle », p. 7-13. Texte sur IA * Adolphe Racot, Portraits d’aujourd’hui, À la librairie illustrée, 1887 ; ch. Leconte de Lisle, p. 113-124. Texte sur Gallica * Henri de Régnier * Portraits et souvenirs, Mercure de France, 1913, chapitre « Au Luxembourg », p. 51-59. texte sur IA * Proses datées, Mercure de France, 1925, ch. 1, p. 5-20. * Nos rencontres, Mercure de France, 1931, chapitre « Louis Ménard et Leconte de Lisle », p. 215-228 ; texte sur Gallica. * Louis Tiercelin, Bretons de Lettres, Honoré Champion, 1905 ; ch. 1 « Leconte de Lisle étudiant (1837-1843) », p. 1-158. Texte sur wikisource * Paul Verlaine, Souvenirs sur Leconte de Lisle, Le Journal, 20 juillet 1894. * Henri Welschinger, Leconte de Lisle bibliothécaire, Journal des débats, 16 août 1910 ; Texte sur wikisource. Autres documents * Marius-Ary Leblond, Leconte de Lisle, essai sur le génie créole, Mercure de France, 1906. Texte sur wikisource * Fernand Calmettes, Un demi-siècle littéraire, Leconte de Lisle et ses amis, Plon, s.d. Texte sur wikisource * Edmond Estève, Leconte de Lisle, l’homme et l’œuvre, Boivin & Cie, s.d. ; Texte sur wikisource * Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857, Gallimard, 1972, éd. revue et complétée 1988, tome 3, livre I. La névrose objective, 5. Névrose et prophétie, p. 338-440. * Jean Mistler, Sous la Coupole, Bernard Grasset, 1981. Le chapitre consacré à Leconte de Lisle reprend, en treize pages, un discours prononcé à la Bibliothèque nationale le 23 septembre 1977. * Henri Cornu, Charles Marie Leconte de Lisle. Bourbon et Marie-Élixène, Azalées Éditions & Musée de Villèle, 1995, (ISBN 2-908127-39-3). * Caroline De Mulder, Leconte de Lisle, entre utopie et république, Éditions Rodopi B.V. Amsterdam-New York, 2005, (ISBN 90-420-1657-4) Biographie de référence * Christophe Carrère, Leconte de Lisle ou la Passion du beau, Fayard, 2009. (ISBN 978-2-213-63451-7). Études de l’œuvre de Leconte de Lisle Critiques contemporaines de Leconte de Lisle * Le tableau suivant inclut la plupart des critiques retenues par Catulle Mendès, dans l’article consacré à Leconte de Lisle dans son Rapport sur le Mouvement poétique français de 1867 à 1900, Imprimerie nationale, 1902, p. 162-166 (voir le texte de l’article et les extraits des critiques sur Gallica). * À signaler également la monographie suivante que Paul Verlaine a consacrée à Leconte de Lisle: Études classiques * Citons, parmi les auteurs d’études parues entre 1895 et 1944: * P.V. Delaporte, * Jean Dornis, * Pierre Flottes, * Joseph Vianey. Études modernes * Citons parmi les études parues depuis 1945: * Irving Putter 1951-54-61 * Jules-Marie Priou, 1966 * Edgard Pich, 1975 * Robert Sabatier, 1977 Divers Famille de Leconte de Lisle * Son grand-père paternel: Charles Marie Leconte de Lisle (1759-1809), apothicaire à Dinan. * Ses parents, mariés le 26 novembre 1817 à Saint-Paul (La Réunion). * Son père: Charles Marie Leconte de Lisle, né le 14 octobre 1793 à Dinan (Côtes-du-Nord), Breton, nommé chirurgien sous-aide dans les armées de Napoléon, émigrant en 1816 à l’Île Bourbon (actuellement Île de la Réunion) et devenu planteur ; mort à Saint-Denis (La Réunion) le 28 juillet 1856. * Sa mère: Anne Suzanne Marguerite Élysée de Riscourt de Lanux (1800-1872), fille d’un planteur de Saint-Paul, arrière-petite-fille de Jean Baptiste François de Lanux, issue d’une famille du Languedoc installée à Bourbon depuis 1720 (en la personne du Marquis François de Lanux, languedocien, exilé par le Régent), qui appartient à l’aristocratie de l’île et est apparentée au poète Parny. * Ses cinq frères et sœurs: • Élysée Marie Louise (23 octobre 1821– ?) • Alfred (10 novembre 1823– janvier 1888) • Anaïs (31 juillet 1825– ?) • Emma (1836– ?) • Paul (18 mars 1839– 23 février 1887). * Sa femme: Anna Adélaïde Perray (29 mars 1833, Versailles—8 septembre 1916, Versailles), fille de Jacques Perray et d’Amélie Leconte. Mariage: Paris, 10 septembre 1857. Origine du nom de Leconte de Lisle * Les éléments constitutifs du nom « Leconte de Lisle » ont les origines suivantes: * de Lisle. Ce nom provient de la terre de « l’Isle », située sur les anciens villages de Saint-Samson-de-l’Isle et de Cendres (non loin du Mont Saint-Michel) qui font partie aujourd’hui de la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine). * Leconte: les ancêtres de Leconte de Lisle s’appelaient « Le Conte » ; il y eut: 11. Jean (au milieu du XVIe siècle) ; 10. Jean ; 9. Thomas ; 8. Charles ; 7. Thomas ; 6. Jean (fin du XVIIe siècle) ; 5. Michel (apothicaire, habite Pontorson, ajoute « de Préval » à son nom, et, ayant épousé la fille de François Estienne, hérite de la terre de « l’Isle ») ; 4. Jacques Le Conte de Préval ; 3. Charles Marie Le Conte, grand-père du poète (c’est lui qui ajoute « de l’Isle » à son nom) ; 2. Charles Marie (père du poète) ; 1. Charles Marie René (le poète ; c’est lui qui fusionne “Le” et “Conte” en “Leconte”).Remarque.—Corrigeons plusieurs erreurs souvent rencontrées à propos du nom du poète: * Leconte de Lisle n’était en rien un aristocrate: le “de” n’est pas une particule nobiliaire, pas plus que “Leconte” n’est une déformation de “Le Comte”. * Leconte de Lisle n’a pas cherché, par vanité, à faire croire à une prétendue origine noble, en ajoutant “de Lisle” à son nom “Leconte”: le nom complet “Le Conte de Lisle” était déjà le patronyme de sa famille paternelle. Et c’est même lui le premier qui a réuni “Le” et “Conte”, « pour éviter le semblant d’un titre ». * Le nom “Lisle” ne se rapporte pas, avec une écriture archaïque, à l’île Bourbon (La Réunion), son lieu de naissance: Lisle est en fait le nom d’une terre bretonne, située à Pleine-Fougères. * “Leconte de Lisle”, dans les rangements alphabétiques, doit se placer à "Leconte…", et non pas à “Lisle (Leconte de)”. Lieux où Leconte de Lisle a vécu * Au total, en dehors de son île natale et de la métropole, ses voyages l’auront amené à voir l’Île Maurice, Le Cap et l’Île Sainte-Hélène. Cela laisse peu de place à des « voyages en Orient » évoqués parfois. Ils ont probablement été inventés, peut-être sur la base de déclarations de Leconte de Lisle lui-même. * * Iconographie de Leconte de Lisle * Des photographies sont disponibles sur le site de la BNF: se reporter au paragraphe Liens externes en fin d’article. * Portrait, par Jean-François Millet. * Portrait, par Jobbé-Duval, 1850 ; reproduction dans Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, p. 176A sur wikisource * Gravure-caricature d’Étienne Carjat. Dans J.-M. Priou, Leconte de Lisle, 1966, p. 25. * Portrait, par Rajon, pour Poèmes antiques, 1874. Dans J.-M. Priou, Leconte de Lisle, 1966, p. 26. * Portrait, par F. A. Cazals. Dans J.-M. Priou, Leconte de Lisle, 1966, p. 31. * Dessin, par Maurice Ray. En frontispice des Poèmes antiques, Société des Amis du Livre, 1908. * Photographies, par Nadar: sur Gallica 1, 2, 3, 4. * Photographie de la collection Félix Potin, par Boyer: exemplaire au musée d’Orsay. * Photographie, par Carjat, 1857 ; reproduction en frontispice de: Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, 1909, sur wikisource * Photographie, du studio Eugène Piriou, décembre 1878. Reproduction dans: Malou Haine, L’Apollonide de Leconte de Lisle et Franz Servais. * Dessin, par E. Giraudat, après 1886. Reproduction dans: Malou Haine, L’Apollonide de Leconte de Lisle et Franz Servais. * Tableau Chez Alphonse Lemerre, à Ville-d’Avray, par Paul Chabas. Ce tableau représente de nombreux parnassiens, dont Leconte de Lisle, dans la propriété de l’éditeur. Il a été exposé au salon de 1895. * Quatre eaux-fortes, par Maurice de Becque. En frontispice des 4 tomes de l’édition Lemerre, 1927-28. * Photographie, par Émile Perray. En frontispice de: Pierre Flottes, Le Poète Leconte de Lisle– Documents inédits, 1929. * Deux croquis, par Paul Verlaine. * Portrait, par Jacques-Léonard Blanquer, 1885. * Dessin de Jules Breton, 1885 ; reproduction dans Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, 1909, p. 272A, sur wikisource. * Dessin de M. Reichan. Paris.– Une séance de réception à l’Académie française, dessiné d’après nature par M. Reichan, lors de la réception de M. le Comte de L’Isle [sic], journal hebdomadaire Le Monde illustré, n° 1655, 15 décembre 1888, lien vers Gallica, p. 380-381. * Portrait de Benjamin Constant, 1888 ; reproduction dans Jean Dornis, Essai sur Leconte de Lisle, 1909, p. 320A, sur wikisource. * Henri Mairet, Panorama du siècle, album de 110 photos ; voir planche 26 recto: Leconte de Lisle, 1889TimbreUn timbre, émis par la Poste en 1978, dans le groupe « Personnages célèbres 1978 ». Sources des poèmes * Joseph Vianey a établi les principales sources utilisées par Leconte de Lisle. La liste est la suivante. * Poèmes indiensLe Maha-Bharata, traduit par Hippolyte Fauche, Paris, Durand, 1865, texte du Mahâ-Bhârata sur wikisource * Victor Henry, Les Littératures de l’Inde ; édition 1904 en ligne sur Gallica * Valmiky, Ramayana, traduit du sanskrit par Hippolyte Fauche, Paris, Franck, 1854 ; texte sur wikisource * Rig-Véda ou livre des Hymnes, traduit du sanskrit par Alexandre Langlois, 4 vol., Paris, F. Didot, 1848-51 ; édition 1870 en ligne sur wikisource * Le Bhâgavata Purâna ou Histoire politique de Krichna, traduit et publié par Eugène Burnouf, Paris, Imprimerie royale, 1840-47, texte sur wikisource: tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 * Jules Lacroix de Marlès, Histoire générale de l’Inde ancienne et moderne, depuis l’an 2000 avant J.C. jusqu’à nos jours, Paris Emler frères, vol. 1/6, appendice no II, Naissance, mariage et aventures de Nour-Mahal, page 177-189, texte sur wikisource.Poème égyptienGaston Maspero, Études de mythologie et d’archéologie égyptiennes, en ligne sur Gallica: 1 2 3 4 5 6 7 8 * Gaston Maspero, Les Contes populaires de l’Égypte ancienne, en ligne sur wikisource: édition 1882 sur wikisource * Gaston Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, en ligne sur Gallica: 11e édition revue 1912Poèmes scandinavesXavier Marmier, Chants populaires de Nord (Islande, Danemark, Suède, Norvège, Feroe, Finlande), Paris, Charpentier, 1842 * La Saga des Nibelungen dans les Eddas, traduction précédée d’une étude sur la formation des épopées nationales, par E. de Laveleye, Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verbrœckhoven et Cie, 1866, texte sur Gallica * J.- J. Ampère, Littérature et Voyages, Allemagne et Scandinavie, Paris, Poulin, 1833 * A.-F. Ozanam, Les Germains avant le Christianisme, Paris, Lecoffre, 1847. œuvres complètes, tome 3, édition 3, 1861, sur Gallica. * Xavier Marmier, Lettres sur l’Islande, Paris, Bonnaire, 1837Poèmes finnoisLéouzon Le Duc, La Finlande, son histoire primitive, sa mythologie, sa poésie épique, avec la traduction complète de sa grande épopée le Kalewala, son génie national, sa condition politique et sociale depuis la conquête russe, 2 vol., Paris, Labitte, 1845 * Xavier Marmier, De la poésie finlandaise, Revue des deux Mondes, 1er octobre 1842, texte en ligne sur wikisourcePoèmes celtiquesVicomte Théodore Hersart de La Villemarqué, Poèmes des bardes bretons du VIe siècle traduits pour la première fois avec le texte en regard revu sur les plus anciens manuscrits, Paris, Renouard, 1850 * Robert Burns, Poésies complètes, traduites de l’écossais par M. Léon de Wailly, Paris, Delahays, 1843Poèmes espagnolsM. de Marlès, Histoire de la domination des Arabes en Espagne et en Portugal, rédigée sur l’Histoire traduite de l’arabe en espagnol par M. Joseph Condé, 3 vol., Paris, Alexis Eymery, 1825. Texte en ligne sur Gallica: tome 1er, tome 2, tome 3 * Louis Viardot, Essai sur les Arabes d’Espagne, 2 vol., Paris, 1833 * Damas-Hinard, Romancero général, ou Recueil des Chants populaires de l’Espagne, traduction complète, Paris, Charpentier, 1844Poèmes sur le nouveau mondeJ.-A. Moerenhout, Voyages aux îles du Grand Océan, 2 vol., Paris, Arthus Bertrand, 1837 * Armand de Quatrefages, Les Polynésiens et leurs migrations, Revue des deux Mondes, 1er et 15 février 1864 * Goussin, Du dialecte de Tahiti, de celui des îles Marquises, et, en général, de la langue polynésienne, Paris, Didot, 1863 * Abbé Em. Domenech, Voyage pittoresque dans les Grands Déserts du Nouveau Monde, Paris, Morizot, s.d. (1860 ?) Leconte de Lisle et l’Académie française * Leconte de Lisle se porta deux fois candidat à l’Académie française. La première fois, en 1877, il n’obtint que deux voix, dont celle de Victor Hugo. Il se représenta à la succession de Victor Hugo en 1885, fut élu le 11 février 1886 et reçu sous la coupole en le 31 mars 1887 par Alexandre Dumas fils. La boîte déroulante ci-dessous donne le détail des scrutins qui l’ont concerné. Musique inspirée par des poèmes de Leconte de Lisle * Trois compositions ont été évoquées plus haut au titre du théâtre de Leconte de Lisle: * Ernest Chausson, Hélène, drame lyrique, en deux actes (op. 7, 1883-4). * Jules Massenet, Les Érinnyes,. Partition en ligne pour chant et piano * Franz Servais, L’Apollonide (Iõn) Partition en ligne pour chant et pianoUne œuvre orchestrale a été inspirée par un poème de Leconte de Lisle: * César Franck, Les Éolides, inspiré par le poème Les Éolides.Par ailleurs, de nombreux musiciens ont écrit des mélodies sur des poèmes de Leconte de Lisle, parmi lesquels: Tableau inspiré par des poèmes de Leconte de Lisle * Paul Gauguin a intitulé un tableau Poèmes barbares. Il l’a peint en 1896 lors de son second séjour en Polynésie, sous l’influence de la lecture du recueil de 1862 de Leconte de Lisle. Le tableau est exposé aux Harvard Art Museums à Cambridge (Massachusetts). Il représente une Polynésienne dont la posture combine des gestes chrétiens et bouddhistes, ainsi qu’un animal identifié à Ta’aroa, le dieu tahitien créateur de l’univers. Éditions illustrées de Leconte de Lisle * Dans la liste suivante, les noms des illustrateurs figurent en gras. * Poésies complètes * Maurice de Becque, Paris, édition Lemerre en quatre tomes, 1927-1928, (voir plus haut). Tirage total 540 exemplaires (325 ex. num. sur vergé Lafuma, 125 Hollande Van Gelder, 10 Chine, 25 Japon, 15 Madagascar, 40 H.C.). * Poèmes antiques * Maurice Ray, Paris, Société des Amis des Livres, 1908 ; 30 eaux-fortes originales en noir dans le texte de Maurice Ray, gravées par Louis Muller, dont un frontispice ; grand in-8 en ff., imprimé par Draeger par les soins de R. Claude-Lafontaine, emboîtage d’éditeur. Tirage 110 ex. sur vélin. * Poèmes barbares * Léon Carré, Paris, imprimé pour Jean Borderel, 1911 ; vingt poèmes, 25 eaux-fortes originales, dont un frontispice et 24 vignettes in-texte, serpentes. In-4. Tirage 10 ex. sur vergé, H.C. * Raphaël Freida, Paris, Éditions A. Romagnol, 1914 ; 99 eaux-fortes originales dont 18 en pleine page gravées par Edmond Pennequin et imprimées en taille-douce par A. Porcabeuf. Tirage limité à 301 exemplaires numérotés. In-4 (19 x 28,5 cm), 426 pages. * Philippe Labèque, gravures originales sur cuivre, sans lieu, Aux dépens de soixante-dix-sept bibliophiles, sans date. In-Folio, couv. rempliée, sous chemise et cartonnage, 77 exemplaires sur Grand Vélin de Rives. * Maurice de Becque, Six Poèmes barbares illustrés de douze eaux-fortes dont six hors-texte, gravées en couleur au repérage, Paris, chez Maurice de Becque, 1925. * Paul Jouve, Lausanne, Gonin, 1929 ; 30 compositions, en noir et en couleurs, gravées sur bois par Perrichon: 1 vignette de titre, 2 sur double page, 10 à pleine page, 17 in-texte. Tirage limité à 119 exemplaires * Odette Denis, Le Livre De Plantin, Paris 1948, in 4° en feuilles, 26 eaux fortes originales d’Odette Denis. Tirage limité à 205 exemplaires. * Maurice de Becque, Six poèmes barbares, édition ornée de douze eaux-fortes, dont six hors-texte, gravées en couleurs au repérage par Maurice de Becque. Album grand in-4° en feuillets, couverture rempliée illustrée, chez Maurice de Becque, 1925. Tirage limité à 220 exemplaires. * V. M. Vincent, Les Elfes, un vol. grand in-8°, br., 12 ff, Bordeaux, imprimerie René Samie, 1935. * Poèmes tragiques. * Hugues de Jouvancourt, Pantouns malais avec cinq eaux-fortes et six ornements, in-folio, Genève, Pierre Cailler, 1946. * Les Idylles de Théocrite * René Ménard et Jacques Beltrand, 25 gravures sur bois originales dont un frontispice de Ménard, 19 en têtes en couleurs, une vignette, un cul de lampe et 3 en têtes et bordures de Beltrand. Paris, Société du Livre d’art, 1911. In 4°, broché, sous chemise et étui. Tirage à 135 exemplaires. * Raphael Drouart, Paris, Gaston Boutitie, 1920. 92 bois originaux N/B (dans le texte, en front-de-chapitre, en culs-de-lampe et en hors-texte), in 4°, 204 pages, en feuillets, sous chemise, 23,5x28,5 cm. Tirage total 320 exemplaires (225 ex. num. sur vergé teinté d’Arches, 25 Whatman, 50 autres vergé d’Arches, 20 H.C.). * Les Érinnyes * François Kupka, Paris, Librairie de la Collection des Dix, A. Romagnol éditeur, 1908 ; grand in-8°, 35 compositions de François Kupka, dont 25 eaux-fortes originales (3 hors-texte et 22 à mi-page formant en-têtes de chapitres) et 10 gravées sur bois par E. Gaspé (8 culs-de-lampe et 2 titres) ; texte dans un encadrement. Tirage total à 301 exemplaires. * Auguste Leroux, Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1912 ; petit in folio 270 x 210 mm, 7 ff., 78 pages, 3 ff. ; illustré de 3 eaux-fortes hors texte et de 40 bandeaux gravés sur bois dans le texte en couleurs. Tirage à 150 exemplaires sur papier du Japon sous la direction de Charles Meunier, 125 réservés aux Membres de la Société. * A. Bouchet, Paris, Édouard-Joseph, 1920. Coll. Petites curiosités littéraires. Bois dessinés et gravés par A. Bouchet. Tirage total à 1000 exemplaires. * Odes Anacréontiques * André Derain, Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1953, illustré de 50 lithographies originales en noir, dans et hors texte par André Derain, 1 vol. grand in-8° en feuilles sous couverture rempliée, chemise cartonnée, dos parchemin, et boîte cartonnée, 81 p. + tables + liste des sociétaires. Imprimé par Fequet et Baudier. Tirage 200 exemplaires numérotés, sur vélin B.F.K. de Rives. * Homère, Iliade * Jo Moller (ch. 1 à 4), Remo Giatti (ch. 5 à 8), Eric Massholder (ch. 9 à 13), Paso (ch. 13 à 16), Toos van Holstein (ch. 17 à 20), Alain Lestié (ch. 20 à 24 et 26): La Diane Française, 2012. * Homère, Odyssée * Georges Rochegrosse, Paris, A. Ferroud– F. Ferroud, successeur, 1931, 304 p. Illustration: 25 hors-texte gravés à l’eau-forte par Eugène Decisy et 72 vignettes, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois en couleurs par P. Baudier, Ch. Clément, Gaspérini et P. Gusman. Tirage total 501 exemplaires numérotés (1 ex. sur papier de Hollande, 100 ex. sur grand japon impérial, 400 ex. sur vélin d’Arches). * Homère, Nausikaa, sixième rhapsodie de l’Odyssée * Gaston de Latenay, Paris, Piazza, 1899, in-4°, br., couv. rempliée ill. en couleurs, 54 p., 53 compositions coloriées au pochoir par E. Greningaire et gravées par Ruckert. Tirage 400 ex. * Pièces réunionnaises. * Hugues de Jouvancourt, Québec, Éditions la Frégate, 1994 ; in-4°, 66 p. + les illustrations, en feuillets, sous couverture imprimée rempliée, emboîtage. Ouvrage édité pour le centenaire de la mort du poète. Tirage 100 exemplaires. Traductions en langues étrangères d’œuvres de Leconte de Lisle * « Pour les traductions en langue allemande, voir Fromm, Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Französisch zwischen 1700 und 1948. Qaïn a été traduit en tchèque dès 1880 (Prague, Otto). Deux traductions des Érinnyes ont été publiées, en espagnol par la revue de Buenos Ayres Nosotros, et en russe par Lozinskij (1922). Un recueil de morceaux choisis, traduits en russe par Igor Postupalskij et commentés par N. Balachov, a été publié à Moscou en 1960. En Italie, des morceaux choisis de Vigny et de Leconte de Lisle ont été publiés à Milan en 1945, traduits par Filippo Ampola (Éditeur: Garzanti). » (Edgard Pich, Leconte de Lisle et sa création poétique, 1975, p. 535). Dédicaces à Leconte de Lisle * Auguste Lacaussade, poème Le Cap Bernard du recueil Poèmes et paysages, 1852 ; * Léon Dierx, Poèmes et Poésies, 1861: « À mon cher et vénéré Maître Leconte de Lisle » ; * Albert Glatigny, Les Flèches d’or, 1864: « À M. Leconte de Lisle » ; * François Coppée, Le Reliquaire, 1866: « À mon cher Maître / Leconte de Lisle / Je dédie mes premiers vers. » ; * Armand Silvestre, Le Doute, 1870, texte sur wikisource ; * Catulle Mendès, Hespérus, 1872: « À Leconte de Lisle » ; * Anatole France, Les Poèmes dorés, 1873: « À / Leconte de Lisle / auteur des poèmes antiques / et des poèmes barbares / en témoignage / d’une vive et constante / admiration / ce livre est dédié » ; * Judith Gautier, La Sœur du Soleil, 1887 ; texte sur wikisource ; * José-Maria de Heredia, Les Trophées, 1893: « À Leconte de Lisle » ; * Edmond Haraucourt, Les Âges: L’Espoir du Monde, 1894 ; * Jean Dornis, La Voie douloureuse, Calmann Lévy, 1894. * Pierre Louÿs, Pour la stèle de Leconte de Lisle, poème (date ?) Attribution du nom de Leconte de Lisle * Portent le nom de Leconte de Lisle: * un lycée prestigieux de Saint-Denis de La Réunion, le lycée Leconte-de-Lisle ; mais aussi à La Réunion un collège à Saint-Louis, trois écoles primaires à Saint-André, Saint-Paul et Saint-Pierre ; * la médiathèque de Saint-Paul de la Réunion ; la salle de spectacles Lespas Leconte de Lisle, toujours à Saint-Paul ; * un paquebot, le Leconte-de-Lisle (1922-1956). Se reporter à la section #Liens externes pour consulter le site qui lui est consacré ; * un ITEP dans la Haute-Saône, l’ITEP Leconte de Lisle ; * des voies (rues, avenues, squares, impasses, boulevards, promenades, villa, etc.): * en métropole: Bergerac, Dinan, Louveciennes, Mennecy, Ozoir-la-Ferrière, Paris XVIe, Rennes, Saint-Gaudens, Saint-Lubin-des-Joncherets ; * à La Réunion: Bras-Panon, Cilaos, Le Port, Saint-Benoît, Saint-Denis (une place), Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Clotilde. Liens externes * Notices d’autorité: Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale d’Espagne • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque nationale de Pologne • Bibliothèque nationale d’Israël • Bibliothèque universitaire de Pologne • Bibliothèque nationale de Catalogne • WorldCat * Ressources relatives à la littérature: Académie française (membres) • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren • Internet Speculative Fiction Database • LibriVox • Online Books Page • Representative Poetry Online • Les Voix de la poésie * (fr) Sur la page de recherche de la BNF, tapez « Leconte de Lisle » pour accéder à des photographies: Leconte de Lisle, sa femme, sa maison natale, etc. * (fr) Généalogie de Leconte de Lisle sur le site geneanet samlap. * (fr) Pavillon de Voisins où Leconte de Lisle mourut, vu du ciel. * (fr) Adolphe Racot, Portraits d’aujourd’hui, 1887: voir texte, p. 113-124, sur Gallica. * (fr) Le paquebot « Leconte-de-Lisle ». * (fr) Le Jardin des dieux, émission radiophonique de François-Xavier Szymczak, France Musique, 17 février 2013, comprenant des œuvres musicales sur des poèmes de Leconte de Lisle, notamment: Lydia de Gabriel Fauré, Les Éolides de César Franck ; Études latines de Reynaldo Hahn ; Phydilé de Henri Duparc ; etc. * (fr) Vincent Dubois, la Compagnie des Indes Orientales, chapitre 12: Un écrivain réunionnais célèbre: Leconte de Lisle * (ru) Site russe signalant une édition des poèmes de Leconte de Lisle traduits en langue russe, en quatre volumes (2016), avec la traduction de plusieurs d’entre eux (Hypatie, etc.), (ISBN 978 5 91763 282 7) Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Leconte_de_Lisle


Zoé Valdés (La Habana, 2 de mayo de 1959) es una escritora cubana de poesía, novela y guiones cinematográficos que adquirió la ciudadanía española en 1997. Estudió en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, pero abandonó los estudios antes de terminar (hizo hasta cuarto año); después ingresó en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana, donde estudió hasta segundo año.


Sophie d'Arbouville, née le 29 octobre 1810 et morte le 22 mars 1850 à Paris, est une poète et nouvelliste française. Biographie Née le 29 octobre 1810, Sophie de Bezancourt1 est la petite-fille de Sophie d'Houdetot. Elle fréquente dans le salon de celle-ci une société choisie. Léon Séché en fait ce portrait « Elle était plutôt mal de figure, elle avait des traits forts et os yeux ressortis qui, de prime abord, disposaient peu en sa faveur, mais dès qu'elle ouvrait la bouche on oubliait sa laideur relative.» et Sainte-Beuve en a dit « Jeune femme charmante, un peu Diane, sans enfants. Restée enfant et plus jeune que son âge. Pas jolie, mais mieux. » À 22 ans elle épouse le général François d'Arbouville, qu'elle suit dans ses campagnes. Sa santé s'en ressentira. Ne pouvant suivre le général en mission en Afrique elle retourne à Paris et y tient salon. Sa conversation, son amabilité et sa bienveillance sont reconnus de tous. Elle ne tient pas au succès et ses poésies paraissent en petit nombre, pour ses proches, et son couvert d'anonymat. Ses nouvelles publiées dans « La Revue des deux Mondes » le sont sans son consentement, Prendre l'ouvrage d'une femme pour le publier sans lui en demander la permission, c'est un manque de délicatesse. Ce n'est pas la peine de donner mille francs pour échapper à une complète publicité, si le lendemain les revues agissent de cette façon. J'ai écrit moi-même à M. Bulos (sic) une lettre très nette et très ferme qui l'aura un peu surpris, et je l'oblige, pour le prochain n°, à dire qu'il a agi sans mon consentement (Lettre à Sainte-Beuve). La revue ne publiera pas cette protestation, ayant l'assentiment du mari. Elle acceptera plus tard leur édition, mais au profit d'une œuvre caritative. Elle habitait au 10 place Vendôme et y tenait un salon où l'on parlait plus de poésie que de politique. Lamartine était un de ses poètes favoris. Sainte-Beuve, son hôte le plus assidu, en fit sa muse, et lui dédia Le Clou d’or2; elle ne lui céda jamais . En me voyant gémir, votre froide paupière M'a refermé d'abord ce beau ciel que j'aimais, Comme aux portes d'Enfer, de vos lèvres de pierre, Vous m'avez opposé pour premier mot : Jamais ! (À Elle qui était allée entendre des scènes de l'opéra d'Orphée) ; mais ils correspondirent pendant 10 ans. L'été elle résidait à Maisons-Laffitte ou Champlâtreux ; Prosper Mérimée y était reçu ; Chateaubriand y a composé Velléda. Malade La fièvre m'est revenue, avec des douleurs aiguës — des maux de tête terribles., atteinte d'un cancer elle partit en Ariège prendre les eaux de Celles puis rejoint son mari à Lyon. Les événements de juin 18493- altèrent sa santé car elle craint pour la vie du général ; le couple rentre à Paris et c'est là qu'elle meurt, le 22 mars 1850, après une longue maladie.
Victor-Louis-Amédée Pommier, né à Vaise (actuellement Lyon) le 20 juillet 1803 et mort le 15 avril 1877 à Paris VIIème arrondissement est un homme de lettres et poète français. Biographie Venu de bonne heure à Paris, après de brillantes études au collège Bourbon, il commença par coopérer à la Collection de classiques latins de Nicolas-Éloi Lemaire, en préparant des notes, revoyant des textes et collationnant des manuscrits. Il prit part à la rédaction de la Semaine, gazette littéraire, fondée en 1824 sous la direction de Victorin et Auguste Fabre et de Villenave Père, et y inséra divers articles de critique et quelques morceaux de poésie. En 1826, il entreprit, comme éditeur, la publication d’une Collection de classiques latins, avec la traduction française en regard, mais il n’en publia que deux ou trois auteurs, dont les Commentaires de César, traduction de Toulangeon, revue par l’éditeur. Il donna en 1827 une traduction de Cornélius Népos à la Bibliothèque latine-française de Panckoucke, et traduisit, pour la même collection, le Dialogue sur la vieillesse de Cicéron.à la poésie. Dans les années 1827-1829, il obtint plusieurs prix de poésie aux Jeux-Floraux de Toulouse, et publia par la suite les pièces couronnées dans son premier recueil de vers. Il occupa la chaire de littérature à l’Athénée royal dans l’hiver de 1828-1829. Un mémoire de lui obtint l’accessit dans le concours ouvert en 1830 par la Revue de Paris sur cette question: « Quelle a été l’influence du gouvernement représentatif sur notre littérature et sur nos mœurs ? » Le rapport disait: « Ce discours, d’un esprit élevé, qui a paru s’éloigner trop souvent de la question proposée, est plein des souvenirs d’une instruction solide que fait valoir encore un style facile et correct. » En 1847, il remporta le prix de poésie décerné par l’Académie française, dont le sujet était la découverte de la vapeur. L’année suivante, la même classe de l’Institut lui décerna une médaille de 1 400 fancs pour sa pièce (non imprimée) sur l’Algérie ou la Civilisation conquérante. En 1849, il obtint à la fois le prix d’éloquence pour l’éloge d’Amyot et le prix de poésie pour la mort de l’archevêque de Paris, coïncidence assez rare dans les fastes académiques et qui lui valut la décoration, sur la proposition d’Alfred de Falloux, alors ministre de l’instruction publique. Le 8 septembre 1880, en réponse à l’envoi de son dernier livre, Gustave Flaubert lui écrit: « Vos Colifichets sont des joyaux Je me suis rué dessus. J’ai lu le volume tout d’une haleine. Je l’ai relu. Il reste sur ma table pour longtemps encore. Partout j’ai retrouvé l’exquis écrivain des Crâneries, des Océanides et de l’Enfer. Je vous connais et depuis longtemps je vous étudie. Il n’est guère possible d’aimer le style sans faire de vos œuvres le plus grand cas. Quelles rimes! Quelle variété de tournures! Quelles surprises d’images! C’est à la fois clair et dense comme du diamant. Vous me semblez un classique dans la meillemot. […] Il faut être fort comme un cabire pour avoir de ces légèretés-là. Vous m’avez fait rêver délicieusement avec l’Égoïste et la Chine. Le Géant m’a « transporté d’enthousiasme ». L’expression, quoique banale, n’est pas trop forte ; je la maintiens.—Les œuvres d’art qui me plaisent par-dessus toutes les autres sont celles où l’art excède. J’aime dans la peinture, la Peinture ; dans les vers, le Ves. Or, s’il fut un artiste au monde, c’est vous. Tour à tour, vos êtes abondant comme une cataracte et vif comme un oiseau. Les phrases découlent de votre sujet naturellement et sans que jamais on voie le dessous. Cela étincelle et chante, reluit, bruit et résiste. […] Je vous aime encore parce que vous n’appartenez à aucune boutique, à aucune église, parce qu’il n’est question, dans votre volume, ni du problème social, ni des bases [de la société], etc.. » Principales publications La Pile de Volta, recueil d’anecdotes publié par un partisan de la littérature galvanique (1831) Poésies (1832) La République, ou le Livre du sang (1836) Les Assassins sans le savoir, drame en 1 acte (1837) Océanides et fantaisies (1839) Texte en ligne Crâneries et dettes de cœur (1842) Texte en ligne Colères (1844) Texte en ligne Les Russes (1854) L’Enfer (1856) De l’Athéisme et du déisme (1857) Colifichets, jeux de rimes, avec les sonnets sur le Salon de 1851 (1860) Paris, poème humoristique (1866) Quelques vers pour elle, poésie intime (1877) Source Notice dans Histoire de la littérature française au XIXe siècle de Frédéric Godefroy (1826-1897), sur GoogleBooks Note Portail de la poésie Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Amédée_Pommier


Rémy Belleau, né à Nogent-le-Rotrou en 1528, mort à Paris le 6 mars 1577, est un poète français de la Pléiade. Biographie Belleau a commencé ses études chez les moines de l’abbaye Saint-Denis à Nogent-le-Rotrou avant de les poursuivre, vers 1553, à Paris où il complète une formation dominée par l’amour de la poésie grecque. Intelligent sans surcharge d’érudition, il était avant tout un homme qui plaisait[réf. nécessaire]. Il rejoint bientôt le groupe du collège de Coqueret (Pierre de Ronsard, Antoine de Baïf, Joachim du Bellay), puis la Pléiade en 1554, avec qui il prend part à la Pompe du bouc. Il publie en 1556 une traduction des Odes d’Anacréon: le succès de ce lyrisme léger est considérable. Bien qu’un peu sèche selon Ronsard, cette traduction vient enrichir la «Brigade» d’un nouveau style; elle a pour elle la fidélité et l’exactitude qui en firent le succès[réf. nécessaire]. On lui doit également la traduction du Cantique des Cantiques et de l’Ode à l’Aimée de Sappho. De fait, Belleau est le premier traducteur français de la poétesse de Lesbos. La même année, Belleau célèbre dans les Petites Inventions fleurs, fruits, pierres précieuses, animaux et feront plus tard écho à la rage de l’expression de Francis Ponge. Ses poèmes personnels manquaient encore d’originalité[réf. nécessaire] et il fallut attendre 1565 pour découvrir sa Bergerie, chef-d’œuvre de la poésie pastorale dont l’Avril dévoile un érotisme à fleur de sein. En 1576, paraissent Les Amours et Nouveaux Eschanges des pierres précieuses, vertus et propriétés d’icelles. Cette œuvre, décrite comme une «épopée minérale» par R. Sabatier, raconte les propriétés des pierres, leur histoire, le mythe de leur origine en associant la symbolique des pierres aux interprétations philosophiques et scientifiques. Selon certains le moins lyrique des poètes de la Pléiade, le plus pudique au dire d’autres, Rémy Belleau ne déborde certainement pas d’imagination et il imita plus qu’il ne créa, mais il demeure un orfèvre du verbe[réf. nécessaire]. Son talent élégant et facile le fit surnommer par ses contemporains le gentil Belleau. Après avoir initialement penché pour la Réforme, l’auteur se rallie au parti des Guise, ses protecteurs, notamment René II de Lorraine-Guise. Précepteur à Paris de Charles de Lorraine, il résidera jusqu’à sa mort (1577) à l’hôtel de Guise. Pierre de Ronsard qui faisait grand cas de Belleau, et l’appelait le Peintre de la nature, a rédigé son épitaphe: Ne taillez, mains industrieuses Des pierres pour couvrir Belleau, Lui-même a basti son tombeau Dedans ses Pierres Précieuses. Œuvre Œuvres poétiques Il a publié en 1565 un poème, la Bergerie, dans le genre pastoral et les Amours et nouveaux échanges de pierres précieuses en 1576, un recueil qui associe la symbolique des pierres aux interprétations philosophiques et scientifiques. Certain de ses poèmes furent mis en musique par Pierre Cléreau. Ses Œuvres ont été réunies à Rouen en 1604, 2 volumes in-12. Rémy Belleau, La bergerie (Texte en moyen français), Paris, G. Gilles, 1565, 127 p.; in-8 (notice BnF no FRBNF30079761)La bergerie disponible sur Gallica Rémy Belleau, Chant pastoral de la paix, Paris, A. Wechel, 1559, 10 f.; in-4 (notice BnF no FRBNF30079763)Chant pastoral de la paix disponible sur Gallica Rémy Belleau, Épithalame sur le mariage de Monseigneur le duc de Lorraine et de Madame Claude, fille du roy, chanté par les nymphes de Seine et de Meuse, Paris, A. Wechel, 1559, 15 p.; in-4 (notice BnF no FRBNF30079764)Épithalame sur le mariage de Monseigneur le duc de Lorraine disponible sur Gallica Rémy Belleau (trad. Florent Chrestien), Sylva cui titulus Veritas fugiens ex R. Bellaquei gallicis versibus latina facta a Florente Christiano, Lutetiæ, ex officina R. Stephani, 1561, In-4°, 12 p. (notice BnF no FRBNF30079773)Sylva cui titulus Veritas fugiens disponible sur Gallica Les Amours et nouveaux échanges des pierres précieuses, Paris, M. Patisson, 1576; Œuvres poétiques, éd. Ch. Marty-Laveaux, A. Lemerre, 1878, t. II. l’Eschole de Salerne en vers burlesques et poema macaroanicvm de bello Hvgvenortica, traduit par Louis Martin en 166o,à Rouen chez Clement Malassis.( source Bnf: data.bnf.fr) Traductions Rémy Belleau a traduit en vers: Les odes d’Anacréon: traduites de grec en françois, par Rémy Belleau, ensemble de quelques petites hymnes de son invention (trad. Rémy Belleau), Paris, A. Wechel, 1556, 1 vol.; in-8 (notice BnF no FRBNF30017685)Les odes d’Anacréon disponible sur Gallica L’ Ecclésiaste Le Cantique des cantiques. Œuvres dramatiques Il jouait dans les pièces de son ami Jodelle, et il a lui-même fait une comédie intitulée la Reconnue. La Reconnue, comédie. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9my_Belleau


Marcel Proust, né à Paris le 10 juillet 1871 et mort à Paris le 18 novembre 1922, est un écrivain français, dont l’œuvre principale est une suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927. Issu d’une famille aisée et cultivée (son père est professeur de médecine à Paris), Marcel Proust est un enfant de santé fragile et toute sa vie il a des difficultés respiratoires graves causées par l’asthme. Très jeune, il fréquente des salons aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation de dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n’a pas d’emploi et il entreprend en 1895 un roman qui reste à l’état de fragments (publiés en 1952, à titre posthume, sous le titre Jean Santeuil). En 1900, il abandonne son projet et voyage à Venise et à Padoue pour découvrir les œuvres d’art en suivant les pas de John Ruskin sur qui il publie des articles et dont il traduit deux livres : La Bible d’Amiens et Sésame et les Lys. C’est en 1907 que Marcel Proust commence l’écriture de son grand œuvre À la recherche du temps perdu dont les sept tomes sont publiés entre 1913 (Du côté de chez Swann) et 1927, c’est-à-dire en partie après sa mort ; le deuxième volume, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix Goncourt en 1919. Marcel Proust meurt épuisé, le 18 novembre 1922, d’une bronchite mal soignée : il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, accompagné par une assistance nombreuse qui salue un écrivain d’importance que les générations suivantes placeront au plus haut en faisant de lui un véritable mythe littéraire. L’œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective comme sur les fonctions de l’art qui doit proposer ses propres mondes, mais c’est aussi une réflexion sur l’amour et la jalousie, avec un sentiment de l’échec et du vide de l’existence qui colore en gris la vision proustienne où l’homosexualité tient une place importante. La Recherche constitue également une vaste comédie humaine de plus de deux cents acteurs. Proust recrée des lieux révélateurs, qu’il s’agisse des lieux de l’enfance dans la maison de Tante Léonie à Combray ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques et bourgeois, ces mondes étant traités parfois avec une plume acide par un auteur à la fois fasciné et ironique. Ce théâtre social est animé par des personnages très divers dont Marcel Proust ne cache pas les traits comiques : ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles ce qui fait d’À la recherche du temps perdu un roman à clé et le tableau d’une époque. La marque de Proust est aussi dans son style dont on remarque les phrases souvent très longues, qui suivent la spirale de la création en train de se faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité qui échappe toujours. Biographie Enfance Marcel Proust naît à Paris (quartier d’Auteuil dans le 16e arrondissement), dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil, au 96, rue La Fontaine. Cette maison fut vendue puis détruite pour construire des immeubles, eux-mêmes démolis lors du percement de l’avenue Mozart. Sa mère, née Jeanne Clémence Weil, fille d’un agent de change d’origine juive alsacienne et lorraine de Metz, lui apporte une culture riche et profonde. Elle lui voue une affection parfois envahissante. Son père, le Dr Adrien Proust, fils d’un commerçant d’Illiers (en Eure-et-Loir), professeur à la Faculté de médecine de Paris après avoir commencé ses études au séminaire, est un grand hygiéniste, conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies. Marcel a un frère cadet, Robert, né le 24 mai 1873, qui devient chirurgien. Son parrain est le collectionneur d’art Eugène Mutiaux. Sa vie durant, Marcel a attribué sa santé fragile aux privations subies par sa mère au cours de sa grossesse, pendant le siège de 1870, puis pendant la Commune de Paris,. C’est pour se protéger des troubles entraînés par la Commune et sa répression que ses parents ont cherché refuge à Auteuil. L’accouchement est difficile, mais les soins paternels sauvent le nouveau-né. « Peu avant la naissance de Marcel Proust, pendant la Commune, le docteur Proust avait été blessé par la balle d’un insurgé, tandis qu’il rentrait de l’hôpital de la Charité. Madame Proust, enceinte, se remit difficilement de l’émotion qu’elle avait éprouvée en apprenant le danger auquel venait d’échapper son mari. L’enfant qu’elle mit au monde bientôt après naquit si débile que son père craignit qu’il ne fût point viable. On l’entoura de soins ; il donna les signes d’une intelligence et d’une sensibilité précoces, mais sa santé demeura délicate. » Bien que réunissant les conditions pour faire partie de deux religions, fils d’un père catholique et d’une mère juive, lui-même baptisé à l’église Saint-Louis-d’Antin à Paris, Marcel Proust a revendiqué son droit de ne pas se définir lui-même par rapport à une religion. Dreyfusard convaincu, il fut sensible à l’antisémitisme prégnant de son époque, et subit lui-même les assauts antisémites de certaines plumes célèbres. Sa santé est fragile et le printemps devient pour lui la plus pénible des saisons. Les pollens libérés par les fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes crises d’asthme. À neuf ans, alors qu’il rentre d’une promenade au Bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe, sa respiration ne revient pas. Son père le voit mourir. Un ultime sursaut le sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l’enfant, et sur l’homme plus tard : la mort peut le saisir dès le retour du printemps, à la fin d’une promenade, n’importe quand, si une crise d’asthme est trop forte. Années de jeunesse Il est au début élève d’un petit cours primaire, le cours Pape-Carpantier, où il a pour condisciple Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet et de son épouse Geneviève Halévy. Celle-ci tient d’abord un salon chez son oncle, où se réunissent des artistes, puis, lorsqu’elle se remarie en 1886 avec l’avocat Émile Straus, tient son propre salon, dont Proust sera un habitué. Marcel Proust étudie ensuite à partir de 1882 au lycée Condorcet. Il redouble sa cinquième et est inscrit au tableau d’honneur pour la première fois en décembre 1884. Il est souvent absent à cause de sa santé fragile, mais il connaît déjà Victor Hugo et Musset par cœur, comme dans Jean Santeuil. Il est l’élève en philosophie d’Alphonse Darlu, et il se lie d’une amitié exaltée à l’adolescence avec Jacques Bizet. Il est aussi ami avec Fernand Gregh, Jacques Baignères et Daniel Halévy (le cousin de Jacques Bizet), avec qui il écrit dans des revues littéraires du lycée. Le premier amour d’enfance et d’adolescence de l’écrivain est Marie de Benardaky, fille d’un diplomate polonais, sujet de l’empire russe, avec qui il joue dans les jardins des Champs Élysées, le jeudi après-midi, avec Antoinette et Lucie Félix-Faure Goyau, filles du futur président de la République, Léon Brunschvicg, Paul Bénazet ou Maurice Herbette. Il cessa de voir Marie de Benardaky en 1887, les premiers élans pour aimer ou se faire aimer par quelqu’un d’autre que sa mère avaient donc échoué. C’est la première « jeune fille », de celles qu’il a tenté de retrouver plus tard, qu’il a perdue. Les premières tentatives littéraires de Proust datent des dernières années du lycée. Plus tard, en 1892, Gregh fonde une petite revue, avec ses anciens condisciples de Condorcet, Le Banquet, dont Proust est le contributeur le plus assidu. Commence alors sa réputation de snobisme, car il est introduit dans plusieurs salons parisiens et entame son ascension mondaine. Il est ami un peu plus tard avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet, qui a six ans de moins que lui. L’adolescent est fasciné par le futur écrivain. Ils se sont rencontrés au cours de l’année 1895. Leur liaison, au moins sentimentale, est révélée par le journal de Jean Lorrain. Proust devance l’appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire en 1889-1890 à Orléans, au 76e régiment d’infanterie, et en garde un souvenir heureux. Il devient ami avec Robert de Billy. C’est à cette époque qu’il fait connaissance à Paris de Gaston Arman de Caillavet, qui devient un ami proche, et de la fiancée de celui-ci, Jeanne Pouquet, dont il est amoureux. Il s’inspire de ces relations pour les personnages de Robert de Saint-Loup et de Gilberte Il est aussi introduit au salon de Madame Arman de Caillavet à qui il reste attaché, jusqu’à la fin et qui lui fait connaître le premier écrivain célèbre de sa vie, Anatole France (modèle de Bergotte). Rendu à la vie civile, il suit à l’École libre des sciences politiques les cours d’Albert Sorel (qui le juge « fort intelligent » lors de son oral de sortie) et d’Anatole Leroy-Beaulieu. Il propose à son père de passer les concours diplomatiques ou celui de l’École des chartes. Plutôt attiré par la seconde solution, il écrit au bibliothécaire du Sénat, Charles Grandjean, et décide dans un premier temps de s’inscrire en licence à la Sorbonne, où il suit les cours d’Henri Bergson, son cousin par alliance, au mariage duquel il est garçon d’honneur et dont l’influence sur son œuvre a été parfois jugée importante, ce dont Proust s’est toujours défendu. Marcel Proust est licencié ès lettres en mars 1895. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin de siècle, illustré par Madeleine Lemaire, dont Proust fréquente le salon avec son ami le compositeur Reynaldo Hahn. Il a fait connaissance chez Mme Lemaire de Reynaldo Hahn, élève de Jules Massenet, qui vient chanter ses Chansons grises au printemps 1894. Proust, qui a vingt-trois ans, et Reynaldo Hahn, qui vient d’avoir vingt ans, passent une partie de l’été 1894 au château de Réveillon chez Mme Lemaire. Le livre passe à peu près inaperçu et la critique l’accueille avec sévérité—notamment l’écrivain Jean Lorrain, réputé pour la férocité de ses jugements. Il en dit tant de mal qu’il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à la main. Face à lui, également un pistolet à la main, Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud. Tout se termine sans blessures, mais non sans tristesse pour l’auteur débutant. Ce livre vaut à Proust une réputation de mondain dilettante qui ne se dissipe qu’après la publication des premiers tomes d’À la recherche du temps perdu. Rédaction de Jean Santeuil La fortune familiale lui assure une existence facile et lui permet de fréquenter les salons du milieu grand bourgeois et de l’aristocratie du Faubourg Saint-Germain et du Faubourg Saint-Honoré. Il y fait la connaissance du fameux Robert de Montesquiou, grâce auquel il est introduit entre 1894 et le début des années 1900 dans des salons plus aristocratiques, comme celui de la comtesse Greffulhe, cousine du poète et belle-mère de son ami Armand de Gramont, duc de Guiche, de Lady Hélène Standish, née de Pérusse des Cars, de la princesse de Wagram, née Rothschild, de la comtesse d’Haussonville, etc. Il y accumule le matériau nécessaire à la construction de son œuvre : une conscience plongée en elle-même, qui recueille tout ce que le temps vécu y a laissé intact, et se met à reconstruire, à donner vie à ce qui fut ébauches et signes. Lent et patient travail de déchiffrage, comme s’il fallait en tirer le plan nécessaire et unique d’un genre qui n’a pas de précédent, qui n’aura pas de descendance : celui d’une cathédrale du temps. Pourtant, rien du gothique répétitif dans cette recherche, rien de pesant, de roman– rien du roman non plus, pas d’intrigue, d’exposition, de nœud, de dénouement. Le 29 juin 1895, il passe le concours de bibliothécaire à la Mazarine, il y fait quelques apparitions pendant les quatre mois qui suivent et demande finalement son congé. En juillet, il passe des vacances à Kreuznach, ville d’eau allemande, avec sa mère, puis une quinzaine de jours à Saint-Germain-en-Laye, où il écrit une nouvelle, « La Mort de Baldassare Silvande », publiée dans La Revue hebdomadaire, le 29 octobre suivant et dédicacée à Reynaldo Hahn. Il passe une partie de mois d’août avec Reynaldo Hahn chez Mme Lemaire dans sa villa de Dieppe. Ensuite, en septembre, les deux amis partirent pour Belle-Île-en-Mer et Beg Meil. C’est l’occasion de découvrir les paysages décrits par Renan. Il rentre à Paris mi-octobre. C’est à partir de l’été 1895 qu’il entreprend la rédaction d’un roman qui relate la vie d’un jeune homme épris de littérature dans le Paris mondain de la fin du XIXe siècle. On y retrouve l’évocation du séjour à Réveillon qu’il fait à l’automne, encore chez Mme Lemaire, dans son autre propriété. Publié en 1952, ce livre, intitulé, après la mort de l’auteur, Jean Santeuil, du nom du personnage principal, est resté à l’état de fragments mis au net. L’influence de son homosexualité sur son œuvre semble pour sa part importante, puisque Marcel Proust fut l’un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de l’homosexualité (masculine et féminine) dans ses écrits, plus tard. Pour l’instant, il n’en fait aucunement part à ses intimes, même si sa première liaison (avec Reynaldo Hahn) date de cette époque. Léon Daudet décrit Proust arrivant au restaurant Weber vers 1905 : « Vers sept heures et demie arrivait chez Weber un jeune homme pâle, aux yeux de biche, suçant ou tripotant une moitié de sa moustache brune et tombante, entouré de lainages comme un bibelot chinois. Il demandait une grappe de raisin, un verre d’eau et déclarait qu’il venait de se lever, qu’il avait la grippe, qu’il s’allait recoucher, que le bruit lui faisait mal, jetait autour de lui des regards inquiets, puis moqueurs, en fin de compte éclatait d’un rire enchanté et restait. Bientôt sortaient de ses lèvres, proférées sur un ton hésitant et hâtif, des remarques d’une extraordinaire nouveauté et des aperçus d’une finesse diabolique. Ses images imprévues voletaient à la cime des choses et des gens, ainsi qu’une musique supérieure, comme on raconte qu’il arrivait à la taverne du Globe, entre les compagnons du divin Shakespeare. Il tenait de Mercutio et de Puck, suivant plusieurs pensées à la fois, agile à s’excuser d’être aimable, rongé de scrupules ironiques, naturellement complexe, frémissant et soyeux ». L’esthétique de Ruskin Vers 1900, il abandonne la rédaction de ce roman qui nous est parvenu sous forme de fragments manuscrits découverts et édités dans les années 1950 par Bernard de Fallois. Il se tourne alors vers l’esthète anglais John Ruskin, que son ami Robert de Billy, diplomate en poste à Londres de 1896 à 1899, lui fait découvrir. Ruskin ayant interdit qu’on traduise son œuvre de son vivant, Proust le découvre dans le texte, et au travers d’articles et d’ouvrages qui lui sont consacrés, comme celui de Robert de La Sizeranne, Ruskin et la religion de la beauté. À la mort de Ruskin, en 1900, Proust décide de le traduire. À cette fin, il entreprend plusieurs « pèlerinages ruskiniens », dans le nord de la France, à Amiens, et surtout à Venise, où il séjourne avec sa mère, en mai 1900, à l’hôtel Danieli, où séjournèrent autrefois Musset et George Sand. Il retrouve Reynaldo Hahn et sa cousine Marie Nordlinger qui demeurent non loin, et ils visitent Padoue, où Proust découvre les fresques de Giotto, Les Vertus et les Vices qu’il introduit dans La Recherche. Pendant ce temps, ses premiers articles sur Ruskin paraissent dans La Gazette des Beaux Arts. Cet épisode est repris dans Albertine disparue. Les parents de Marcel jouent d’ailleurs un rôle déterminant dans le travail de traduction. Le père l’accepte comme un moyen de mettre à un travail sérieux un fils qui se révèle depuis toujours rebelle à toute fonction sociale et qui vient de donner sa démission d’employé non rémunéré de la bibliothèque Mazarine. La mère joue un rôle beaucoup plus direct. Marcel Proust maîtrisant mal l’anglais elle se livre à une première traduction mot à mot du texte anglais ; à partir de ce déchiffrage, Proust peut alors « écrire en excellent français, du Ruskin », comme le nota un critique à la parution de sa première traduction, La Bible d’Amiens (1904). À l’automne 1900, la famille Proust emménage au 45, rue de Courcelles. C’est à cette époque que Proust fait la connaissance du prince Antoine Bibesco chez sa mère, la princesse Hélène, qui tient un salon où elle invite surtout des musiciens (dont Fauré qui est si important pour la Sonate de Vinteuil, même si c’est finalement la Sonate pour violon et piano no 2 de Brahms qui aura pu servir de modèle à la petite phrase) et des peintres. Les deux jeunes gens se retrouvent après le service militaire dans la Roumanie du prince, en automne 1901. Antoine Bibesco devient un confident intime de Proust, jusqu’à la fin de sa vie, tandis que l’écrivain voyage avec son frère Emmanuel Bibesco, qui aime aussi Ruskin et les cathédrales gothiques. Proust continue encore ses pèlerinages ruskiniens en visitant notamment la Belgique et la Hollande en 1902 avec Bertrand de Fénelon (autre modèle de Saint-Loup) qu’il a connu par l’intermédiaire d’Antoine Bibesco et pour qui il éprouve un attachement qu’il ne peut avouer. Le départ du fils cadet, Robert, qui se marie en 1903, transforme la vie quotidienne de la famille. L’écriture de La Recherche La première phrase de l’œuvre est posée en 1907. Pendant quinze années, Proust vit en reclus dans sa chambre tapissée de liège, au deuxième étage du 102, boulevard Haussmann, où il a emménagé le 27 décembre 1906 après la mort de ses parents, et qu’il quittera en 1919. Portes fermées, Proust écrit, ne cesse de modifier et de retrancher, d’ajouter en collant sur les pages initiales les « paperolles » que l’imprimeur redoute. Plus de deux cents personnages vivent sous sa plume, couvrant quatre générations. Après la mort de ses parents, sa santé déjà fragile se détériore davantage en raison de son asthme. Il s’épuise au travail, dort le jour et ne sort—rarement—que la nuit tombée et dînant souvent au Ritz, seul ou avec des amis. Son œuvre principale, À la recherche du temps perdu, est publiée entre 1913 et 1927. Le premier tome, Du côté de chez Swann (1913), est refusé chez Gallimard sur les conseils d’André Gide, malgré les efforts du prince Antoine Bibesco et de l’écrivain Louis de Robert. Gide exprime ses regrets par la suite. Finalement, le livre est édité à compte d’auteur chez Grasset. L’année suivante, le 30 mai, Proust perd son secrétaire et ami, Alfred Agostinelli, dans un accident d’avion. Ce deuil, surmonté par l’écriture, traverse certaines des pages de La Recherche. Les éditions Gallimard acceptent le deuxième volume, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, pour lequel Proust reçoit en 1919 le prix Goncourt. C’est l’époque où il songe à entrer à l’Académie française, où il a des amis ou soutiens tels que Robert de Flers, René Boylesve, Maurice Barrès, Henri de Régnier... Il ne lui reste plus que trois années à vivre. Il travaille sans relâche à l’écriture des cinq livres suivants de La Recherche et meurt, épuisé, le 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. Il demeurait au 44, rue de l’Amiral-Hamelin à Paris. Une photographie, prise par Man Ray à la demande de Jean Cocteau, montre Marcel Proust sur son lit de mort, le 20 novembre. Les funérailles ont lieu le lendemain, 21 novembre, en l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d’honneur. L’assistance est nombreuse. Barrès dit à Mauriac sur le parvis de l’église : « Enfin, c’était notre jeune homme ! » Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, division 85. Les œuvres Les Plaisirs et les Jours Les Plaisirs et les Jours est un recueil de poèmes en prose et de nouvelles publié par Marcel Proust en 1896 chez Calmann-Lévy. Ce recueil s’inspire fortement du décadentisme et notamment du travail du dandy Robert de Montesquiou. Il s’agit du premier ouvrage de son auteur, qui cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de La Recherche. Jean Santeuil En 1895, Proust entreprend l’écriture d’un roman mettant en scène un jeune homme qui évolue dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Considéré comme une ébauche de La Recherche, Jean Santeuil ne constitue pas un ensemble achevé. Proust y évoque notamment l’affaire Dreyfus, dont il fut l’un des témoins directs. Il est l’un des premiers à faire circuler une pétition favorable au capitaine français accusé de trahison et à la faire signer par Anatole France. Les traductions de Ruskin La Bible d’Amiens (Wikisource) Sésame et les lys (Wikisource)Proust traduit La Bible d’Amiens (1904), de John Ruskin, et ce travail, ainsi que sa deuxième traduction, Sésame et les Lys (1906), est salué par la critique, dont Henri Bergson. Cependant, le choix des œuvres traduites ne se révèle pas heureux et l’ensemble est un échec éditorial. C’est pourtant pour le futur écrivain un moment charnière où s’affirme sa personnalité. En effet, il accompagne ses traductions de notes abondantes et de préfaces longues et riches qui occupent une place presque aussi importante que le texte traduit. Surtout, en traduisant Ruskin, Proust prend peu à peu ses distances avec celui-ci, au point de critiquer ses positions esthétiques. Cela est particulièrement perceptible dans le dernier chapitre de sa préface à La Bible d’Amiens qui tranche avec l’admiration qu’il exprime dans les trois premiers. Il reproche notamment à Ruskin son idolâtrie esthétique, critique qu’il adressa également à Robert de Montesquiou et qu’il fit partager par Swann et dans la Recherche. Pour Proust, c’est dévoyer l’art que d’aimer une œuvre parce que tel écrivain en parle ; il faut l’aimer pour elle-même. Contre Sainte-Beuve Le Contre Sainte-Beuve n’existe pas réellement : il s’agit d’un ensemble de pages, publiées à titre posthume en 1954 sous la forme d’un recueil associant des courts passages narratifs et de brefs essais (ou esquisses d’essais) consacrés aux écrivains que Proust admirait tout en les critiquant : Balzac, Flaubert, etc. Il y attaque Charles-Augustin Sainte-Beuve et sa méthode critique selon laquelle l’œuvre d’un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et ne pourrait s’expliquer que par elle. En s’y opposant, Proust fonde sa propre poétique ; on peut considérer À la recherche du temps perdu comme une réalisation des idées exposées dans ces pages, dont certaines sont reprises par le narrateur proustien dans Le Temps Retrouvé, ou attribuées à des personnages ; d’autre part, nombre de passages narratifs ont été développés dans le roman. Pastiches et Mélanges Pastiches et Mélanges est une œuvre que Proust publie en 1919 à la NRF. Il s’agit d’un recueil de préfaces et d’articles de presse parus principalement dans Le Figaro à partir de 1908, rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard. Un extrait de cette oeuvre “ Journées de Lecture ”, préface à la traduction de Sésame et les lys de Ruskin, a été publié notamment chez 10-18, 1993 (ISBN 2-2640 1811-9), Gallimard, 2017 (ISBN 978-2-0727-0534-2) et Publie.net. À la recherche du temps perdu Des critiques[Qui ?] ont écrit que le roman moderne commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion d’intrigue, l’écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité de l’âme. La composition de La Recherche en témoigne : les thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de correspondances qui s’apparentent à la poésie. Proust voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des fluctuations de la mémoire affective. Il laisse des portraits uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l’amour et la jalousie, une image de la vie, du vide de l’existence, et de l’art. Son style écrit évoque son style parlé, caractérisé par une phrase parfois longue, « étourdissante dans ses parenthèses qui la soutenaient en l’air comme des ballons, vertigineuse par sa longueur, (...) vous engaînait dans un réseau d’incidentes si emmêlées qu’on se serait laissé engourdir par sa musique, si l’on n’avait été sollicité soudain par quelque pensée d’une profondeur inouïe », mais selon « un rythme d’une infinie souplesse. Il le varie au moyen de phrases courtes, car l’idée populaire que la prose de Proust n’est composée que de phrases longues est fausse (comme si d’ailleurs les phrases longues étaient un vice) ». « Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y ait d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini et qui, bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial. « Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l’expérience, sous des mots, quelque chose de différent, c’est exactement le travail inverse de celui que, chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l’amour-propre, la passion, l’intelligence, et l’habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie ». (Le Temps retrouvé) L’œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion majeure sur le temps. La « Recherche du Temps Perdu » permet de s’interroger sur l’existence même du temps, sur sa relativité et sur l’incapacité à le saisir au présent. Une vie s’écoule sans que l’individu en ait conscience et seul un événement fortuit constitué par une sensation—goûter une madeleine, buter sur un pavé—fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé, perdu, a une valeur (notion de « réminiscence proustienne »). Le temps n’existe ni au présent, ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. La descente de l’escalier de Guermantes au cours de laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l’impossibilité qu’il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres. On garde toute sa vie l’image des êtres tels qu’ils nous sont apparus le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables jusqu’à ce que les ayant reconnus l’individu prenne conscience de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne son unité au quotidien fragmenté. L’analyse du snobisme et de la société aristocratique et bourgeoise de son temps fait de l’œuvre de Proust une interrogation majeure des mobiles sociaux de l’individu et de son rapport aux autres, instruments de l’ascension sociale. Comme Honoré de Balzac, Marcel Proust a su créer un monde imaginaire, peuplé de personnages devenus aujourd’hui des types sociaux ou moraux. Comme le Père Goriot, Eugénie Grandet, la Duchesse de Langeais ou Vautrin chez Balzac, Madame Verdurin, la duchesse de Guermantes, Charlus ou Charles Swann sont, chez Proust, des personnages en lesquels s’incarne une caractéristique particulière : ambition, désintéressement, suprématie mondaine, veulerie,,. L’amour et la jalousie sont analysés sous un jour nouveau. L’amour n’existe chez Swann, ou chez le Narrateur, qu’au travers de la jalousie. La jalousie, ou le simple fait de ne pas être l’élu, génèrerait l’amour, qui une fois existant, se nourrirait non de la plénitude de sa réalisation, mais de l’absence. Swann n’épouse Odette de Crécy que lorsqu’il ne l’aime plus. Le Narrateur n’a jamais autant aimé Albertine que lorsqu’elle a disparu (voir Albertine disparue). On n’aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d’inaccessible, on n’aime que ce qu’on ne possède pas, écrit par exemple Proust dans La Prisonnière. Cette théorie développée dans l’œuvre reflète exactement la pensée de Proust, comme l’illustre la célèbre rencontre entre l’écrivain et le jeune Emmanuel Berl, rencontre que ce dernier décrira dans son roman Sylvia (1952). Lorsque Berl lui fait part de l’amour partagé qu’il éprouve pour une jeune femme, Proust dit sa crainte que Sylvia ne s’interpose entre Berl et son amour pour elle, puis devant l’incompréhension de Berl, qui maintient qu’il peut exister un amour heureux, se fâche et renvoie le jeune homme chez lui. La Recherche réserve une place importante à l’analyse de l’homosexualité, en particulier dans Sodome et Gomorrhe où apparaît sous son vrai jour le personnage de Charlus. Enfin, l’œuvre se distingue par son humour et son sens de la métaphore. Humour, par exemple, lorsque le Narrateur reproduit le style lyrique du valet Joseph Périgot ou les fautes de langage du directeur de l’hôtel de Balbec, qui dit un mot pour un autre (« le ciel est parcheminé d’étoiles », au lieu de « parsemé »). Sens de la métaphore, lorsque le Narrateur compare le rabâchage de sa gouvernante, Françoise, une femme d’extraction paysanne qui a tendance à revenir régulièrement sur les mêmes sujets, au retour systématique du thème d’une fugue de Bach. Anecdotes Surnoms et pseudonymes La mère de Proust lui donnait, enfant, des surnoms affectueux, tels « mon petit jaunet » (un jaunet est un louis d’or ou un franc Napoléon en or), « mon petit serin », « mon petit benêt » ou « mon petit nigaud ». Dans ses lettres, son fils était « loup » ou « mon pauvre loup ». Ses amis et relations lui attribuaient d’autres sobriquets, plus ou moins amicaux, tels que « Poney », « Lecram » (anacyclique de Marcel), l’« Abeille des fleurs héraldiques », le « Flagorneur » ou le « Saturnien », et ils utilisaient le verbe « proustifier » pour qualifier sa manière d’écrire. Dans les salons, il était « Popelin Cadet », et ses dîners mémorables dans le grand hôtel parisien lui ont valu l’appellation de « Proust du Ritz ». Le romancier Paul Bourget affubla Proust d’un sobriquet faisant référence à son goût pour les porcelaines de Saxe. Il écrivit à la demi-mondaine Laure Hayman, amie des deux écrivains : « (...) votre saxe psychologique, ce petit Marcel (...) tout simplement exquis ». Laure Hayman avait donné à Marcel Proust un exemplaire de la nouvelle de Paul Bourget Gladys Harvey relié dans la soie d’un de ses jupons. Laure était le modèle supposé du personnage créé par Bourget, et avait écrit sur l’exemplaire offert à Proust une mise en garde : « Ne rencontrez jamais une Gladys Harvey ». Dans ses écrits, Proust a souvent employé des pseudonymes. Ses publications dans la presse sont signées Bernard d’Algouvres, Dominique, Horatio, Marc-Antoine, Écho, Laurence ou simplement D. Illiers-Combray Le village d’Illiers, en Eure-et-Loir, inspira à Proust le lieu fictif de Combray. À l’occasion du centenaire de sa naissance, en 1971, ce village d’Illiers où, enfant, le « petit Marcel » venait passer ses vacances chez sa tante Élisabeth Amiot, lui rendit hommage en changeant de nom pour devenir Illiers-Combray. C’est l’une des rares communes françaises à avoir adopté un nom emprunté à la littérature. La « maison de Tante Léonie », où Proust passa ses vacances d’enfance entre 1877 et 1880, est devenue le Musée Marcel Proust. Un timbre français de 0.30 + 0.10 de 1966 représente Marcel Proust avec le pont Saint-Hilaire à Illiers. Le questionnaire L’écrivain est également connu pour le Questionnaire de Proust (1886), en réalité un simple questionnaire de personnalité auquel il répondit par hasard dans son adolescence, et qui donna à Bernard Pivot l’idée d’élaborer le sien. Quelques réponses sont restées historiques, par exemple, à l’interrogation « Comment aimeriez-vous mourir ? », la réplique : « J’aimerais mieux pas. » Quelques années après son apparition chez Bernard Pivot, le questionnaire traversa l’Atlantique pour se retrouver dans l’émission télévisée Actors’ Studio, où James Lipton interviewe les stars du grand écran. Postérité Avec le temps, Proust s’impose comme l’un des auteurs majeurs du XXe siècle et est considéré dans le monde comme l’un des écrivains, voire l’écrivain le plus représentatif de la littérature française, au même titre que le sont Shakespeare, Cervantes, Dante et Goethe dans leurs pays respectifs, et est identifié à l’essence de ce qu’est la « littérature ». Il s’est écrit davantage de livres sur lui que sur tout autre écrivain français. Publications Ouvrages antérieurs à La Recherche Publiés par ProustLes Plaisirs et les Jours, Calmann-Lévy, 1896 La Bible d’Amiens, préface, traduction et notes de l’ouvrage de John Ruskin The Bible of Amiens, Mercure de France, 1904 Sésame et les lys, traduction de l’ouvrage de John Ruskin Sesame and Lilies, Mercure de France, 1906Ces deux ouvrages de Ruskin ont été réunis dans une édition critique établie par Jérôme Bastianelli, collection Bouquins, Robert Laffont, 2015 Pastiches et Mélanges, NRF, 1919Éditions posthumes Chroniques, 1927 Jean Santeuil, 1952 Contre Sainte-Beuve, 1954 Le chagrin de la marquise, 1961 Chardin et Rembrandt, Le Bruit du temps, 2009 Le Mensuel retrouvé, précédé de « Marcel avant Proust » de Jérôme Prieur (sous-titré Inédits), éditions des Busclats, novembre 2012 Mort de ma grand-mère, suivie d’une conclusion de Bernard Frank (écrivain). Grenoble, Éditions Cent Pages, 2013 (ISBN 978-2-9163-9041-3) À la recherche du temps perdu Éditions originalesDu côté de chez Swann, Grasset, 1913 Partie 1 : Combray Partie 2 : Un amour de Swann Partie 3 : Noms de pays : le nom À l’ombre des jeunes filles en fleurs, NRF, 1918, prix Goncourt Partie 1 : Autour de Mme Swann Partie 2 : Noms de pays : le pays Le Côté de Guermantes I et II, NRF, 1921-1922 Sodome et Gomorrhe I et II, NRF, 1922-1923 La Prisonnière, NRF, 1923 Albertine disparue (La Fugitive), 1925 Le Temps retrouvé, NRF, 1927Éditions diversesA la recherche du temps perdu : L’essentiel lu par Daniel Mesguich aux éditions Frémeaux & Associés Du côté de chez Swann Vol.1– Coffret 4 CD A l’ombre des jeunes filles en fleurs Vol. 2– Coffret 4 CD Le Côté de Guermantes Vol. 3– Coffret 4 CD Sodome et Gomorrhe Vol. 4– Coffret 4 CD Gallimard : Les quatre versions chez Gallimard utilisent toutes le même texte : Pléiade : édition en 4 volumes, avec notes et variantes Folio : édition en 7 volumes, poche Collection blanche : édition en 7 volumes, grand format Quarto : édition en 1 volume, grand format Garnier-Flammarion : édition en 10 volumes, poche Livre de Poche : édition en 7 volumes, poche Bouquins, Robert Laffont : édition en 3 volumes, grand format Omnibus, Presses de la Cité : édition en 2 volumes, grand format Intégrale, lue par André Dussollier, Guillaume Gallienne, Michael Lonsdale, Denis Podalydès, Robin Renucci et Lambert Wilson aux éditions Thélème Texte intégral de l’édition Gallimard de 1946-1947 en ligne sur Gutenberg Le manuscrit retrouvé d’À la recherche du temps perdu, Éditions des Saints-Pères, 2016 Correspondance Plusieurs volumes posthumes, publiés à partir de 1926. Robert de Billy, Marcel Proust, Lettres et conversations, Paris, Éditions des Portiques, 1930 Une première édition en 6 tomes (classée par correspondants), publiée par Robert Proust et Paul Brach : Correspondance générale (1930-1936). Une grande édition de référence en 21 tomes, où les lettres des volumes précédents sont reprises, augmentées, dotées d’une annotation universitaire et classées chronologiquement par Philip Kolb : Correspondance (Plon, 1971-1993). Une édition anthologique de l’édition de Philip Kolb, corrigée et présentée par Françoise Leriche, avec de nouvelles lettres inédites : Marcel Proust, Lettres (Plon, 2004). Bibliographie Ouvrages généraux Pierre Abraham, Proust, Rieder, 1930 Pierre Assouline, Autodictionnaire Proust, Omnibus, 2011 Jérôme Bastianelli, Dictionnaire Proust-Ruskin, Classiques Garnier, 2017, (ISBN 978-2-406-06716-0) Samuel Beckett, Proust, essai composé en anglais en 1930, traduit en français par É. Fournier, Les Éditions de Minuit, 1990 Annick Bouillaguet, Brian G. Rogers (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, coll. « Dictionnaires et références », 2004 Georges Cattaui, Marcel Proust, Proust et son Temps, Proust et le Temps, préface de Daniel-Rops, Julliard, 1953 Pietro Citati, La Colombe poignardée, Proust et la Recherche, Gallimard, 1997 Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Le Seuil, 1989 Antoine Compagnon et autres, Un été avec Proust, Éd. des Équateurs, 2014 Ernst Robert Curtius, Marcel Proust, Paris, La Revue Nouvelle, 1928 Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1970 Ghislain de Diesbach, Proust, Perrin, 1991 Roger Duchêne, L’Impossible Marcel Proust, Robert Laffont, 1994 Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, Plon/Grasset, 2013 Michel Erman, Marcel Proust, Fayard, 1994 Ramon Fernandez, À la gloire de Proust, Éditions de La Nouvelle Revue Critique, 1943 rééd. Grasset sous le titre Proust, 2009 (ISBN 9782246075226). Luc Fraisse, L’Éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, coll. Lettres françaises, 2013. Laure Hillerin, Proust pour Rire– Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, Flammarion, 2016. Edmond Jaloux, Avec Marcel Proust, La Palatine, Genève, 1953 Julia Kristeva, Le Temps sensible : Proust et l’expérience littéraire, Folio Essai, 2000 Giovanni Macchia, L’Ange de la Nuit (Sur Proust), Gallimard, 1993 Diane de Margerie, Proust et l’obscur, Albin Michel, 2010 Diane de Margerie, À la recherche de Robert Proust, Flammarion, 2016 Claude Mauriac, Proust par lui-même, coll. « Écrivains de toujours », Seuil, 1953 François Mauriac, Du côté de chez Proust, La Table ronde, 1947 André Maurois, À la recherche de Marcel Proust, Hachette, 1949, étude et biographie littéraire. Ouvrage collectif, Proust, Hachette (coll. « Génies et réalités »), c1965, 1972 George D. Painter, Marcel Proust, 2 vol., Mercure de France, 1966-1968, traduit de l’anglais et préfacé par Georges Cattaui ; édition revue, en un volume, corrigée et augmentée d’une nouvelle préface de l’auteur, Mercure de France, 1992 Gaëtan Picon, Lecture de Marcel Proust, Mercure de France, 1963 Jérôme Picon, Marcel Proust, une vie à s’écrire, Flammarion, 2016 Léon Pierre-Quint, Marcel Proust, sa vie, son œuvre, Sagittaire, 1946 Jean-François Revel, Sur Proust, Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 1987 Jean-Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Seuil, 1974 Ernest Seillière, Marcel Proust, Éditions de La Nouvelle Revue critique, 1931 Anne Simon, Proust ou le réel retrouvé, Paris, PUF, 2000 Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, NRF/Biographie, Gallimard, 1996 Jean-Yves Tadié, De Proust à Dumas, Gallimard (coll. « Blanche »), 2006 Edmund White, Marcel Proust, Fides, 2001 Ouvrages iconographiques Georges Cattaui, Proust, documents iconographiques, éditions Pierre Cailler, collection « Visages d’hommes célèbres », 1956, 248 pages illustrées de 175 photos relatives à Marcel Proust. Collectif, Le Monde de Proust vu par Paul Nadar, édition du Centre des monuments nationaux / Éditions du Patrimoine, 1999– (ISBN 9782858223077) Pierre Clarac et André Ferré, Album Proust, Gallimard, collection Albums de la Pléiade, 1965. Eric Karpeles, Le musée imaginaire de Marcel Proust– Tous les tableaux de A la recherche du temps perdu, traduit de l’anglais par Pierre Saint-Jean, Thames and Hudson, 2017 André Maurois, Le Monde de Marcel Proust, Hachette, 1960 Mireille Naturel et Patricia Mante-Proust, Marcel Proust. L’Arche et la Colombe, Michel Lafon, 2012. Jérôme Picon, Marcel Proust, album d’une vie, Textuel, 1999. Henri Raczymow, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Parigramme, 1995. Monographies Céleste Albaret (et Georges Belmont), Monsieur Proust, Robert Laffont, 1973. Jacques Bersani (éd.), Les Critiques de notre temps et Proust, Garnier, 1971. Catherine Bidou-Zachariasen, Proust sociologue. De la maison aristocratique au salon bourgeois, Descartes, 1997. Maurice Blanchot, « L’étonnante patience », chapitre consacré à Marcel Proust dans le Livre à venir, Gallimard, 1959. Brassaï, Marcel Proust sous l’emprise de la photographie, Gallimard, 1997. Étienne Brunet, Le Vocabulaire de Marcel Proust, avec l’Index complet et synoptique de À la recherche du temps perdu, 3 vol., 1918 p., Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1983 (préface de J.Y. Tadié). (ISBN 2051004749) (ISBN 9782051004749). Alain Buisine, Proust et ses lettres, Presses Universitaires de Lille, coll. « Objet », 1983. Jean-Yves Tadié, Marcel Proust : La cathédrale du temps, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard/Littératures » (no 381), 1999, rééd. 2017 Philippe Chardin, Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare, Honoré Champion, 2006. Philippe Chardin, Originalités proustiennes, Kimé, 2010 Philippe Chardin et Nathalie Mauriac Dyer, Proust écrivain de la Première Guerre mondiale, Dijon, EUD, 2014. Józef Czapski, Proust contre la déchéance : Conférence au camp de Griazowietz, Noir sur blanc, 2004 et 2011. Serge Doubrovsky, La Place de la madeleine, Écriture et fantasme chez Proust, Mercure de France, 1974. Robert Dreyfus, Souvenirs sur Marcel Proust (accompagnés de lettres inédites), Paris, Grasset, 1926. Maurice Duplay, Mon ami Marcel Proust : souvenirs intimes. Cet ouvrage contient notamment une lettre de Marcel Proust à Maurice Duplay, Editions Gallimard, 1972 Clovis Duveau, Proust à Orléans, édité par les Musées d’Orléans, 1998. Michel Erman, Le Bottin proustien. Qui est dans « La Recherche » ?, Paris, La Table Ronde, 2010. Michel Erman, Le Bottin des lieux proustiens, La Table ronde, 2011. Luc Fraisse, L’Œuvre cathédrale. Proust et l’architecture médiévale, José Corti, 1990, 574 pages. Louis Gautier-Vignal, Proust connu et inconnu, Robert Laffont, 1976. Jean-Michel Henny, Marcel Proust à Évian. Étape d’une vocation. Chaman édition, Neuchâtel, 2015. Geneviève Henrot Sostero, Pragmatique de l’anthroponyme dans À la recherche du temps perdu, Paris, Champion, 2011. Anne Henry, La Tentation de Proust, Paris, PUF, 2000, (ISBN 2-13-051075-2) Laure Hillerin, La comtesse Greffulhe. L’ombre des Guermantes, Flammarion, 2014. Philip Kolb, La correspondance de Marcel Proust, chronologie et commentaire critique, University of Illinois Press, 1949 Elisabeth Ladenson, Proust lesbien (préface d’Antoine Compagnon), Ed. EPEL 2004. Luc Lagarde, Proust à l’orée du cinéma, L’âge d’Homme, 2016 Nathalie Mauriac Dyer, Proust inachevé, le dossier Albertine disparue, Honoré Champion, 2005. Marie Miguet-Ollagnier, La Mythologie de Marcel Proust, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Annales littéraires de l’Université de Besançon », 1982, 425 p. (ISBN 2-251-60276-3). Christian Péchenard, Proust à Cabourg ; Proust et son père ; Proust et Céleste, in Proust et les autres, Éditions de la Table ronde, 1999. Léon Pierre-Quint, Comment travaillait Proust, Bibliographie, Les Cahiers Libres, 1928. Georges Poulet, L’Espace proustien, Gallimard, 1963. Jérôme Prieur, Proust fantôme, Gallimard, 2001 et 2006 Jérôme Prieur Marcel avant Proust, suivi de Proust, Le Mensuel retrouvé, éditions des Busclats, 2012 Henri Raczymow, Le Cygne de Proust, Gallimard, coll. L’un et l’autre, 1990. Jean Recanati, Profils juifs de Marcel Proust, Paris, Buchet-Chastel, 1979. Thomas Ravier, Éloge du matricide : Essai sur Proust, Gallimard, coll. « L’Infini », Paris, 2008, 200 p. (ISBN 978-2-07-078443-1) Jacqueline Risset, Une certaine joie. Essai sur Proust, Éditions Hermann, 2009. Jean-Yves Tadié (dir.), Proust et ses amis, Colloque fondation Singer-Polignac, Gallimard, « Les cahiers de la NRF », 2010. Nayla Tamraz, Proust Portrait Peinture, Paris, Orizons, coll. Universités/Domaine littéraire, 2010 Davide Vago, Proust en couleur, coll. « Recherches proustiennes », Honoré Champion, 2012 (ISBN 9782745323927) Stéphane Zagdanski, Le Sexe de Proust, Gallimard, 1994 (ISBN 2070738779) Adaptations Filmographie Céleste, de Percy Adlon, film allemand avec pour personnage principal Céleste Albaret (1981). Le Temps retrouvé, de Raoul Ruiz (1998). Un amour de Swann, de Volker Schlöndorff (1984). La Captive, de Chantal Akerman (2000). À la recherche du temps perdu, téléfilm en deux parties de Nina Companeez (diffusé sur France 2 en février 2011). Divers Suso Cecchi D’Amico et Luchino Visconti : À la recherche du temps perdu, scénario d’après Marcel Proust, Persona, 1984. Harold Pinter : Le Scénario Proust : À la recherche du temps perdu, avec la collaboration de Joseph Losey et Barbara Bray, traduction de l’anglais par Jean Pavans, scénario d’après Marcel Proust, Gallimard, Paris, 2003. Stéphane Heuet : À la recherche du temps perdu, bande dessinée d’après Marcel Proust, 5 vol. parus, Delcourt, Tournai, Belgique, 1998-2008. Alberto Lombardo, L’Air de rien, adaptation théâtrale de À la recherche du temps perdu sur la relation Albertine-Marcel, 1988. À la recherche du temps perdu, version manga, traduit du japonais par Julien Lefebvre-Paquet, Soleil Manga, 2011 (ISBN 2-302-01879-6) Voir aussi Prix Marcel-Proust Prix de la Madeleine d’or L’hôtel littéraire Le Swann a été inauguré le 14 novembre 2013 pour le centenaire de la publication de Du côté de chez Swann, le premier tome d’À la recherche du temps perdu. Il est situé 11-15 rue de Constantinople à Paris, dans le 8e arrondissement. L’ensemble de la décoration rend hommage à Marcel Proust et à son œuvre et un espace d’exposition présente des livres rares et des manuscrits. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust


Charles-Augustin Sainte-Beuve est un critique litté, raire et écrivain français, né le 23 décembre 1804 à Boulogne-sur-Mer et mort le 13 octobre 1869 à Paris. La méthode critique de Sainte-Beuve se fonde sur le fait que l’œuvre d’un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et pourrait s’expliquer par elle. Elle se fonde sur la recherche de l’intention poétique de l’auteur (intentionnisme) et sur ses qualités personnelles (biographisme). Cette méthode a été critiquée par la suite. Marcel Proust, dans son essai Contre Sainte-Beuve, est le premier à la contester, reprochant de plus à Sainte-Beuve de négliger, voire condamner de grands auteurs comme Baudelaire, Stendhal ou Balzac. L’école formaliste russe, ainsi que les critiques Ernst Robert Curtius et Leo Spitzer, suivront Proust dans cette route. Cette opposition entre Sainte-Beuve et Proust peut aussi se comprendre comme un renversement de perspective de la critique littéraire. En effet, il faut reconnaître à Sainte-Beuve une capacité de critique formelle fondée: il l’a montré avec le Salammbô de Flaubert, si bien que Flaubert lui-même en tint compte dans la suite de son œuvre. Seulement, chez lui, cette analyse semble devoir rester subordonnée à la connaissance de la vie de l’auteur, et c’est là que s’opère le renversement proustien: si rapport il y a entre l’œuvre et la vie de son auteur, pour Proust c’est bien la première qui doit apparaître comme la plus riche source d’enseignements sur le sens profond de la seconde. Ce renversement est à la base de la poétique de Proust et s’incarne dans À la recherche du temps perdu. S’il est moins connu du grand public de nos jours, entre 1870 et au moins jusqu’aux années 1950, il est resté longtemps l’une des figures majeures du panthéon littéraire transmis par l’école républicaine, avec Victor Hugo, Montaigne ou Lamartine, et tous les écoliers connaissaient au moins son nom. Biographie Né à Moreuil le 6 novembre 1752, le père de l’auteur, Charles-François Sainte-Beuve, contrôleur principal des droits réunis et conseiller municipal à Boulogne-sur-Mer, se marie le 30 nivôse an XII (21 janvier 1804) avec Augustine Coilliot, fille de Jean-Pierre Coilliot, capitaine de navire, née le 22 novembre 1764. Toutefois, atteint par une angine, il meurt le 12 vendémiaire an XIII (4 octobre 1804). Orphelin de père dès sa naissance le 2 nivôse an XIII (23 décembre 1804) à Boulogne-sur-Mer, Sainte-Beuve est élevé par sa mère et une tante paternelle, veuve également. En 1812, il entre en classe de sixième comme externe libre à l’institution Blériot, à Boulogne-sur-Mer, où il reste jusqu’en 1818. À cette époque, il obtient de poursuivre ses études à Paris. Placé dans l’institution Landry en septembre 1818, il suit comme externe les cours du collège Charlemagne, de la classe de troisième à la première année de rhétorique, puis ceux du collège Bourbon, où il a pour professeur Paul-François Dubois, en seconde année de rhétorique et en philosophie. En 1822, il est lauréat du Concours général, remportant le premier prix de poésie latine. Après l’obtention de son baccalauréat ès lettres, le 18 octobre 1823, il s’inscrit à la faculté de médecine le 3 novembre. Puis, conformément à l’ordonnance du 2 février 1823, qui l’exige pour les professions médicales, il prend des leçons particulières de mathématiques et passe le baccalauréat ès sciences, le 17 juillet 1824. Toutefois, alors qu’il a été nommé en 1826 externe à l’hôpital Saint-Louis avec une chambre, il abandonne ses études de médecine en 1827 pour se consacrer aux lettres. Après un article anonyme paru le 24 octobre 1824, il publie dans Le Globe, journal libéral et doctrinaire fondé par son ancien professeur, Paul-François Dubois, un article signé « Joseph Delorme » le 4 novembre. Le 2 et le 9 janvier 1827, il publie une critique élogieuse des Odes et ballades de Victor Hugo, et les deux hommes se lient d’amitié. Ensemble, ils assistent aux réunions au Cénacle de Charles Nodier à la Bibliothèque de l’Arsenal. Il a une liaison avec l’épouse de Hugo, Adèle Foucher. Le 20 septembre 1830, Sainte-Beuve et l’un des propriétaires du journal Le Globe, Paul-François Dubois, se battent en duel dans les bois de Romainville. Sous la pluie, ils échangent quatre balles sans résultats. Sainte-Beuve conserva son parapluie à la main, disant qu’il voulait bien être tué mais pas mouillé. Après l’échec de ses romans, Sainte-Beuve se lance dans les études littéraires, dont la plus connue est Port-Royal, et collabore notamment à La Revue contemporaine. Port-Royal (1837-1859), le chef-d’œuvre de Saint-Beuve, décrit l’histoire de l’abbaye de Port-Royal des Champs, de son origine à sa destruction. Ce livre résulte d’un cours donné à l’Académie de Lausanne entre le 6 novembre 1837 et le 25 mai 1838. Cette œuvre a joué un rôle important dans le renouvellement de l’histoire religieuse. Certains historiens qualifient Port-Royal de « tentative d’histoire totale ». Élu à l’Académie française le 14 mars 1844 au fauteuil de Casimir Delavigne, il est reçu le 27 février 1845 par Victor Hugo. Il est à noter que ce dernier portait néanmoins sur leurs relations un regard désabusé: « Sainte-Beuve, confiait-il à ses carnets en 1876, n’était pas poète et n’a jamais pu me le pardonner . » En 1848-1849, il accepte une chaire à l’université de Liège, où il donne un cours consacré à Chateaubriand et son groupe littéraire, qu’il publie en 1860. À partir d’octobre 1849, il publie, successivement dans Le Constitutionnel, Le Moniteur et Le Temps des feuilletons hebdomadaires regroupés en volumes sous le nom de Causeries du lundi, leur titre venant du fait que le feuilleton paraissait chaque lundi. À la différence de Hugo, il se rallie au Second Empire en 1852. Le 13 décembre 1854, il obtient la chaire de poésie latine au Collège de France, mais sa leçon inaugurale sur « Virgile et L’Énéide », le 9 mars 1855, est perturbée par des étudiants qui veulent dénoncer son ralliement. Il doit alors envoyer, le 20 mars, sa lettre de démission. Par la suite, le 3 novembre 1857, il est nommé maître de conférences à l’École normale supérieure, où il donne des cours de langue et de littérature françaises de 1858 à 1861. Sous l’Empire libéral, il est nommé au Sénat, où il siège du 28 avril 1865 jusqu’à sa mort en 1869. Dans ces fonctions, il défend la liberté des lettres et la liberté de penser. Réception Friedrich Nietzsche, pourtant adversaire déclaré de Sainte-Beuve, a incité en 1880 Ida Overbeck, femme de son ami Franz Overbeck, à traduire les Causeries du lundi en allemand. Jusque-là, Sainte-Beuve n’avait jamais été publié en allemand, malgré sa grande importance en France, car considéré en Allemagne comme représentant d’une manière détestable et typiquement française de penser. La traduction d’Ida Overbeck est parue en 1880 sous le titre Menschen des XVIII. Jahrhunderts (« l’être humain au XVIIIe siècle »). Nietzsche a écrit à Ida Overbeck le 18 août 1880: « Il y a une heure que j’ai reçu Menschen des XVIII. Jahrhunderts. [...] C’est un livre merveilleux, je crois que j’ai pleuré, et ce serait bizarre si ce petit livre ne pouvait pas exciter la même sensation chez beaucoup d’autres personnes ». La traduction d’Ida Overbeck est un document important du transfert culturel entre l’Allemagne et la France, mais fut largement ignorée. En 2014 apparut la première édition critique et annotée. Charles Maurras s’inspire directement de la méthode d’analyse du critique littéraire pour forger sa methode d’analyse politique, l’empirisme organisateur, qui aboutira chez lui au nationalisme intégral,. Œuvres Poésie * Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829) * Les Consolations (1830) * Pensées d’août (1837) * Livre d’amour (1843) * Poésies complètes (1863) Romans et nouvelles * Volupté (1834)– réédité par S.E.P.E. en 1947 avec illustrations de Marguerite Bermond. * Madame de Pontivy (1839) * Christel (1839) * Le Clou d’or qu’il dédia à Sophie de Bazancourt, femme de lettres et épouse du général François Aimé Frédéric Loyré d’Arbouville. * La Pendule (1880) Critique * Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle (1828), 2 volumes * Port-Royal (1840-1859), 5 volumes * Portraits littéraires (1844 et 1876-78), 3 volumes * Portraits contemporains (1846 et 1869-71), 5 volumes * Portraits de femmes (1844 et 1870) * Les Lundis * Causeries du lundi (1851-1862), 16 volumes * Nouveaux lundis (1863-1870), 13 volumes * Premiers lundis (1874-75), 3 volumes * Étude sur Virgile (1857). Texte de cette étude annoté par Henri Goelzer en 1895. * Chateaubriand et son groupe littéraire (1860), 2 volumes * Le Général Jomini (1869) * Madame Desbordes-Valmore: sa vie et sa correspondance (1870) * M. de Talleyrand (1870) * P.-J. Proudhon (1872) * Chroniques parisiennes (1843-1845 et 1876) * Les cahiers de Sainte-Beuve (1876) * Mes poisons (1926): carnet secret édité à titre posthume Correspondance * Lettres à la princesse (Mathilde) (1873) * Correspondance (1877-78), 2 volumes * Nouvelle correspondance (1880) * Lettres à Collombet (1903) * Correspondance avec M. et Mme Juste Olivier (1904) * Lettres à Charles Labitte (1912) * Lettres à deux amies (1948) * Lettres à George Sand * Lettres à Adèle Couriard * Correspondance générale, 19 volumes Biographie * Le général Jomini, étude, Paris 1869. Texte sur Gallica Hommage * Denys Puech (1854-1942), Monument à Sainte-Beuve, 1898, Paris, jardin du Luxembourg. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_Sainte-Beuve
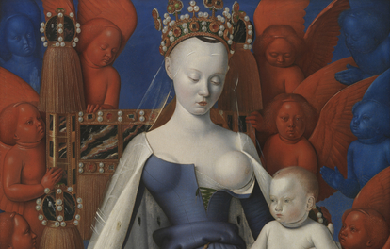

François Villon (1431-après 1463) Poète français du Moyen Âge, auteur de la célèbre Ballade des pendus, qui est considéré comme l’un des pères de la poésie moderne. Poète «!malfaiteur!» Issu d’une famille pauvre, François de Montcorbier, ou François des Loges, orphelin de père très jeune, fut élevé par le chanoine de Saint-Benoît-le-Bestourné, maître Guillaume de Villon, son «!plus que père!», dont il prit le nom pour lui rendre hommage. Après avoir été reçu bachelier en 1449, il devint licencié puis maître ès arts à Paris en 1452. À part ces quelques faits sur sa jeunesse, la vie de François Villon est remplie de zones d’ombre, et les seuls indices biographiques certains dont nous disposions sur sa vie adulte sont d’origine judiciaire, ce qui renforce l’image légendaire de poète «!malfaiteur!» qui est la sienne depuis la fin du Moyen Âge. Notons que cette image est aussi une tradition littéraire, dont Rutebeuf est l’un des autres exemples. La première affaire judiciaire grave dont nous ayons trace eut lieu le 5 juin 1455 : au cours d’une rixe, Villon tua Philippe Sermoise, un prêtre qui l’aurait provoqué!; blessé lui-même, il se fit panser sous le nom de Michel Mouton et dut quitter Paris, où il ne revint qu’en 1456, après avoir obtenu des lettres de rémission sous son vrai nom. On sait aussi que, durant la nuit de Noël 1456, il commit un vol avec effraction au collège de Navarre, ce qui l’obligea à quitter de nouveau Paris avec le fruit de son larcin. Il prétendit avoir écrit, au moment du vol, un poème célèbre, le Lais, également connu sous le nom de Petit Testament, pour s’en excuser et expliquer sa fuite par une raison sentimentale. Dans cette œuvre, en effet, Villon annonce son départ pour Angers afin, dit-il, de se consoler d’une déception amoureuse - mais ce n’est là qu’un prétexte à une satire de l’amour courtois. Prenant congé de ses amis et de ses connaissances, le poète fait dans ce poème une série de legs parodiques!; tout au long de cette «!donation!», il joue sur les mots «!lais!» et «!legs!», et use abondamment de double sens. À la cour de Charles d’Orléans Durant les années suivantes, Villon mena une vie d’errance, dont on sait peu de chose!; il séjourna, semble-t-il, à Angers chez un parent, puis à la cour de Jean II de Bourbon, établie à Moulins, puis à la cour de Charles d’Orléans, à Blois, l’une des plus raffinées du temps. Le séjour de Villon auprès du duc, qui marque un moment de paix dans cette existence incertaine, est attesté par la présence de trois de ses pièces dans le manuscrit autographe de Charles d’Orléans!; parmi ces pièces se trouvent notamment la Ballade des contradictions qui débute par le vers «!Je meurs de soif auprès d’une fontaine!», et qui traite de façon originale d’un thème rhétorique usé qui avait été donné par le duc d’Orléans comme sujet d’un concours de poésie. À cette même époque, Villon entretint des rapports avec la bande des Coquillards, une société criminelle plus ou moins secrète : nous ignorons s’il en faisait vraiment partie, mais il est certain qu’il connaissait le jargon de la Coquille, puisque nous possédons entre six et onze Ballades en jargon (le chiffre varie en raison des problèmes d’attribution), dont la compréhension reste difficile et la signification ambiguë. Voir Ballades (littérature). Le Testament Au cours de l’été 1461, Villon fut incarcéré à Meung-sur-Loire pour des raisons inconnues, à l’initiative de l’Évêque d’Orléans!; cette captivité le marqua profondément. Libéré le 2 octobre grâce à l’arrivée de Louis XI dans la ville, il rentra à Paris, où il composa le Testament (v. 1462). C’est vers 1462 que François Villon composa son œuvre principale, le Testament. La première partie de ce texte est une méditation consacrée essentiellement à la perte de la jeunesse, aux méfaits de l’amour mais surtout à la mort (cette partie contient la célèbre ballade désignée par Clément Marot en 1532 sous le titre de Ballade des dames du temps jadis). La seconde partie reprend, en l’approfondissant, la fiction testamentaire déjà abordée dans le Lais : Villon va jusqu’à choisir les exécuteurs, son sépulcre et le service religieux. La Ballade des pendus Impliqué dans une rixe au cours de laquelle François Ferrebouc, notaire pontifical, fut blessé, Villon fut arrêté, torturé et condamné à la pendaison, et fit appel de la sentence. C’est sans doute pendant ces jours pénibles qu’il écrivit la Ballade des pendus, intitulée aussi l’Épitaphe Villon, où se manifeste notamment son obsession des corps pourrissants. Le 5 janvier 1463, le parlement de Paris commua la peine en dix ans de bannissement. Ce sont là les dernières traces des faits et gestes de François Villon que nous possédions. Importance et postérité de l’œuvre S’il n’innova guère dans son usage des formes poétiques, Villon porta la ballade à sa perfection. Son œuvre est dominée par l’ambiguïté et par l’importance considérable accordée à la personne du poète, ce qui est rare au Moyen Âge, où le sujet poétique n’est souvent qu’une forme vide et où la poésie est considérée davantage comme un jeu rhétorique que comme le lieu de l’expression d’une individualité. Si Villon ridiculise souvent la tradition de l’amour courtois, il s’y inscrit pourtant parfois avec certains de ses poèmes, comme l’atteste sa Ballade à amie. La poésie de Villon est surtout marquée par une hantise profonde de la mort. Ce thème obsédant, que ne dissimule pas un usage fréquent de l’ironie, traverse toute son œuvre, où domine l’évocation des souffrances physiques et morales dans un monde désenchanté et sombre. En outre, lorsque Villon décrit la vie quotidienne, c’est souvent sur un ton réaliste ou pathétique. La postérité de Villon est immense et ne se dément pas depuis le XVIe siècle, où Clément Marot donna la première édition commentée de ses œuvres (1532)!; sa gloire doit aussi beaucoup à la fascination qu’il exerça sur les poètes du XIXe siècle, notamment les romantiques comme Théophile Gautier, qui inaugura avec une étude sur Villon sa série des «!grotesques!», ces textes critiques qu’il consacrait essentiellement aux «!petits!» auteurs du XVIe et du XVIIe siècle. Les références Encyclopédie Encarta (c) Microsoft

Manuel Díaz Martínez (Santa Clara, 13 de septiembre de 1936 – Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2023) fue un poeta, periodista y diplomático cubano de nacimiento, posteriormente nacionalizado español. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española. Fue diplomático en Bulgaria, investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, redactor-jefe del suplemento cultural Hoy Domingo y de La Gaceta de Cuba. Fue uno de los firmantes en 1991 de la Declaración de los intelectuales cubanos (más conocida como Carta de los diez), una carta abierta a Fidel Castro de diez escritores cubanos en la que le solicitaban la democratización del régimen.

Pierre-Jean de Béranger, né le 19 août 1780 à Paris, et mort dans cette même ville le 16 juillet 1857, est un chansonnier français prolifique qui remporta un énorme succès à son époque. Plus connu sous le simple nom de Béranger, il est le fils de Jean-François Béranger de Mersix et de Marie-Jeanne Champy.


Paul Claudel, né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fère dans l’ancien presbytère du village dans l’Aisne et mort le 23 février 1955 à Paris, est un dramaturge, poète, essayiste et diplomate français. Membre de l’Académie française, il est le frère de la sculptrice Camille Claudel. Biographie Jeunesse Paul Louis Charles Claudel est le fils de Louis-Prosper Claudel, un haut fonctionnaire de province, né à La Bresse dans les Vosges, et de Louise Athénaïse Cerveaux. Frère cadet de Louise Claudel, pianiste,[réf. souhaitée] et de la sculptrice Camille Claudel qui réalisa en 1884 son buste « en jeune romain », dont un des quatre exemplaires en bronze réalisés à partir de l’original (fonte Gruet de 1893) est exposé au Musée des Augustins de Toulouse (don baron Alphonse de Rothschild, 1895), il grandit à Villeneuve-sur-Fère. De 1882 à 1886 il vit à Paris avec sa mère et ses sœurs au 135bis, boulevard du Montparnasse, puis de 1886 à 1892 au 31, boulevard de Port-Royal. Il fait ses études au lycée Louis-le-Grand où il obtient son baccalauréat de philosophie en 1885 et s’inscrit à l’École libre des sciences politiques pour y préparer une licence de droit. Claudel, selon ses dires, baignait, comme tous les jeunes gens de son âge, dans « le bagne matérialiste » du scientisme de l’époque. Il se convertit au catholicisme, religion de son enfance, en assistant en curieux aux vêpres à Notre-Dame de Paris le 25 décembre 1886, jour de Noël. « J’étais debout, près du deuxième pilier, à droite, du côté de la sacristie. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. En un instant mon cœur fut touché et je crus ». À la même époque, il découvre les Illuminations, le recueil de poèmes d’Arthur Rimbaud, dont la lecture sera pour lui déterminante. L’influence de celui qu’il appelait le « mystique à l’état sauvage » est manifeste, notamment, dans Tête d’or, une de ses premières pièces de théâtre. Le diplomate Passé une velléité d’entrer dans les ordres, il entre dans la carrière diplomatique en 1893. Tout d’abord premier vice-consul à New York puis à Boston, il est nommé consul à Shanghai en 1895. Il est alors appuyé par le secrétaire général du Quai d’Orsay, Philippe Berthelot. À l’âge de 32 ans, en 1900, il veut mettre fin à sa carrière diplomatique pour devenir moine bénédictin et postule à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé. Les supérieurs du monastère ne l’admettront pas comme moine mais, en 1905, il deviendra oblat de cette même abbaye. De retour en Chine, il y poursuit sa carrière diplomatique et, après avoir été consul à Shanghai (1895), il devient vice-consul à Fou-Tchéou (Fuzhou, 1900) puis consul à Tientsin (Tianjin, 1906-09). Il est ensuite consul à Prague (1909) Francfort (1911) et Hambourg (1913) avant d’être nommé ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro (1916), et à Copenhague (1920). Il est ambassadeur à Tokyo (1922), à Washington (1928) puis à Bruxelles (1933), où se termine sa carrière diplomatique en 1936. L’écrivain engagé Claudel s’installe alors définitivement dans le château de Brangues en Isère, qu’il avait acquis en 1927 pour y passer ses étés. Le travail littéraire, mené jusqu’alors parallèlement à sa carrière diplomatique, occupe désormais la plus grande part de son existence. Il reçoit à Brangues diverses notoriétés : des hommes politiques comme le président Édouard Herriot, ou des écrivains comme François Mauriac. Georges Clemenceau, amateur de littérature et lui-même écrivain, a laissé cette sévère appréciation de la prose claudélienne : « J’ai d’abord cru que c’était un carburateur et puis j’en ai lu quelques pages– et non, ça n’a pas carburé. C’est des espèces de loufoqueries consciencieuses comme en ferait un Méridional qui voudrait avoir l’air profond… » En 1934 c’est lui qui écrit puis déclame l’éloge funèbre pour son ami, l’ancien secrétaire général du Quai d’Orsay, Philippe Berthelot. Pendant la guerre d’Espagne, Claudel apporta son soutien aux franquistes. Geneviève Dreyfus-Armand écrit que : « Paul Claudel, que son statut de diplomate contraignait sans doute à la réserve, sortit pourtant de celle-ci en mai 1937 en écrivant un poème dédié « aux martyrs espagnols » morts à cause de leur foi. Ce poème servit de préface à l’ouvrage du Catalan Joan Estelrich (es), La Persécution religieuse en Espagne, publié à Paris en 1937 pour dénoncer les violences anticléricales. François Mauriac reprocha à Claudel de n’avoir pas écrit un seul vers pour « les milliers et les milliers d’âmes chrétiennes que les chefs de l’Armée Sainte […] ont introduits dans l’éternité » ». L’auteur ajoute que Bernanos lui répondit en publiant Les Grands Cimetières sous la lune et précise en outre que Claudel signa le « Manifeste aux intellectuels espagnols » du 10 décembre 1937 publié dans le magazine de propagande franquiste Occident, dirigé par Estelrich. Claudel, d’autre part, refusa de rejoindre le Comité français pour la paix civile et religieuse en Espagne lancé par Jacques Maritain. Enzo Traverso va plus loin en écrivant que « De son côté, le monde catholique a cessé d’être un bloc conservateur : il se divise entre une droite qui, notamment à cause de la guerre civile espagnole, se fascise – il suffit de penser aux poèmes de Paul Claudel à la gloire de Franco—, et une « gauche », au sens topologique du terme, qui reconnaît la légitimité de l’antifascisme. Traumatisés par la violence franquiste, François Mauriac et Georges Bernanos adoptent une position de soutien ou de neutralité bienveillante à l’égard de la République, tant en Espagne qu’en France. ». En 1938, Claudel entre au conseil d’administration de la Société des Moteurs Gnome et Rhône, grâce à la bienveillance de son directeur, Paul-Louis Weiller, mécène et protecteur de nombreux artistes (Jean Cocteau, Paul Valéry, André Malraux). Ce poste, richement doté, lui vaudra des critiques, à la fois par le statut social et le montant des émoluments qu’il en retire mais aussi par le fait qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette entreprise de mécanique participe à l’effort de guerre allemand pendant l’Occupation. Selon l’hebdomadaire royaliste L’Indépendance française, cité par Le Dictionnaire des girouettes[réf. à confirmer], « sans aucune nécessité et sans aucun travail, simplement pour avoir assisté six fois au Conseil d’administration, il a touché 675 000 francs. Bénéfices de guerre, bénéfices de la guerre allemande ». À partir de 1940, Paul-Louis Weiller, juif, est déchu de la nationalité française. Les hésitations devant la seconde guerre mondiale Attristé par les débuts de la guerre, et notamment l’invasion de la Pologne, au cours d’un mois de septembre 1939 qu’il juge par ailleurs « merveilleux », Claudel est initialement peu convaincu par le danger que représente l’Allemagne nazie. Il s’inquiète davantage de la puissante Russie qui représente selon lui une « infâme canaille communiste ». En 1940, il est ulcéré par la défaite de la France, mais voit d’abord une délivrance dans les pleins pouvoirs conférés par les députés à Pétain. Dressant dans son Journal un « état de la France au 6 juillet 1940 », il met au passif la sujétion de la France à l’Allemagne, la brouille avec l’Angleterre « en qui seule est notre espérance éventuelle » et la présence au gouvernement de Pierre Laval, qui n’inspire pas confiance. À l’actif, il met l’épuisement de l’Allemagne et de l’Italie, le gain de forces de l’Angleterre et un changement idéologique qu’il décrit comme suit : « La France est délivrée après soixante ans de joug du parti radical et anticatholique (professeurs, avocats, juifs, francs-maçons). Le nouveau gouvernement invoque Dieu et rend la Grande-Chartreuse aux religieux. Espérance d’être délivré du suffrage universel et du parlementarisme ; ainsi que de la domination méchante et imbécile des instituteurs qui lors de la dernière guerre se sont couverts de honte. Restauration de l’autorité. » (Ce qui concerne les instituteurs est un écho d’une conversation de Claudel avec le général Édouard Corniglion-Molinier et Antoine de Saint-Exupéry, qui, selon Claudel, lui avaient parlé « de la pagaille des troupes françaises, les officiers (les réservistes instituteurs " lâchant pied " les premiers). ») Le 24 septembre 1940, Claudel va plus loin encore : « Ma consolation est de voir la fin de cet immonde régime parlementaire qui, depuis des années, dévorait la France comme un cancer généralisé. C’est fini [...] de l’immonde tyrannie des bistrots, des francs-maçons, des métèques, des pions et des instituteurs... » Il faut rappeler que Bernanos avait fustigé Pétain dès juin 1940. Toutefois, le spectacle de la collaboration avec l’Allemagne l’écœure bientôt. En novembre 1940, il note dans le même Journal : « Article monstrueux du cardinal Baudrillart dans La Croix nous invitant à collaborer « avec la grande et puissante Allemagne » et faisant miroiter à nos yeux les profits économiques que nous sommes appelés à en retirer ! (...) Fernand Laurent dans Le Jour déclare que le devoir des catholiques est de se serrer autour de Laval et de Hitler.—Les catholiques de l’espèce bien-pensante sont décidément écœurants de bêtise et de lâcheté ». Dans le Figaro du 10 mai 1941, il publie encore des Paroles au Maréchal (désignées couramment comme l’Ode à Pétain) qui lui sont souvent reprochées. La péroraison en est : « France, écoute ce vieil homme sur toi qui se penche et qui te parle comme un père./ Fille de saint Louis, écoute-le ! et dis, en as-tu assez maintenant de la politique ?/ Écoute cette voix raisonnable sur toi qui propose et qui explique. ». Henri Guillemin (critique catholique et grand admirateur de Claudel, mais non suspect de sympathie pour les pétainistes) a raconté que, dans un entretien de 1942, Claudel lui expliqua ses flatteries à Pétain par l’approbation d’une partie de sa politique (lutte contre l’alcoolisme, appui aux écoles libres), la naïveté envers des assurances que Pétain lui aurait données de balayer Laval et enfin l’espoir d’obtenir une protection en faveur de son ami Paul-Louis Weiller et des subventions aux représentations de l’Annonce faite à Marie. À partir d’août 1941, le Journal ne parle plus de Pétain qu’avec mépris. Dans le Figaro du 23 décembre 1944, il publie Un poème au général de Gaulle qu’il avait récité au cours d’une matinée du Théâtre-Français consacrée aux « Poètes de la Résistance ». La consécration Claudel a mené une constante méditation sur la parole, qui commence avec son théâtre et se poursuit dans une prose poétique très personnelle, s’épanouit au terme de sa vie dans une exégèse biblique originale. Cette exégèse s’inspire fortement de l’œuvre de l’Abbé Tardif de Moidrey (dont il a réédité le commentaire du Livre de Ruth), mais aussi d’Ernest Hello. Claudel s’inscrit ainsi dans la tradition patristique du commentaire scripturaire, qui s’était peu à peu perdue avec la scolastique, et qui a été reprise au XIXe siècle par ces deux auteurs, avant de revenir sur le devant de la scène théologique avec le cardinal Jean Daniélou et Henri de Lubac. Sa foi catholique est essentielle dans son œuvre qui chantera la création : « De même que Dieu a dit des choses qu’elles soient, le poète redit qu’elles sont. » Cette communion de Claudel avec Dieu a donné ainsi naissance à près de quatre mille pages de textes. Il y professe un véritable partenariat entre Dieu et ses créatures, dans son mystère et dans sa dramaturgie, comme dans Le Soulier de satin et L’Annonce faite à Marie. Avec Maurice Garçon, Charles de Chambrun, Marcel Pagnol, Jules Romains et Henri Mondor, il est l’une des six personnalités élues le 4 avril 1946 à l’Académie française lors de la deuxième élection groupée de cette année, visant à combler les très nombreuses places vacantes laissées par la période de l’Occupation. Il est reçu à l’Académie française le 13 mars 1947 par François Mauriac, au fauteuil de Louis Gillet. De 1953 à 1955 il participe à la revue littéraire de Jean-Marc Langlois-Berthelot et Jean-Marc Montguerre, L’Échauguette. Il fut membre du Comité d’honneur du Centre culturel international de Royaumont. Il meurt le 23 février 1955 à Paris, au 11 boulevard Lannes à l’âge de 86 ans. Il est enterré dans le parc du château de Brangues ; sa tombe porte l’épitaphe : « Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel. » (Il faut probablement lire le mot « semence » à la lumière de la doctrine de la résurrection de la chair : à la fin des temps, lors du retour glorieux du Christ, les morts ressusciteront ; les restes humains sont ainsi la semence de la chair transfigurée qui sera celle de la résurrection. D’où l’importance de la sépulture dans la religion chrétienne, et les réticences face à l’incinération par exemple.) Le travail d’édition et d’annotation de son Journal est réalisé après sa mort par son ami François Varillon, prêtre jésuite et théologien, et par Jacques Petit, dans la bibliothèque de la Pléiade. L’exégèse religieuse On peut aussi passer par l’exégèse religieuse à laquelle Claudel s’est consacré la plupart de sa vie. Pour lui, la foi n’est pas seulement une persistance dans sa critique sur l’art, mais plutôt une nourriture pour son esprit et son âme. Il consacre plusieurs articles typiques à ce sujet : Vitraux des Cathédrales de France, la Cathédrale de Strasbourg, l’Art et la Foi, l’Art Religieux, etc. Il met en lumière l’esprit religieux partout où il le peut. C’est la façon pour lui d’exprimer sa méditation sur son intimité d’homme et de croyant. Il nous confie même parfois sa foi pour aider à comprendre ses textes. La Bible est perçue comme une œuvre poétique par Claudel, qui le stimule à interroger et à commenter les tableaux avec un style qui parfois s’en inspire. La déclamation Comme poète, Claudel porte une grande attention à la diction, à l’énonciation ou à la déclamation, les réclamant comme de son domaine propre d’écrivain. Il dit, dans une correspondance à son ami Édouard Bourdet : « Je n’admettrai jamais que la musique associée à un texte poétique dépende exclusivement du choix du metteur en scène. En réalité, il s’agit d’une émanation du texte et c’est l’auteur qui doit être responsable de l’une comme de l’autre. » Il recherche toute sa vie une énonciation intelligible et signifiante. Pour lui elle s’opère dans l’attention au diseur, et en détachant syntaxe et souffle : il peut aller jusqu’à proposer un silence au milieu d’une phrase, même au milieu d’un mot ou au milieu d’une syllabe ou d’un phonème. Par exemple, à la répartie de Don Camille à Prouhèze dans Le Soulier de Satin : « Et cependant qui diable m’a fait, je vo|us prie, si ce n’est pas elle seule ? », il indique un soupir au milieu du mot vous. Il retient d’autres principes expressifs : accentuer sur les consonnes et moins sur les voyelles, placer une inflexion en début de vers et le terminer dans légère atténuation de voix. Dans son rapport avec le comédien, le sens n’est pas enserré dans l’écrit, mais procède du travail vocal du diseur. Ce travail, à la différence de la versification classique, n’est pas préalablement fixé, c’est au diseur de se mettre à son école. Amours de Paul Claudel Paul Claudel a une liaison avec Rosalie Ścibor-Rylska, d’origine polonaise, épouse de Francis Vetch, entrepreneur et affairiste. Il la rencontre en 1900 sur le bateau qui l’amène avec son mari en Chine, et a une fille naturelle, Louise Vetch (1905-1996), compositrice et cantatrice. Rosalie Vetch inspire le personnage d’Ysé dans Partage de midi et celui de Prouhèze dans Le Soulier de satin. Elle repose à Vézelay, où sa tombe porte ce vers du poète : « Seule la rose est assez fragile pour exprimer l’éternité », vers extrait de Cent phrases pour éventails. Famille Paul Claudel épouse à Lyon le 14 mars 1906 Reine Sainte-Marie-Perrin (1880-1973), fille de Louis Sainte-Marie Perrin, architecte de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Le couple embarque trois jours plus tard pour la Chine, où Claudel est consul à Tientsin. Ils ont cinq enfants : Marie (1907-1981), Pierre (1908-1979), Reine (1910-2007), Henri (1912-2016), et Renée (née en 1917). En septembre 1913, la sculptrice Camille Claudel, sœur de Paul, est internée en asile d’aliénés à Mondevergues (Montfavet– Vaucluse) à la demande de la famille et à l’instigation de son frère Paul, qui décide d’agir immédiatement après la mort de leur père. En trente ans d’hospitalisation, Paul Claudel ne va voir sa sœur qu’à douze reprises. Lors de la rétrospective qui lui fut consacrée en 1934, des témoins ont rapporté que Paul Claudel s’emporte : il ne veut pas qu’on sache qu’il a une sœur folle. À la mort de celle-ci, en 1943, Paul Claudel ne se déplace pas : Camille est inhumée au cimetière de Montfavet accompagnée du seul personnel de l’hôpital ; quelques années plus tard, ses restes sont transférés dans une fosse commune, ni Paul ni les membres de la famille Claudel n’ayant proposé de sépulture. L’ancien presbytère où il est né est devenu la Maison de Camille et de Paul Claudel, exposant des œuvres de Camille et des documents inédits sur Paul Claudel. Œuvres * Théâtre1887 : L’Endormie (première version) * 1888 : Fragment d’un drame * 1890 : Tête d’or (première version) * 1892 : La Jeune Fille Violaine (première version) * 1893 : La Ville (première version) * 1894 : Tête d’or (deuxième version) ; L’Échange (première version) * 1899 : La Jeune Fille Violaine (deuxième version) * 1901 : La Ville (deuxième version) * 1901 : Le Repos du septième jour * 1906 : Partage de midi, drame (première version) * 1911 : L’Otage, drame en trois actes * 1912 : L’Annonce faite à Marie (première version) * 1913 : Protée, drame satirique en deux actes (première version) * 1917 : L’Ours et la Lune * 1918 : Le Pain dur, drame en trois actes * 1919 : Les Choéphores d’Eschyle * 1920 : Le Père humilié, drame en quatre actes * 1920 : Les Euménides d’Eschyle * 1926 : Protée, drame satirique en deux actes (deuxième version) * 1927 : Sous le rempart d’Athènes * 1929 : Le Soulier de satin ou Le pire n’est pas toujours sûr, action espagnole en quatre journées (créé partiellement en 1943 par Jean-Louis Barrault, en version intégrale au théâtre d’Orsay en 1980; la version intégrale a été reprise en 1987 par Antoine Vitez) * 1933 : Le Livre de Christophe Colomb, drame lyrique en deux parties * 1939 : Jeanne d’Arc au bûcher * 1939 : La Sagesse ou la Parabole du destin (sous le pseudonyme de Delachapelle) * 1942 : L’Histoire de Tobie et de Sara, moralité en trois actes * 1947 : L’Endormie (deuxième version) * 1948 : L’Annonce faite à Marie (deuxième version) * 1949 : Protée, drame satirique en deux actes (deuxième version) * 1954 : L’Échange (deuxième version) * * Poésie1900, puis 1907 (2e éd.): Connaissance de l’Est * 1905 : Poèmes de la Sexagésime * 1907 : Processionnal pour saluer le siècle nouveau * 1911 : Cinq grandes odes * 1911 : Le Chemin de la Croix * 1911–1912 : La Cantate à trois voix * 1915 : Corona benignitatis anni dei * 1919 : La Messe là-bas * 1922 : Poèmes de guerre (1914-1916) * 1925 : Feuilles de saints * 1942 : Cent phrases pour éventails * 1945 : Visages radieux * 1945 : Dodoitzu, illustrations de Rihakou Harada. * 1949 : AccompagnementsEssais1907 : Art poétique. Œuvre composée de trois traités : Connaissance du temps. Traité de la co-naissance au monde et de soi-même. Développement de l’Église * 1928 : Positions et propositions, tome I * 1929 : L’Oiseau noir dans le soleil levant * 1934 : Positions et propositions, tome II * 1935 : Conversations dans le Loir-et-Cher * 1936 : Figures et paraboles * 1940 : Contacts et circonstances * 1942 : Seigneur, apprenez-nous à prier * 1946 : L’œil écoute * 1949 : Emmaüs * 1950 : Une voix sur Israël * 1951 : L’Évangile d’Isaïe * 1952 : Paul Claudel interroge l’Apocalypse * 1954 : Paul Claudel interroge le Cantique des Cantiques * 1955 : J’aime la Bible, Fayard * 1956 : Conversation sur Jean Racine * 1957 : Sous le signe du dragon * 1958 : Qui ne souffre pas… Réflexions sur le problème social * 1958 : Présence et prophétie * 1959 : La Rose et le rosaire * 1959 : Trois figures saintes pour le temps actuel * Mémoires, journal1954 : Mémoires improvisés. Quarante et un entretiens avec Jean Amrouche * 1968 : Journal. Tome I : 1904-1932 * 1969 : Journal. Tome II : 1933-1955Correspondance1949 : Correspondance de Paul Claudel et André Gide (1899-1926) * 1951 : Correspondance de Paul Claudel et André Suarès (1904-1938) * 1952 : Correspondance de Paul Claudel avec Gabriel Frizeau et Francis Jammes (1897-1938), accompagnée de lettres de Jacques Rivière * 1961 : Correspondance Paul Claudel et Darius Milhaud (1912-1953) * 1964 : Correspondance de Paul Claudel et Lugné-Poe (1910-1928). Claudel homme de théâtre * 1966 : Correspondances avec Copeau, Dullin, Jouvet. Claudel homme de théâtre * 1974 : Correspondance de Jean-Louis Barrault et Paul Claudel * 1984 : Correspondance de Paul Claudel et Jacques Rivière (1907-1924) * 1990 : Lettres de Paul Claudel à Élisabeth Sainte-Marie Perrin et à Audrey Parr * 1995 : Correspondance diplomatique. Tokyo (1921-1927) * 1995 : Correspondance de Paul Claudel et Gaston Gallimard (1911-1954) * 1996 : Paul Claudel, Jacques Madaule Connaissance et reconnaissance : Correspondance 1929-1954, DDB * 1998 : Le Poète et la Bible, volume 1, 1910-1946, Gallimard, coll. « Blanche » * 2002 : Le Poète et la Bible, volume 2, 1945-1955, Gallimard, coll. « Blanche » * 2004 : Lettres de Paul Claudel à Jean Paulhan (1925-1954), Correspondance présentée et annotée par Catherine Mayaux, Berne : Paul Lang, 2004 (ISBN 3-03910-452-7) * 2005 : Correspondance de Paul Claudel avec les ecclésiastiques de son temps. Volume I, Le sacrement du monde et l’intention de gloire, éditée par Dominique Millet-Gérard, Paris : Champion, coll. « Bibliothèque des correspondances, mémoires et journaux » n° 19, 2005, 655 p. (ISBN 2-7453-1214-6). * 2005 : Une Amitié perdue et retrouvée. Correspondance de Paul Claudel et Romain Rolland, édition établie, annotée et présentée par Gérald Antoine et Bernard Duchatelet, Paris : Gallimard, coll. « Les cahiers de la NRF », 2005, 479 p. (ISBN 2-07-077557-7) * 2017: Lettres à Ysé. Correspondance de Paul Claudel et Rosalie Vetch (éd. Gérald Antoine, préf. Jacques Julliard), Paris, Gallimard, 2017, 464 p., (ISBN 978-2070769117). Décoration * Grand-croix de la Légion d’honneur. Divers * Claudel a plus d’une fois exprimé son peu de goût pour les écrivains français du dix-septième siècle, à l’exception de Bossuet, qu’il admirait vivement.[réf. souhaitée] Le directeur de l’école des beaux-arts de Paris lui ayant demandé un sujet de concours de peinture, il proposa “ Hippolyte étendu sans forme et sans couleur.” (Racine, Phèdre, acte V)[réf. souhaitée][pertinence contestée] * Claudel n’a pas eu que des admirateurs, mais aussi des détracteurs. Après la mort de Claudel, André-Paul Antoine, journaliste à L’Information, a publié cette épitaphe littéraire dans son journal : « Si M. Paul Claudel mérite quelque admiration, ce n’est ni comme poète, ni comme diplomate, ni comme Français, c’est comme maître-nageur. » Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Claudel


Anatole France, pour l’état civil François Anatole Thibault, né le 16 avril 1844 à Paris, et mort le 12 octobre 1924 à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), est un écrivain français, considéré comme l’un des plus grands de l’époque de la Troisième République, dont il a également été un des plus importants critiques littéraires. Il devient une des consciences les plus significatives de son temps en s’engageant en faveur de nombreuses causes sociales et politiques du début du XXe siècle. Il reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre en 1921. Biographie Anatole France naît à Paris, 19 quai Malaquais. Il est issu par son père d’une famille modeste originaire du Maine-et-Loire: son père, François Noël Thibault, dit Noël France, né le 4 nivôse an XIV (25 décembre 1805) à Luigné, dans le canton de Thouarcé, a quitté son village en 1825 pour entrer dans l’armée. Sous-officier légitimiste, il démissionne au lendemain de la Révolution de 1830. Il se marie, le 29 février 1840, avec Antoinette Gallas à la mairie du 4e arrondissement de Paris. La même année, il devient propriétaire d’une librairie sise 6, rue de l’Oratoire du Louvre. Il tient ensuite une librairie quai Malaquais (no 19), d’abord nommée Librairie France-Thibault, puis France tout court, spécialisée dans les ouvrages et documents sur la Révolution française, fréquentée par de nombreux écrivains et érudits, comme les frères Goncourt ; il s’installera, en 1853, quai Voltaire (no 9) . Par sa mère, Antoinette Gallas, Anatole est issu d’une famille de meuniers de Chartres, les Gallas. Élevé dans la bibliothèque paternelle, Anatole en gardera le goût des livres et de l’érudition, ainsi qu’une connaissance intime de la période révolutionnaire, arrière-plan de plusieurs de ses romans et nouvelles, dont Les dieux ont soif, qui est considéré comme son chef-d’œuvre. De 1844 à 1853, il habite l’hôtel particulier du 15 quai Malaquais. De 1853 à 1862, France fait ses études à l’institution Sainte-Marie et au collège Stanislas. Il souffre d’être pauvre dans un milieu riche mais il est remarqué pour ses compositions, dont La Légende de sainte Radegonde, qui sera éditée par la librairie France et publiée en revue. Il obtient son baccalauréat le 5 novembre 1864. À partir du début des années 1860, il travaille pour diverses libraires et revues, mais refuse de prendre la suite de son père, qui juge très négativement les « barbouillages » de son fils. Sa carrière littéraire commence par la poésie ; amoureux de l’actrice Élise Devoyod, il lui dédie quelques poèmes, mais elle le repousse en 1866. Il est disciple de Leconte de Lisle, avec qui il travaillera quelque temps comme bibliothécaire au Sénat. En janvier 1867, il écrit une apologie de la liberté cachée sous un éloge du Lyon Amoureux de Ponsard, et la même année il fait partie du groupe du Parnasse . En 1875, il intègre le comité chargé de préparer le troisième recueil du Parnasse contemporain. En 1876, il publie Les Noces corinthiennes chez Lemerre, éditeur pour lequel il rédige de nombreuses préfaces à des classiques (Molière par exemple) ainsi que pour Charavay ; certaines de ces préfaces seront réunies dans Le Génie Latin. La même année, il devient commis-surveillant à la Bibliothèque du Sénat, poste qu’il conserve jusqu’à sa démission, le 1er février 1890. Anatole France se marie en 1877 avec Valérie Guérin de Sauville, petite-fille de Jean-Urbain Guérin, un miniaturiste de Louis XVI (voir famille Mesnil), dont il a une fille, Suzanne, née en 1881, qui mourra en 1918. Il la confie souvent, dans son enfance, à Mme de Martel (qui écrivait sous le nom de Gyp), restée proche à la fois de lui-même et de Mme France. Les relations de France avec les femmes sont difficiles. Ainsi a-t-il, dans les années 1860, nourri un amour vain pour Elisa Rauline, puis pour Élise Devoyod. En 1888, il engage une liaison avec Léontine Arman de Caillavet, qui tient un célèbre salon littéraire de la Troisième République, de qui il dira “sans elle, je ne ferais pas de livres” (journal de l’abbé Mugnier) ; cette liaison durera jusqu’à la mort de celle-ci, en 1910, peu après une tentative de suicide à cause d’une autre liaison de France avec une actrice connue pendant un voyage en Amérique du Sud. Mme de Caillavet lui inspire Thaïs (1890) et Le Lys rouge (1894). Après une ultime dispute avec son épouse, qui ne supporte pas cette liaison, France quitte le domicile conjugal de la rue Chalgrin, un matin de juin 1892, et envoie une lettre de séparation à son épouse. Le divorce est prononcé à ses torts et dépens, le 2 août 1893. Par la suite, France aura de nombreuses liaisons, comme celle avec Mme Gagey, qui se suicidera en 1911. France s’oriente tardivement vers le roman et connaît son premier succès public à 37 ans, en 1881, avec Le Crime de Sylvestre Bonnard, couronné par l’Académie française, œuvre remarquée pour son style optimiste et parfois féerique, tranchant avec le naturalisme qui règne alors. Il devient en 1887 critique littéraire du prestigieux Temps. Élu, dès le premier tour, avec 21 voix sur 34 présents, à l’Académie française le 23 janvier 1896, au fauteuil 38, où il succède à Ferdinand de Lesseps, il y est reçu le 24 décembre 1896. Devenu un écrivain reconnu, influent et riche, France s’engage en faveur de nombreuses causes. Il tient plusieurs discours dénonçant le génocide arménien et soutient Archag Tchobanian, rejoint Émile Zola, avec qui il s’est réconcilié au début des années 1890, lors de l’affaire Dreyfus. Après avoir refusé de se prononcer sur la culpabilité d’Alfred Dreyfus (ce qui le classe parmi les révisionnistes), dans un entretien accordé à L’Aurore le 23 novembre 1897, il est l’un des deux premiers avec Zola à signer, au lendemain de la publication de J’accuse, en janvier 1898, quasiment seul à l’Académie française, la première pétition dite « des intellectuels » demandant la révision du procès. Il dépose, le 19 février 1898, comme témoin de moralité lors du procès Zola (il prononcera un discours lors des obsèques de l’écrivain, le 5 octobre 1902), quitte L’Écho de Paris, anti-révisionniste, en février 1899, et rejoint le 5 juillet suivant Le Figaro, conservateur et catholique, mais dreyfusard. Il servit de modèle, avec Paul Bourget, pour créer l’homme de lettres Bergotte dans l’œuvre de Proust, À la recherche du temps perdu. En juillet 1898, il rend sa Légion d’honneur, après que l’on eut retiré celle d’Émile Zola et, de février 1900 à 1916, refuse de siéger à l’Académie française. Il participe à la fondation de la Ligue des droits de l’Homme, dont il rejoint le Comité central en décembre 1904, après la démission de Joseph Reinach, scandalisé par l’affaire des fiches. Son engagement dreyfusard se retrouve dans les quatre tomes de son Histoire contemporaine (1897– 1901), chronique des mesquineries et des ridicules d’une préfecture de province au temps de l’Affaire. C’est dans cette œuvre qu’il forge les termes xénophobe et trublion. Devenu un proche de Jean Jaurès, il préside, le 27 novembre 1904, une manifestation du Parti socialiste français au Trocadéro et prononce un discours. France s’engage pour la séparation de l’Église et de l’État, pour les droits syndicaux, contre les bagnes militaires. En 1906, lors d’une réunion, il proteste fortement contre la « barbarie coloniale ». En 1909, il part pour l’Amérique du Sud faire une tournée de conférences sur Rabelais. S’éloignant de Mme de Caillavet, il a une liaison avec la comédienne Jeanne Brindeau, en tournée elle aussi avec des acteurs français. Rabelais est remplacé, au cours du voyage qui le mène à Lisbonne, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo et Buenos Aires, par des conférences sur ses propres œuvres et sur la littérature contemporaine. De retour à Paris, le lien avec Léontine, qui avait beaucoup souffert de cet éloignement, se reforme tant bien que mal, mais celle-ci meurt en janvier 1910, sans lui avoir réellement pardonné. En 1913, il voyage en Russie. Au début de la Première Guerre mondiale, France écrit des textes guerriers et patriotes, qu’il regrettera par la suite: il dénonce la folie guerrière voulue par le système capitaliste dans le contexte de l’Union sacrée en déclarant: « on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels », mais milite en faveur d’une paix d’amitié entre Français et Allemands ce qui suscitera l’indignation et l’hostilité, et lui vaudra des lettres d’insultes et des menaces de mort. Il prend position en 1919 contre le Traité de Versailles, signant la protestation du groupe Clarté intitulée « Contre la paix injuste », et publiée dans L’Humanité, le 22 juillet 1919. Ami de Jaurès et de Pressensé, il collabore, dès sa création, à L’Humanité, en publiant Sur la pierre blanche dans les premiers numéros. Proche de la SFIO, il sera, plus tard, critique envers le PCF. S’il écrit un Salut aux Soviets, dans L’Humanité de novembre 1922, il proteste contre les premiers procès faits aux socialistes révolutionnaires en envoyant un télégramme dès le 17 mars. À partir de décembre 1922, il est exclu de toute collaboration aux journaux communistes. France, tout en adhérant aux idées socialistes, s’est ainsi tenu à l’écart des partis politiques, ce dont témoignent ses romans pessimistes sur la nature humaine, tels que L’Île des Pingouins et surtout Les dieux ont soif (publié en 1912) qui, à cause de sa critique du climat de Terreur des idéaux utopistes, est mal reçu par la gauche. En 1920 il se marie à Saint-Cyr-sur-Loire, où il s’était installé en 1914, avec sa compagne Emma Laprévotte (1871-1930), afin qu’elle veille sur son petit-fils Lucien Psichari, orphelin de mère. Il est lauréat, en 1921, du prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre, et le reçoit à Stockholm le 10 décembre. En 1922 l’ensemble de ses œuvres (opera omnia) fait l’objet d’une condamnation papale (décret de la Congrégation du Saint-Office du 31 mai 1922). Pour son 80e anniversaire, au lendemain de la victoire du Cartel des gauches, il assiste à une manifestation publique donnée en son honneur, le 24 mai 1924, au palais du Trocadéro. Il meurt le 12 octobre 1924 à La Béchellerie, commune de Saint-Cyr-sur-Loire. À l’annonce de sa mort, le président de la Chambre des députés Paul Painlevé déclare: « Le niveau de l’intelligence humaine a baissé cette nuit-là. » Selon certains (André Bourin, 1992), France aurait souhaité être inhumé dans le petit cimetière de Saint-Cyr-sur-Loire, pour d’autres (Michel Corday, 1928), le sachant souvent inondé l’hiver, il préférait rejoindre la sépulture de ses parents au cimetière de Neuilly-sur-Seine. Son corps, embaumé le 14 octobre, est transféré à Paris pour des obsèques quasi-nationales et exposé Villa Saïd, où le président de la République, Gaston Doumergue, vient lui rendre hommage dans la matinée du 17 octobre, suivi par le président du Conseil, Édouard Herriot. En contradiction avec ses dispositions testamentaires, des obsèques nationales ont lieu à Paris le 18 octobre, et il est inhumé au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine auprès de ses parents. Sa tombe, abandonnée et en piteux état, fut sauvée en 2000, par l’historien Frédéric de Berthier de Grandry, résidant alors à Neuilly-sur-Seine ; cette procédure de sauvegarde sauve également la chapelle funéraire de Pierre Puvis de Chavannes, le peintre du Panthéon de Paris. Le 19 novembre 1925, l’Académie française élit au siège de France, après quatre tours de scrutin, Paul Valéry, qui, reçu dix-neuf mois plus tard, ne prononce pas une seule fois, contrairement à l’usage, le nom de son prédécesseur dans l’éloge qu’il doit prononcer et le qualifie de « lecteur infini ». Collectionneur d’art et bibliophile « […] Les sculptures antiques le ravissaient. Bien des fragments précieux ornent les murailles de la Béchellerie […] Son cabinet de travail de la villa Said était tout éclairé par un marbre, un torse de femme, acheté avec le comte Primoli en Italie dans un antre où l’on fabriquait de faux Botticelli […] Il avait collectionné des anges et des saints en bois sculpté, qu’il nommait plaisamment « ses bondieuseries » […] Mais il était très sévère sur l’authenticité du moindre objet […]. Il connaissait tous les émois, toutes les alertes, de la chasse aux occasions. Je l’ai vu battre pas à pas le marché à la ferraille, sur les quais de Tours, soutenu par l’espoir de dénicher le gibier rare […] les livres anciens le passionnaient tout particulièrement. Il sortait même de sa modestie ordinaire et il étalait complaisamment les signes originaux de ses livres rares. Il abondait toujours en anecdotes sur les amateurs « toujours, à dessein, vêtus comme des mendigots » et sur les antiquaires. Ce goût des rares et vieilles choses, il l’appliquait à l’aménagement de son logis […] son occupation préférée. Il surveillait de très près la pose des meubles et des tableaux, traquait la moindre hérésie […] accrochait lui-même des gravures, de menus médaillons. ». Selon son ami et biographe Michel Corday, craignant les conséquences du climat humide de sa maison tourangelle pour ses meubles et objets d’art—et livres anciens et rares, selon l’éditrice Claude Arthaud (les Maisons du Génie, Arthaud, 1967, p. 150 à 169, ill.)—il fit transporter les plus précieux Villa Saïd, maison qui échut ensuite à sa veuve. « C’était l’antre de l’honnête homme 1900 qui se voue aux lettres et à l’amour […]. Quand il rentrait dans la maison, c’était pour y déplacer des statues, trouver de nouvelles places à de nouveaux objets récemment acquis. Il n’aimait guère ceux du XIXe siècle et disait volontiers: « Cela, c’est de la basse époque ». Il était de cette génération qui croit au style plus qu’à l’objet lui-même […] La Béchellerie est devenue le garde-meubles des styles de haute époque » (Arthaud, op. cit.). Rien de tout ce qui appartint à un écrivain quasiment vénéré de son vivant n’a subsisté dans sa dernière demeure en partie du fait que son petit-fils, devenu employé subalterne de la maison Calmann-Lévy—éditeur de son grand’père—le dispersa discrètement peu à peu par l’intermédiaire de l’Hôtel des Ventes de Vendôme, alors que les « maisons d’écrivains » n’étaient pas intégrées au patrimoine littéraire national. Quant au corps de bibliothèque qui abrita les éditions princeps de Rabelais, Racine et Voltaire collectionnées avec passion par France, il tomba en morceaux dans les mains du menuisier venu pour le récupérer (témoignage oral de Mme D., Saint-Cyr-sur-Loire, 23 septembre 2014)… Publiant des photographies de la propriété dont le bureau et la bibliothèque encore meublées vers 1967, Arthaud évoquait « la cour d’honneur, ses vases de fonte pleins de fleurs, sa statue de femme, et si rien n’est plus étonnant et curieux que le capharnaum bavarois de la chambre d’amis […] rien n’est plus triste que cette chambre où sont restées encore à demi-fondues dans leurs chandeliers les bougies qui servirent à veiller l’écrivain durant sa longue agonie » (op. cit.). « J’avais, comme tous les bibliophiles, un Enfer composé de volumes illustrés de gravures scabreuses. Eh bien, il ne m’en reste pas un seul. On m’a tout pris. » (France à M. Corday). Plusieurs ouvrages de France dont un exemplaire d’épreuves de l’Anneau d’améthyste (1899) corrigé et portant un envoi à Lucien Guitry, ainsi que d’autres offerts au comédien ou à son fils Sacha, figurèrent dans la vente publique de la bibliothèque de celui-ci à Paris le 25 mars 1976 (nos 149 à 154 du catalogue—arch pers.). D’autres figurèrent dans les catalogues 63, 65 et 75 du libraire Pierre Bérès, et une importante série d’ouvrages comprenant des exemplaires uniques—certains ayant appartenu à Mme de Caillavet—et enrichis d’envois, et de lettres dont 53 adressées à son égérie de 1888 à 1890, figura dans la bibliothèque littéraire de Charles Hayoit (nos 407 à 439 du catalogue de la vente publique par Sotheby’s-Poulain-Le Fur des 29 et 30 novembre 2001). Par ailleurs, certains exemplaires d’éditions originales de Voltaire portant le cachet de sa propriété tourangelle furent vendus par Sotheby’s à Monaco les 13 et 14 avril 1986. La Bibliothèque historique de la ville de Paris possède un « fonds Anatole France » composé de manuscrits de ses œuvres, de correspondances ainsi que de tous les livres de sa bibliothèque personnelle, qui a été enrichi par dons et par acquisitions au cours du XXe siècle. Œuvre Thèmes et style Les principaux thèmes de son œuvre en prose émergent du recueil Balthasar et du roman plusieurs fois remanié Le Crime de Sylvestre Bonnard. Marie-Claire Bancquart signale entre autres le personnage de l’érudit sensible, ridicule ou aimable, qui a sa vie derrière lui, la bibliothèque (qui possède une présence charnelle), l’action et la justice. Ces thèmes sont particulièrement exposés dans des discours ou des conversations par des personnages tels que Sylvestre Bonnard, Jérôme Coignard et M. Bergeret. Le style de France, souvent qualifié de classique, se caractérise par une ironie amusée, parfois douce et aimable, parfois noire et cruelle, qui exprime son scepticisme foncier à l’égard de la nature humaine, de ses aspirations et de la connaissance, en particulier l’histoire. L’œuvre de France tranche tant avec les courants littéraires de son temps (naturalisme) qu’avec la politique française en matière d’éducation après la guerre franco-allemande de 1870. Contre l’éducation exclusivement scientifique prônée par Jean Macé ou Louis Figuier, il valorise la force réelle de l’imagination: « Fermez-moi ce livre, mademoiselle Jeanne, laissez là, s’il vous plaît, « l’Oiseau bleu, couleur du temps » que vous trouvez si aimable et qui vous fait pleurer, et étudiez vite l’éthérisation. Il serait beau qu’à sept ans vous n’eussiez pas encore une opinion faite sur la puissance anesthésique du protoxyde d’azote! » M. Louis Figuier a découvert que les fées sont des êtres imaginaires. C’est pourquoi il ne peut souffrir qu’on parle d’elles aux enfants. Il leur parle du guano, qui n’a rien d’imaginaire.—Eh bien, docteur, les fées existent précisément parce qu’elles sont imaginaires. Elles existent dans les imaginations naïves et fraîches, naturellement ouvertes à la poésie toujours jeune des traditions populaires.Il refuse le réalisme de Zola, qu’il juge brutal, et, à l’esprit scientifique en littérature, il oppose des écrivains comme Dickens et Sand, car, pour lui: « L’artiste qui ne voit les choses qu’en laid n’a pas su les voir dans leurs rapports, avec leurs harmonies [...]. » Toutefois, son attitude à l’égard de Zola évolue au début des années 1890 avec La Bête humaine, L’Argent et La Débâcle, auxquels il consacre des articles élogieux. Ses œuvres comportent donc de nombreux éléments féeriques et souvent proches du fantastique. C’est dans le même esprit qu’il aborde l’histoire, se défiant des prétentions scientistes, non pour réduire cette discipline à une fable, mais pour souligner les incertitudes qui lui sont inhérentes. L’histoire est un thème qui revient souvent dans ses œuvres. Le style qu’il utilise pour en parler est caractéristique de l’ironie et de l’humour franciens: « Si je confesse aujourd’hui mon erreur, si j’avoue l’enthousiasme inconcevable que m’inspira une conception tout à fait démesurée, je le fais dans l’intérêt des jeunes gens, qui apprendront, sur mon exemple, à vaincre l’imagination. Elle est notre plus cruelle ennemie. Tout savant qui n’a pas réussi à l’étouffer en lui est à jamais perdu pour l’érudition. Je frémis encore à la pensée des abîmes dans lesquels mon esprit aventureux allait me précipiter. J’étais à deux doigts de ce qu’on appelle l’histoire. Quelle chute! J’allais tomber dans l’art. Car l’histoire n’est qu’un art, ou tout au plus une fausse science. Qui ne sait aujourd’hui que les historiens ont précédé les archéologues, comme les astrologues ont précédé les astronomes, comme les alchimistes ont précédé les chimistes, comme les singes ont précédé les hommes ? Dieu merci! j’en fus quitte pour la peur. »France utilise plusieurs types d’ironie: il peut s’agir de faire parler naïvement des personnages en sorte que le lecteur en saisisse le ridicule ou bien d’exprimer avec loquacité l’antithèse de ce que l’auteur pense, en faisant sentir l’ineptie des propos tenus. Le premier genre d’humour est le plus léger et imprègne tout particulièrement L’Île des Pingouins, qualifiée de « chronique bouffonne de la France » par Marie-Claire Bancquart. La seconde sorte d’humour se manifeste surtout par une ironie noire qu’illustre par exemple le conte 'Crainquebille’, histoire d’une injustice sociale ; France fait ainsi dire à un personnage qui analyse le verdict inique prononcé par un juge: « Ce dont il faut louer le président Bourriche, lui dit-il, c’est d’avoir su se défendre des vaines curiosités de l’esprit et se garder de cet orgueil intellectuel qui veut tout connaître. En opposant l’une à l’autre les dépositions contradictoires de l’agent Matra et du docteur David Matthieu, le juge serait entré dans une voie où l’on ne rencontre que le doute et l’incertitude. La méthode qui consiste à examiner les faits selon les règles de la critique est inconciliable avec la bonne administration de la justice. Si le magistrat avait l’imprudence de suivre cette méthode, ses jugements dépendraient de sa sagacité personnelle, qui le plus souvent est petite, et de l’infirmité humaine, qui est constante. Quelle en serait l’autorité ? On ne peut nier que la méthode historique est tout à fait impropre à lui procurer les certitudes dont il a besoin. » Résumé de ses œuvres Le Crime de Sylvestre Bonnard Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, est un historien et un philologue, doté d’une érudition non dénuée d’ironie: « Savoir n’est rien – dit-il un jour – imaginer est tout. » Il vit au milieu des livres, la cité des livres, mais se lance à la recherche, en Sicile et à Paris, du précieux manuscrit de La Légende dorée qu’il finit un jour par obtenir. Le hasard lui fait rencontrer la petite fille d’une femme qu’il a jadis aimée et, pour protéger l’enfant d’un tuteur abusif, il l’enlève. La jeune fille épousera par la suite un élève de M. Bonnard. Ce roman, qui fut jugé spirituel, généreux et tendre, fit connaître Anatole France. Histoire contemporaine À partir de 1895, France commença à écrire des chroniques pour L’Écho de Paris, sous le titre de Nouvelles ecclésiastiques. Ces textes formeront le début de Histoire contemporaine. Autour d’un enseignant à l’université de Tourcoing, une tétralogie satirique de la société française sous la Troisième république, du boulangisme au début du XXe siècle. Les dieux ont soif Les dieux ont soif est un roman paru en 1912, décrivant les années de la Terreur à Paris, France, entre l’an I et l’an II. Sur fond d’époque révolutionnaire, France, qui pensait d’abord écrire un livre sur l’inquisition, développe ses opinions sur la cruauté de la nature humaine et sur la dégénérescence des idéaux de lendemains meilleurs. La Révolte des anges “La révolte des anges” adopte un mode fantastique pour aborder un certain nombre de thèmes chers à Anatole France: la critique de l’Église catholique, de l’armée, et la complicité de ces deux institutions. L’ironie est souvent mordante et toujours efficace. L’histoire est simple: des anges rebellés contre Dieu descendent sur terre, à Paris précisément, pour préparer un coup d’État (si l’on peut dire) qui rétablira sur le trône du ciel celui que l’on nomme parfois le diable, mais qui est l’ange de lumière, le symbole de la connaissance libératrice... Les tribulations des anges dans le Paris de la IIIe République sont l’occasion d’une critique sociale féroce. Finalement, Lucifer renoncera à détrôner Dieu, car ainsi Lucifer deviendrait Dieu, et perdrait son influence sur la pensée libérée... Influence et postérité Anatole France a été considéré comme une autorité morale et littéraire de premier ordre. Il a été reconnu et apprécié par des écrivains et des personnalités comme Marcel Proust (on pense qu’il est l’un des modèles ayant inspiré Proust pour créer le personnage de l’écrivain Bergotte dans À la recherche du temps perdu), Marcel Schwob et Léon Blum. On le retrouve a contrario dans Sous le soleil de Satan, croqué à charge par Georges Bernanos dans le personnage de l’académicien Antoine Saint-Marin. Il était lu et exerçait une influence sur les écrivains qui refusaient le naturalisme, comme l’écrivain japonais Jun’ichirō Tanizaki, il fut la référence pour Roger Peyrefitte. Ses œuvres sont publiées aux éditions Calmann-Lévy de 1925 à 1935. Anatole France est également, de son vivant et, quelque temps après sa mort, l’objet de nombreuses études. Mais après sa mort, il est la cible d’un pamphlet des surréalistes, Un cadavre, auquel participent Drieu La Rochelle et Aragon, auteur du texte: « Avez vous déjà giflé un mort ? » dans lequel il écrit: « Je tiens tout admirateur d’Anatole France pour un être dégradé. » Pour lui, Anatole France est un « exécrable histrion de l’esprit », représentant de « l’ignominie française ». André Gide le juge un écrivain « sans inquiétude » qu’« on épuise du premier coup ». La réputation de France devient ainsi celle d’un écrivain officiel au style classique et superficiel, auteur raisonnable et conciliant, complaisant et satisfait, voire niais, toutes qualités médiocres que semble incarner le personnage de M. Bergeret. Mais nombre de spécialistes de l’œuvre de France considèrent que ces jugements sont excessifs et injustes, ou qu’ils sont même le fruit de l’ignorance, car ils en négligent les éléments magiques, déraisonnables, bouffons, noirs ou païens. Pour eux, l’œuvre de France a souffert et souffre encore d’une image fallacieuse. D’ailleurs M. Bergeret est tout le contraire d’un conformiste. On lui reproche toujours de ne rien faire comme tout le monde, il soumet tout à l’esprit d’examen, s’oppose fermement, malgré sa timidité, aux notables de province au milieu desquels il vit, il est l’un des deux seuls dreyfusistes de sa petite ville… L’ensemble de l’Histoire contemporaine est, à travers un rappel du scandale inouï que fut l’affaire Dreyfus, un réquisitoire accablant contre la bourgeoisie cléricale, patriote, antisémite et monarchiste, dont beaucoup d’analyses restent applicables à l’époque actuelle. La modération apparente du ton, le classicisme du style qui se plaît souvent aux archaïsmes parodiques, a pu tromper des lecteurs habitués à plus de vociférations, et l’on peut même imaginer que certains détracteurs se soient sentis concernés par les sarcasmes dirigés contre l’extrême-droite et ceux qui réclamaient « la France aux Français » (Jean Coq et Jean Mouton au chapitre XX de M. Bergeret à Paris). Reflétant cet oubli relatif et cette méconnaissance, les études franciennes sont aujourd’hui rares et ses œuvres, hormis parfois les plus connues, sont peu éditées. Œuvres * Catalogue des œuvres d’Anatole FranceLes œuvres d’Anatole France ont fait l’objet d’éditions d’ensemble: * Œuvres Complètes, Paris: Calmann-Lévy, 1925-1935 * Marie-Claire Bancquart (éd.), Anatole France Œuvres (4 vol.), Gallimard, coll. « La Pléiade », 1984-1994 (ISBN 2-07-011063-X, 2-07-011125-3, 2-07-011211-X et 2-07-011361-2) Poésies * Les Poèmes dorés, 1873 * Les Noces corinthiennes, 1876. Drame antique en vers Romans et nouvelles * Jocaste et le Chat maigre, 1879 * Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, 1881. Prix Montyon de l’Académie française * Les Désirs de Jean Servien, 1882 * Abeille, conte, 1883 * Balthasar, 1889. Premier recueil de nouvelles publié par Anatole France * Thaïs, 1890,; réédité en 1923 avec la mention “Nouvelle édition revue et corrigée par l’auteur”. Cet ouvrage a fourni l’argument à l’opéra Thaïs de Jules Massenet * L’Étui de nacre, 1892, recueil de contes; réédité en 1923 avec la mention “Édition revue et corrigée par l’auteur” * La Rôtisserie de la reine Pédauque, 1892 * Les Opinions de Jérôme Coignard, recueillis par Jacques Tournebroche, 1893 * Le Lys rouge, 1894 * Le Jardin d’Épicure, 1894; réédité en 1921 avec la mention “Édition revue et corrigée par l’auteur” * Le Puits de Sainte Claire, 1895 * Histoire contemporaine en quatre parties: * 1. L’Orme du mail, 1897; réédité en 1924 avec la mention “Édition revue et corrigée par l’auteur” * 2. Le Mannequin d’osier, 1897; réédité en 1924 avec la mention “Édition revue et corrigée par l’auteur” * 3. L’Anneau d’améthyste, 1899 * 4. Monsieur Bergeret à Paris, 1901 * Clio, 1899; réédition sous le titre Sous l’invocation de Clio, 1921 * L’Affaire Crainquebille, 1901 * Le Procurateur de Judée, 1902 * Histoire comique, 1903 * Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, 1904 * Sur la pierre blanche, 1905, * L’Île des Pingouins, 1908,; réédition Paris: Théolib, 2014 (ISBN 978-2-36500-082-6); * Les Contes de Jacques Tournebroche, 1908 * Les Sept Femmes de Barbe bleue et autres contes merveilleux, 1909 * Les dieux ont soif, 1912 * La Révolte des anges, 1914 Souvenirs * Le Livre de mon ami, 1885. Réédition illustrée par Fernand Siméon aux Editions G. Grès et Cie en 1921. * Pierre Nozière, 1899 * Le Petit Pierre, 1918 * La Vie en fleur, 1922 Théâtre * Au petit bonheur, 1898. Pièce en un acte * Crainquebille, 1903 * La Comédie de celui qui épousa une femme muette, 1908. Pièce en deux actes * Le Mannequin d’osier, 1897. Comédie adaptée du roman homonyme (première représentation le 22 mars 1904); Histoire * Vie de Jeanne d’Arc, 1908 Critique littéraire * Alfred de Vigny, 1868 * Le Château de Vaux-le-Vicomte, 1888. Préface de Jean Cordey. Rééditions: Calmann– Lévy, 1933 ; Presses du Village, 1987 ; archives pers.[réf. nécessaire]) * Le Génie latin, 1913. Recueil de préfaces * La Vie littéraire, Paris, Calmann-Lévy, 1933. La préface de la "quatrième série" est datée de mai 1892 Critique sociale * Opinions sociales, 1902 * Le Parti noir, 1904 * Vers les temps meilleurs, 1906. Recueil de discours et lettres en 3 tomes ; 3 portraits par Auguste Leroux * Sur la voie glorieuse, 1915 * Trente ans de vie sociale en 4 tomes: * I. 1897-1904, 1949, commentaires de Claude Aveline * II. 1905-1908, 1953, commentaires de Claude Aveline * III. 1909-1914, 1964, commentaires de Claude Aveline et Henriette Psichari * IV. 1915-1924, 1973, commentaires de Claude Aveline et Henriette Psichari; seconde édition (1971)[réf. nécessaire]; * « Préface » du livre de: Dr Oyon, Précis de l’affaire Dreyfus, Paris, Pages libres, 1903 Adaptations Théâtre * Crainquebille Musique * Thaïs de Jules Massenet * Le Jongleur de Notre-Dame de Jules Massenet, inspiré d’une des nouvelles de L’Étui de Nacre ; * Les Noces corinthiennes, opéra d’Henri Büsser. Filmographie * Des adaptations au cinéma d’œuvres d’Anatole France ont été réalisées dès son vivant. * Il apparaît aussi dans un documentaire de Sacha Guitry, Ceux de chez nous (1915). * Films * 1914: Thais de Constance Crawley et Arthur Maude ; * 1920: Le Lys Rouge de Charles Maudru ; * 1922: Crainquebille de Jacques Feyder, avec Françoise Rosay ; * 1926: Les dieux ont soif de Pierre Marodon.Téléfilms * 1981: Histoire contemporaine de Michel Boisrond, avec Claude Piéplu dans le rôle de Monsieur Bergeret (série de 4 téléfilms). Hommages * De nombreuses voies publiques, transports publics, portent le nom d’Anatole France, parmi lesquels une station du métro de Paris et une du métro de Rennes. En 2015, il est le vingt-neuvième personnage le plus célébré au fronton des 67 000 établissements publics français: pas moins de 177 écoles, collèges et lycées lui ont donné son nom, derrière Joseph (880), Jules Ferry (642), Notre-Dame (546), Jacques Prévert (472), Jean Moulin (434).En 1937, la Poste française émet un timbre-poste à son effigie.Deux portraits de lui dessinés et signés par Théophlie-Alexandre Steinlen, l’un daté de 1917, l’autre annoté "Saint-Cloud, janvier 1920" figuraient sous les numéros 74 et 75 du catalogue de dessins et estampes du marchand Paul Prouté de 1985. * Dans Les Puissances des ténèbres (1980), le romancier britannique Anthony Burgess mentionne Anatole France et sa nouvelle « Le Miracle du grand saint Nicolas » comme source d’inspiration pour un opéra écrit par le narrateur Kenneth Marchal Toomey. * Une statue de lui assis devant une petite colonnade orne le parc de la préfecture d’Indre-et– Loire. * Dans le cadre des 31èmes Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité de Saint-Cyr-sur-Loire (37), l’association “Saint-Cyr; hommes et patrimoine” et le Conseil Général d’Indre-et-Loire ont organisé ces manifestations: * le 19 septembre 2014, installation du buste de France en 1919 par Antoine Bourdelle (cf. le bronze du musée d’Orsay reproduit sur cette page), exemplaire en pierre (?) inauguré en 1955 puis restauré, dans le parc du manoir de la Tour, espace à vocation littéraire qui honore les hommes de lettres illustres ayant séjourné dans la commune; * le 20 septembre 2014, évocation musicale de sa vie et de son œuvre avec musiques de Paul-Henri Busser et de Massénet dans le parc de La Perraudière (mairie); * du 20 au 28 septembre 2014, présentation dans la mairie de l’exposition "Anatole France, sa vie son œuvre et ses dix ans à Saint-Cyr-sur-Loire" (cf. le magazine municipal Saint-Cyr présente... de septembre-décembre 2014, Anatole France “Pourquoi m’avez-vous oublié ?”– p. 6 et 7).L’un de ses textes faisait partie du corpus au Baccalauréat de Français en juin 2016. Une petite polémique [1] [2] se déclencha après les épreuves au cours desquelles de nombreux candidats qui ne le connaissaient pas l’avaient parfois pris pour une femme. Citations * « La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son âme, et qu’on n’est jamais tenté de lui être infidèle. » (Les Matinées de la Villa Saïd, 1921) ; * « Ah! c’est que les mots sont des images, c’est qu’un dictionnaire c’est l’univers par ordre alphabétique. À bien prendre les choses, le dictionnaire est le livre par excellence. » (La Vie littéraire) ; * « Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin c’est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s’en va au collège en sautillant comme un moineau... » (Le Livre de mon ami, chapitre X: « Les humanités ») ; * « Le lecteur n’aime pas à être surpris. Il ne cherche jamais dans l’histoire que les sottises qu’il sait déjà. Si vous essayez de l’instruire, vous ne ferez que l’humilier et le fâcher. Ne tentez pas l’éclairer, il criera que vous insultez à ses croyances (...) Un historien original est l’objet de la défiance, du mépris et du dégoût universel. » (L’Île des pingouins, préface) ; * « De tous les vices qui peuvent perdre un homme d’État, la vertu est le plus funeste: elle pousse au crime. » (La Révolte des anges, chapitre XXI) ; * « La guerre et le romantisme, fléaux effroyables! Et quelle pitié de voir ces gens-ci nourrir un amour enfantin et furieux pour les fusils et les tambours! » (La Révolte des Anges, chapitre XXII) ; * « Je ne connais ni juifs ni chrétiens. Je ne connais que des hommes, et je ne fais de distinction entre eux que de ceux qui sont justes et de ceux qui sont injustes. Qu’ils soient juifs ou chrétiens, il est difficile aux riches d’être équitables. Mais quand les lois seront justes, les hommes seront justes. » (Monsieur Bergeret à Paris, chapitre VII) ; * « L’union des travailleurs fera la paix dans le monde », cette citation, faussement attribuée à France (c’est une traduction de Marx), se trouve notamment sur le Monument aux morts pacifiste de Mazaugues dans le Var ; * « On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels » (« Lettre ouverte à Marcel Cachin », L’Humanité, 18 juillet 1922) ; cité par Michel Corday dans sa biographie (1928); * « Ma faiblesse m’est chère. Je tiens à mon imperfection comme à ma raison d’être. » (Le Jardin d’Épicure, 1894) ; * « Monsieur Dubois demanda à Madame Nozière quel était le jour le plus funeste de l’histoire. Madame Nozière ne le savait pas. C’est, lui dit Monsieur Dubois, le jour de la bataille de Poitiers, quand, en 732, la science, l’art et la civilisation arabes reculèrent devant la barbarie franque. » (La Vie en Fleur, 1922) ; * « Bénissons les livres, si la vie peut couler au milieu d’eux en une longue et douce enfance! » (La Vie littéraire, tome 1, préface) ; * « Mais parce que mes passions ne sont point de celles qui éclatent, dévastent et tuent, le vulgaire ne les voit pas. » (Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, 1881). * "C’était le seul homme de valeur à avoir accédé, durant la guerre, à un poste de haute responsabilité; mais on ne l’a pas écouté. Il a sincèrement voulu la paix et c’est la raison pour laquelle on n’eut pour lui que du mépris. On est ainsi passé à côté d’une splendide occasion". (lettre de 1917 à propos de Charles 1er de Habsbourg). Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatole_France